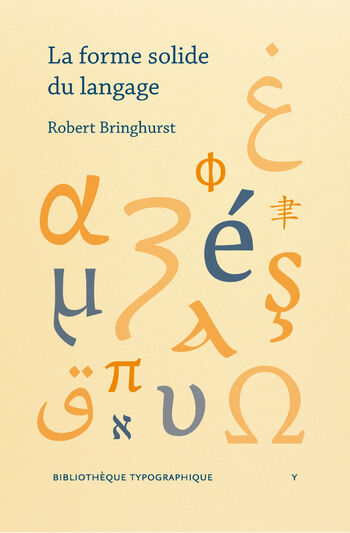8/06/2011
« Pour l’épaisseur d’un trait (l’écriture selon R. Bringhurst) », par Patrice Beray
La « Bibliothèque typographique » d’Ypsilon éditeur vient de s’enrichir d’un nouveau titre, La Forme solide du langage, un court essai, brillant et dense, du poète, typographe et linguiste canadien Robert Bringhurst. Son plus grand mérite est peut-être de raviver un mystère aussi entier que celui de l’origine du langage : l’invention de l’écriture.
Dans un précédent ouvrage de la collection intitulé Le Trait, on avait pu « retracer » (voir ce billet) grâce à son auteur, Gerrit Noordzij, l’histoire trop négligée de la conception et de la formation manuelle du tracé des lettres qui avait précédé ce grand saut (quelque peu oublieux de cette genèse) que constitua la typographie avec l’invention de l’imprimerie.
Le présent essai de Bringhurst explore en quelque sorte l’autre versant de l’écriture, celui où elle est donnée comme « une forme solide », codifiée, de langues particulières. Pour l’auteur, « en croissant hors du dessin », il faut donc admettre que l’écriture s’est dégagée une fois pour toutes des images initiales qui ont mené à son surgissement. Ainsi, pour qu’elle puisse être codifiée, elle est devenue « abstraite », ce que résume cette phrase d’Eric Gill rapportée par l’auteur : « Les lettres sont des choses, non des images de choses. » Dès lors, ces symboles ne renvoient plus directement à la parole (d’une langue), pouvant être érigés en un système scriptural autonome (lexicologie, grammaire...).
Dès l’entame de son ouvrage, Bringhurst pose remarquablement son sujet, en anthropologue averti, clairvoyant. A la base, l’écriture en elle-même n’est pas une langue, mais un système de représentation. Dans l’histoire de l’humanité, des cultures orales ont fort bien pu se passer de ce système scriptural, car ce n’est là avant tout que « moyens artificiels » de « contrôle gestionnaire du langage ».
L’écriture est donc une invention, alors que « les langues ne le sont typiquement pas », qui « se maintiennent elles-mêmes et se développent partout où vivent des hommes ».
Cette invention a pour originalité d’avoir essaimé dans quelques foyers socio-économiques et politiques hautement organisés : Mésopotamie (il y a quelque 5000 ans), Chine du nord (circa 4500 ans), Guatemala et au sud du Mexique (circa 2000 ans). Dans chaque cas, comme le souligne, Bringhurst l’écriture a surgi pour servir en quelque sorte dans le cadre « de travaux et de jours » parfaitement ordonnancés, rejoignant par là la thèse déjà formulée par Jack Goody, notamment dans La Raison graphique.
Pour Bringhurst, il ne fait donc aucun doute que l’écriture a dû faire une sorte de détour pour rejoindre le corpus de la « littérature, à savoir l’art de conter et la poésie », qui « implique l’utilisation de la langue davantage pour les besoins de la découverte que pour ceux du contrôle ».
Là est en effet le superbe paradoxe de cet essai, qui peut assener que « la littérature n’est pas la cause de l’écriture », que « la littérature au sens écrit représente le triomphe du langage sur l’écriture : la subversion de l’écriture à des fins ayant peu sinon rien à faire avec le contrôle social ou économique ».
Voilà donc découvert un peu de cet autre versant de l’écriture, qui nicherait dans l’épaisseur du trait.
Pour y parvenir, l’auteur s’attache avant tout aux rapports de l’écriture avec le sens. Ainsi, dès lors que l’on s’attache à signifier quelque chose, en écrivant une langue parlée, une roue complexe (voir dessins) de capacités que se découvrent les écritures de par le monde entier se met en mouvement.
Dans les quatre « genres majeurs d’informations linguistiques » que distingue Bringhurst, il est une partition élémentaire propre au langage qui se situe entre le sens et le son. Dans la dimension prosodique de l’écriture (la plus explicitement créative), c’est dans la circumnavigation de l’un à l’autre que se produit une alchimie (cette fameuse forme solide du langage), une fixation en propre, par l’écriture, de ce que l’on a à l’esprit, que l’on peut résumer ainsi : les images censées se rapporter à des choses ou des idées sont figurées au travers de sons. Puis vient s’y apposer le stade de la graphie du son, « du son du mot qui nomme le sens ». Mais ce « ne sont plus alors (des) symboles du sens mais des symboles du son ». Autrement dit, transparaît à l’écrit de façon éclatante la non moins fameuse « signifiance » du langage.
L’auteur ajoutant, non sans humour :
« Une fois la graphie des sons établie, on cherche parfois des moyens de clarifier le sens »...
Ainsi l’écriture rejoindrait, par un artifice complexe, ajoutant encore à son énigme, le jaillissement de la parole tel qu’énoncé dans les toutes premières lignes de cet essai :
« Lâchez un mot dans l’océan du sens et des ondes concentriques se forment. Définir un seul mot signifie tenter de saisir ces ondes. Personne n’a les mains assez rapides. Lâchez maintenant deux ou trois mots à la fois. Des motifs d’interférence se forment, se renforçant ici l’un l’autre et s’annulant là. Saisir le sens des mots n’est pas saisir les ondes qu’ils causent ; c’est saisir l’interaction entre ces ondes. C’est ce qu’écouter signifie ; c’est ce que lire signifie. Ce qui est incroyablement complexe, pourtant les hommes le font chaque jour, et très souvent rient et pleurent à la fois. En comparaison, écrire semble tout à fait simple, du moins avant d’avoir essayé. »
Et à ceci près qu’historiquement, « écrire au sens littéraire est un des métiers les plus solitaires »...