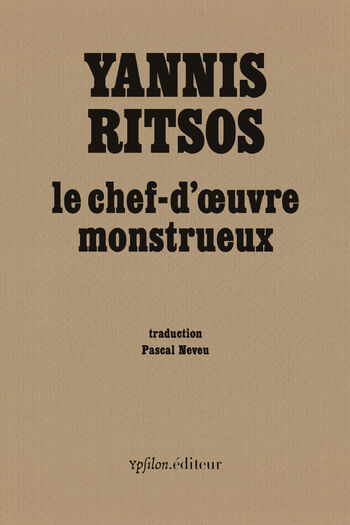1/03/2018
« Yannis Ritsos : Le chef-d’œuvre monstrueux », par Michel Ménaché
En 1977, trois ans après la chute de la dictature des colonels, Yannis Ritsos âgé de 68 ans écrit en 5 jours Le chef-d’œuvre monstrueux. D’abord intitulé par l’auteur Chef-d’œuvre avorté, il sera traduit une première fois en français par Dominique Grandmont sous le titre Chef-d’œuvre sans queue ni tête. Mêlant la réalité brutale de son histoire personnelle à la distanciation libre, les souvenirs intimes à l’onirisme, avec d’infinis jeux de miroirs et de transfigurations métaphoriques, ce poème puise dans plusieurs époques de la Résistance, de la guerre civile, avec des anachronismes voulus, les figures mythologiques antiques intervenant parmi les vivants. Les voix qui se sont tues répondent aussi aux interrogations métaphysiques du poète ou dialoguent avec le présent. Dominique Grandmont rappelle que pour Ritsos, « lutter contre l’ignorance c’est lutter contre la mort. » Au fil décousu, à dimension polyphonique, du Chef-d’œuvre monstrueux, le postfacier retient, dans la « série de dérapages contrôlés […] sous le double jeu de l’écriture […] cet espoir qu’il continue d’exprimer dans le devenir de l’homme. » Et d’ajouter : « On sait qu’il n’était pas impartial dans cette interminable guerre civile qu’on appelle l’histoire. » Ritsos reconnaissait accueillir toutes les influences ; il déclarait dans un entretien recueilli par Michèle Métoudi : « L’art de la poésie est universel et embrasse l’homme tout entier : impressions, sensations, sentiments, esprit et la logique elle-même, […] en élargissant et en approfondissant son horizon spirituel – un sens et un critère esthétique, certes essentiellement social, dans le sens le plus large du terme…» Cette poétique ouverte et généreuse est une invitation stimulante à découvrir ce grand chant arborescent.
D’emblée, le poète déconcerte son lecteur : « je lis les mots à l’envers je trouve leur sens véritable. » Et, non sans un goût certain de la provocation hyperbolique, il clame : « j’ai un empire à moi sous chacun de mes ongles. » Le ton est donné. Ritsos se réclame de Maïakovski, confronté à la petitesse des bureaucrates et des imbéciles, jusqu’au suicide : « et son pantalon colossal pendait au nuage lacéré par les griffes de ses chiens. » Il retrouve les poètes disparus, revit lui-même en eux, partage les images fortes de Kavafis, auteur secret publié après sa mort, le désespoir de Karyotakis, suicidé en 1928, etc. En écho, il imagine ce que dirait encore le Zorba de Kazantzakis : « ô comme fourmillent les étoiles et asticots sur la peau du monde… » Il rend hommage à sa mère qui fut la première à croire à son talent, à sa sœur protectrice fidèle, internée un temps en hôpital psychiatrique. Sa résistance au malheur et à l’oppression est à la fois politique, morale et physique : « J’ai vieilli d’une jeunesse sans fin qui n’entend pas vieillir. » Il défie les ennemis de la liberté : « derrière les troncs d’arbre m’épient mille mouchards » et « les poétastres » qui le détestent… Dans son propre camp, il défie ses camarades quand ils se plaignent des tendances métaphysiques de sa poésie, leur répond « par des poèmes plus métaphysiques encore d’un réalisme plus fouillé », et il ridiculise les censeurs soviétiques d’avoir condamné « les chats » d’Akhmatova.
Le chaos grec, sous la junte des colonels, est évoqué avec les noms terribles de Makronissos, Yaros et Léros, « le pain pierreux de la déportation ». Les traces témoignent des supplices, des exécutions en masse : « les murs étaient encore écorchés par les ongles des prisonniers. » Sur le plan géopolitique, le poète dénonce les dérives des régimes bureaucratiques, il déplore les dissensions à l’Est, les divisions de la gauche, le découragement des compagnons de lutte, il brocarde le détachement de ceux qui « commentaient inactifs en fumant les idées comme des cigarettes ». A l’échelle de l’histoire universelle, il invoque « les Grands Aveugles et leur vue intérieure […] / Homère Œdipe Tirésias / et bien sûr l’aveuglement plus général de l’être humain ». Il ne s’épargne pas lui-même, cultivant l’autodérision avec des images triviales : « ma modestie enflait comme une dinde archi-fourrée aux marrons la veille de Noël. » Ou encore, parodiant la révolte des objets à la manière de Maïakovski, il joue à se mettre en scène en porteur de symboles de la modernité : « j’ai mis la tour Eiffel dans ma poche / j’ai mis la statue de la Liberté dans mon chapeau. »
Les grandes voix des poètes phares accompagnent Ritsos dans son combat comme dans sa rêverie : Hikmet, Neruda, Aragon, Lorca assassiné dès le début de la guerre civile en Espagne, Séféris mort pendant la dictature dont les funérailles tournèrent en manifestation, etc. tous frères en poésie. Un inventaire à la fois imagé et concret valorise les acteurs nécessaires et familiers des métiers manuels : « je ne savais pas pourquoi eux tous s’étaient rassemblés chez moi… » L’art de la langue et celui de la main se rejoignent dans la dignité d’être et de faire. On pense à Guillevic ajustant les mots comme le menuisier, les planches…
Autobiographie libre de toutes conventions, en fragments désordonnés, « mémoires d’un homme tranquille qui ne savait rien », Le chef-d’œuvre monstrueux aurait pu rebuter les nouveaux lecteurs de Ritsos. Pascal Neveu en a éclairé la trame mémorielle et la profondeur avec près de 200 notes et un commentaire sur sa traduction, en annexes. C’est dire le soin qui a été apporté à l’édition de cette nouvelle traduction d’un poème multidimensionnel, mêlant lieux et temps dans une quête sans fin qui, souligne Dominique Grandmont, « cherche moins à perpétuer l’écho qu’à faire retentir un certain silence […] en retrouver l’émergence intacte, […] nous donner l’émotion de la découverte ».