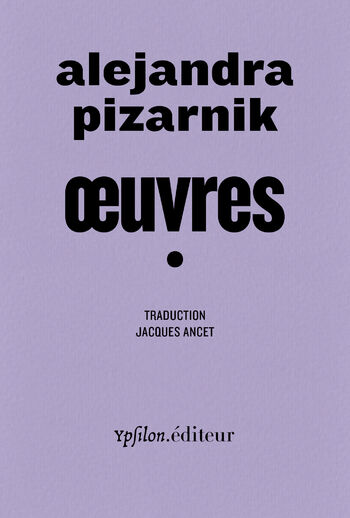24/09/2022
« Alejandra Pizarnik : “Oh, j’ai embrassé tant de bites” », par Agnès Giard
Disparue il y a 50 ans, la poétesse argentine était-elle vraiment une lesbienne suicidaire et «fêlée» comme le veut la légende ?
Née à Buenos Aires en 1936, fille d’immigrants juifs d’Europe centrale, Alejandra Pizarnik est souvent présentée comme une figure tragique de la poésie. Certaines biographies en ligne affirment qu’elle se serait suicidée, d’autres qu’elle serait morte dans un asile d’aliénés. Ses Œuvres complètes, publiées depuis 2013 aux éditions Ypsilon, accréditent l’image d’une femme en souffrance, obsédée par la nuit. Lorsqu’elle parle du présent, il est « sans mains pour dire jamais /sans mains pour offrir des papillons /aux enfants morts » ((La Dernière innocence, 1956). Lorsqu’elle évoque l’enfance « et son odeur d’oiseau caressé » (Les Aventures perdues, 1958), c’est pour pleurer son « état d’orpheline » : « Ceux qui arrivent ne me trouvent pas /Ceux que j’attends n’existent pas » (les Travaux et les nuits, 1965). Ponctués par les mots « ombre », « silence » et « cris », ses textes suggèrent l’idée d’un mal-être chronique : « On te martèle d’oiseaux noirs » dit-elle dans Extraction de la pierre de folie (1968), un recueil dont le titre reprend celui d’un tableau de Jérôme Bosch, dépeignant une trépanation.
Pizarnik parle souvent d’angoisse. Mais s’en tenir à cette image de « petite oubliée dans son jardin de ruines et de lilas » (selon ses propres termes) serait passer à côté d’elle. Car Pizarnik parle aussi volontiers d’amour — ou serait-ce de sexe ? — avec une franchise décapante. « Je suis excitée. Je désire un corps contre le mien. N’importe lequel ! N’importe quel sexe, n’importe quel âge. Ça, ça n’a pas d’importance ! Il suffit d’un corps à toucher et qui me touche. » Dès l’âge de 18 ans, dans un Journal (également publié aux éditions Ypsilon) inspiré par ceux de Franz Kafka et Katherine Mansfield, Pizarnik compare ses sœurs à des « génisses » qui sont mariées et « se reproduisent » conformément aux exigences sociales. Alejandra Pizarnik, pour sa part, abuse joyeusement d’être une jeune femme brillante et libre, issue d’un milieu aisé. Elle fait des études qu’elle n’achève jamais.
Sexe, drogue et psychanalyse
Elle s’inscrit en faculté de philosophie, de lettres, de journalisme et à des cours de peinture sans obtenir aucun diplôme. Elle se fiance dans un accès d’ivresse (7 cocktails) et rompt tout aussitôt : « On m’a demandé combien gagnait L. J’ai eu envie de répondre que son salaire suffirait à peine à payer les préservatifs. » Elle prend des cachets d’amphétamines. Elle va seule dans les bars. Elle boit. Elle fait une psychanalyse. Parfois, elle s’éprend d’un garçon mais lui préfère ses amies. Ou le contraire. « Je n’ai pas d’argent ni d’amis ni d’amour. Des désirs. Seulement des désirs », écrit-elle, en se plaignant de ne pouvoir satisfaire facilement ses pulsions : « On devrait inventer des bordels spéciaux pour femmes artistes ! » Son idéal de vie : créer le jour et jouir la nuit. Pour ce qui est de la création, elle s’y consacre totalement, avec une avidité aussi impossible à satisfaire que le reste.
Jamais contente, obsédée, elle passe ses journées à lire, écrire puis raturer, se soumettant à l’enfer d’une relecture critique qu’elle nomme sa « méthode », et qui la force à réécrire sans cesse des textes dont elle ne garde que des bouts, soigneusement classés, qu’elle colle à d’autres bouts avant de tout recommencer. « Je dois créer ! C’est la seule chose qui compte au monde. Ajouter quelque chose. Laisser quelque chose. » Les coups d’état et les massacres se succèdent en Argentine tandis qu’elle dévore Proust, Descartes, Jouve, Vallejo, Kierkegaard, Woolf ou Sade enfermée dans une chambre qui lui sert de cellule. Quand elle en sort, c’est pour jouer de son « sex apple » auprès de filles ou de garçons dont elle s’éprend tour à tour. « Étant donné mon heart with two faces (aujourd’hui je prends, demain je jette) », écrit-elle, comment faire pour se fixer ? Quand elle se rend à Paris, en 1960, les liens qu’elle noue ne l’empêchent pas de se sentir étrangère, à tout, comme toujours.
Vie amoureuse « un peu compliquée »
En 1964, elle retourne en Argentine, où la junte militaire va bientôt prendre le pouvoir et, de nouveau, s’enferme dans sa chambre pour écrire des poèmes qu’elle réécrit compulsivement, sans jamais se satisfaire d’aucune version. À son ami André Pieyre de Mandiargues (leur Correspondance est publiée aux éditions Ypsilon), elle écrit en 1969 : « Je lutte en essayant d’accepter mon écriture organique ou viscérale. À part ça, j’ai une “vie” amoureuse un peu compliquée : deux femmes et un homme, c’est-à-dire : une actrice de théâtre […] une jeune fille française qui étudie cette chose absurde appelée sociologie et un play-boy. » Elle fait une tentative de suicide en 1970, suivie d’un séjour de cinq mois à l’hôpital Pirovano, qui lui inspire un poème hilarant : « Salle de psychopathologie » (publié dans le recueil Textes d’Ombre, aux éditions Ypsilon). « Oh, j’ai embrassé tant de bites pour me retrouver soudain dans une salle […] où les femmes vont et viennent en parlant d’amélioration. »
Les injonctions à « aller mieux » lui paraissent dérisoires. « J’ignore ce que je fais dans la salle 18 hormis l’honorer de ma présence prestigieuse (s’ils m’aimaient un petit peu ils m’aideraient à l’annuler). » Lors de ce séjour qui n’est pas à proprement parler un internement puisqu’elle a le droit de sortir chaque week-end, Alejandra Pizarnik rencontre une jeune femme, Ana Becciu, qui devient une de ses amies les plus proches1 . Ana est la dernière à l’avoir vue en vie. «Le dimanche 24 septembre 1972, Alejandra demande à Ana : «Demain, tu m’appelles au téléphone à 11 heures car je dois déjeuner avec Olga [Olga Orozco, une autre grande amie et une poétesse, ndlr] Ana appelle à 11 heures, plusieurs fois mais personne ne répond. Ce qui l’inquiète mais elle ne peut pas se libérer pour aller voir son amie jusqu’à 14 heures, c’est alors qu’elle arrive à l’appartement. Ses coups à la porte restant sans réponse, elle s’affole, enfonce la porte et trouve Alejandra inanimée. Elle l’emmène en taxi dans la clinique la plus proche. Les médecins la déclarent morte d’un œdème pulmonaire, résultat probable d’une vie d’usure : trop de nuits blanches, d’alcool, de tabac, de cachets… »* C’est ainsi que la créatrice des éditions Ypsilon, Isabelle Checcaglini, rapporte le récit qu’elle tient de la bouche même d’Ana Becciu.
Mourir dans un taxi
Dans une très belle postface à l’anthologie des poèmes de Pizarnik (Œuvres), l’écrivain Liliane Giraudon, qui a également interrogé Ana Becciu, démystifie cette mort en une phrase lapidaire : « Le non-suicide d’Alejandra Pizarnik ultime pied de nez d’Alejandra Pizarnik à la sinistre mais commode légende d’une “Pizarnik poétesse maudite et suicidée”. » Il n’est pas innocent bien sûr qu’Alejandra Pizarnik soit morte si jeune, à 36 ans : « Elle était dans l’autodestruction, c’est indéniable. Mais il faut lui rendre cette justice et reconnaître que Pizarnik voulait vivre éternellement, aimait son corps, aimait le sexe, suffoquait d’envies. » Ainsi que le formule Isabella Checcaglini, qui, depuis neuf ans, publie inlassablement les œuvres de Pizarnik dans des versions non tronquées ou inédites, la poétesse argentine est peut-être morte d’un excès d’envies. Elle se plaignait d’avoir trop de désirs. Dans son Journal, Pizarnik écrit : « Un jour viendra où il ne me sera plus possible de maintenir ce visage double ; un jour je devrai choisir ; un jour en choisir Un et ne plus penser à l’autre ».
- Alejandra Pizarnik rencontre Ana Becciu un soir de l’hiver 1971, lors d’une sortie, puisqu’on la laissait sortir chaque week-end de l’hôpital psychiatrique. Suite à cette rencontre, Ana Becciu lui rend visite à l’hôpital tous les soirs. « Lorsqu’elle retourna dans son appartement de la calle Montevideo, comme nous étions voisines, nous nous voyions presque quotidiennement », raconte Ana Becciu, (texte publié dans le dossier Pizarnik du Cahier critique de poésie du CiPM de Marseille en 2013). ↩