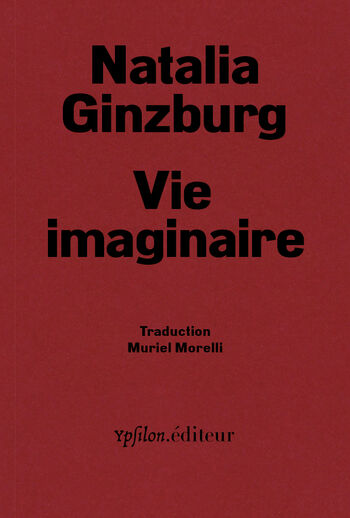14/11/2025
« Vie imaginaire » de Natalia Ginzburg, par Tiphaine Samoyault
Notre feuilletoniste a lu le recueil si harmonieux de textes de l’écrivaine italienne, datant du début des années 1970 et traduit seulement aujourd’hui.
LEÇON DE LITTÉRATURE
Les Mots de la tribu, de Natalia Ginzburg (Grasset, 1966), est un des livres que j’aime le plus offrir à mes amis. On y voit revivre tout un monde en train de finir dans lequel les adultes crient et les enfants sont mélancoliques. L’autrice y raconte son enfance et ses années de jeunesse à Turin (Italie) à l’époque du fascisme. Pour les enfants, il faut d’abord se faire une place dans le monde en luttant contre les formules, les phrases toutes faites qui ferment les familles sur elles-mêmes et définissent un ordre en apparence immuable. Il leur faut ensuite résister aux injonctions d’un régime qui s’y connaît en manipulation des mots. Peu de textes autobiographiques sont à ce point collectifs et solidaires. Les dialogues sont comiques et les phrases tonitruantes du père comme celles, réservées et prudes, de la mère émanent de corps bien vivants que leurs préjugés n’empêchent pas d’être des antifascistes convaincus et actifs. Les événements tragiques qui se profilent, et qui culminent avec l’assassinat sous la torture du mari de Natalia, Leone Ginzburg, par la Gestapo, à Rome, en février 1944, paraissent étouffés par le lexique familier et rassurant qui définit la famille. Mais celle-ci ne peut être un rempart bien solide contre le monde extérieur, qui répond par l’énigme, l’amour ou la guerre.
La mise en scène théâtrale de cette crise du langage doit beaucoup à Proust, que Natalia Ginzburg (1916-1991) a traduit lorsqu’elle était en exil forcé à Pizzoli, dans les Abruzzes. Elle reprend son sens du détail, une façon de rapporter des expressions et propos en les mettant à distance sans surplomb. La ressemblance s’arrête là et son œuvre ne s’assigne aucune des ambitions du roman proustien. Elle s’emploie simplement à parler de ceux qu’elle aime et d’en parler à son temps. Cela aurait pu rendre son œuvre un peu démodée. S’il n’en est rien, c’est qu’elle fait de cette proximité une force littéraire : chaque écrit participe ainsi du lien avec le monde que nous ne cessons de créer avec la langue et contribue à le rendre plus nécessaire.
La figure de ce lien est la comparaison. Dans Vie imaginaire, qui rassemble les textes écrits pour les journaux au début des années 1970 (publié en 1974 en Italie et jusque-là inédit en français), elle ne cesse d’associer les livres ou les personnes qu’elle aime à des éléments qui les dépassent et les relient à la nature et aux phénomènes météorologiques. Ainsi, le romancier Tonino Guerra (1920-2012), « chaque fois qu[’elle] le voi[t], [elle a] l’impression que ses habits sont imprégnés de brouillard et qu’il sort d’une forêt automnale où il a chassé le lièvre ». Quand des personnes meurent, écrit-elle, on comprend subitement leur vraie place dans l’univers : « Il y a des personnes qui restent dans notre mémoire comme des rochers, d’autres comme des arbres, d’autres encore comme des jardins, ou des nuages, ou des collines, ou des fleuves. » Le mot qui pourrait le mieux résumer son art serait sans doute celui d’harmonie, à condition de ne pas y voir un état, quelque chose de donné à l’avance, mais le rythme et le mouvement d’une communication secrète avec quelque chose de plus grand que soi.
Un texte profondément mélancolique
« Vie imaginaire » est le bref texte autobiographique qui donne son titre à ce recueil. Elle y parle des compagnies imaginaires dont elle s’entourait enfant, en pensant alors qu’elle était la seule à le faire. Le récit est au « nous » pour mieux faire sentir le confort de cet entourage. Le plus beau, c’est la façon dont, mystérieusement, ces foules inventées sont remplacées par une communauté de personnes réelles que l’on transporte avec soi dans ses rêves. La vie imaginaire permet de tout faire : cesser d’être une figurante dans l’existence, supprimer le gouffre qui sépare la présence de la perte, trouver des ressources pour la vie créative – « une qualité d’attention particulière, une façon à la fois impérieuse et respectueuse de manipuler en nous les faits réels ». C’est aussi un texte profondément mélancolique, écrit à un âge où les souvenirs incomplets semblent occuper la place autrefois tenue par la vie imaginaire.
Cette réflexion résonne avec l’admirable texte qu’est « Mon métier », recueilli avec d’autres textes personnels dans Les Petites Vertus (traduit par Adriana R. Salem, Ypsilon, 2021). Personne n’a jamais parlé de l’écriture comme Natalia Ginzburg le fait. Elle n’intellectualise jamais : elle ausculte son énergie et son travail au fil du temps, ses tentatives ratées, pourquoi, ce qui manquait. Elle guette des gestes, des sensations, des emplois du temps et des impressions vives. C’est son activité et elle la décrit simplement, avec ses angoisses et sa nécessité intérieure, jusqu’à ce qu’elle ne fasse qu’un avec le corps. Le métier d’écrire rejoint le « métier de vivre » de son grand ami Cesare Pavese (1908-1950). Si vous n’avez jamais lu Natalia Ginzburg, je vous conseille de commencer par Les Petites Vertus et Les Mots de la tribu. Ensuite, vous retrouverez dans Vie imaginaire sa voix si obstinée et si chantante lorsqu’elle parle cette fois des écrivains qui lui sont proches (Moravia, Biagio Marin, Morante…), de ses films préférés (de Bergman, Fellini…), de la ville de Rome, des mots qui changent de sens, de la liberté et de la démocratie qui ont besoin de soutien.