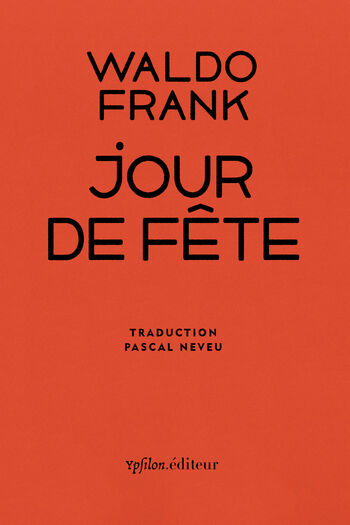29/06/2019
« Jour de fête : pour ne jamais oublier », par Anne-Frédérique Hébert‑Dolbec
L’histoire derrière Jour de fête, sixième roman de l’écrivain américain Waldo Frank, relève du mythe. Né dans une famille juive de la classe moyenne supérieure, éduqué à Yale, il entreprend en 1922 un voyage dans le sud des États-Unis en compagnie de son grand ami, l’auteur Jean Toomer. Afin de mieux comprendre les relations humaines dans une société américaine violemment divisée par la ségrégation, Frank se fait passer pour « noir ». Ensemble, les deux amis récoltent des observations desquelles naîtront deux livres jumeaux, Jour de fête et Canne, qui paraîtront simultanément en 1923. Alors que le second livre a survécu à l’histoire et est désormais considéré comme un « classique », le premier, bien que bouleversant et évocateur, correspondait moins à ce mouvement de renouveau de la culture afro-américaine que fut la Renaissance d’Harlem, et qui propulsa des dizaines d’écrivains noirs au rang de légendes.
La petite ville sudiste de Nazareth
Dans ce livre qui bénéficie enfin d’une première traduction en français, Waldo Frank explore la plaie béante d’une Amérique gouvernée par la haine et ne passe sous silence aucun des mensonges, préjugés et autres violences invisibles ou manifestes qui y pullulent, putréfiant les relations humaines, la confiance, les désirs et les fautes. Dans un style expérimental inspiré de la prose chantée, rythmée et fougueuse des hymnes gospels, l’écrivain fait le récit d’une journée dans la petite ville sudiste de Nazareth, une journée si chaude que Virginia Hade offre une journée de congé aux employés de son père à la demande du contremaître noir, John Cloud. Du crépuscule au crépuscule, entre le bord de mer et la colline, entre le quartier des Blancs et celui des Noirs, la canicule provoque une fièvre religieuse parmi les habitants qui mènera au lynchage d’un péché aux origines floues, culminant vers une finale d’une violence inouïe. Les mots, porteurs de l’éternelle blessure d’une histoire dont les cendres grondent sous nos pieds, prêtes à ressurgir, menacent à tout moment de nous échapper. Ils évoquent des émotions, des souvenirs et des craintes d’une richesse si exceptionnelle qu’ils ne peuvent se contenter de la banalité d’une narration attendue. La sensibilité, l’intensité et les figures poétiques se heurtent, s’entremêlent et se repoussent dans un ballet étourdissant d’images accablées de larmes, de douleurs et d’espoirs déchus. Les personnages, bien qu’évoqués à la manière nébuleuse d’un songe, s’imprègnent au fer chaud dans la mémoire.
Le reflet du cœur et de l’esprit
Les paysages se font le reflet du coeur et de l’esprit, premiers témoins de cette animosité omniprésente dont la justification prend racine dans la foi et l’honneur. « Le coton blanc étincelle sur des tiges noires qui nervurent la terre. Un nuage s’éclaire au-dessus d’une brume de noisetiers ; le vent nouveau trouve là de délicates castagnettes pour danser. »
Grandiose.