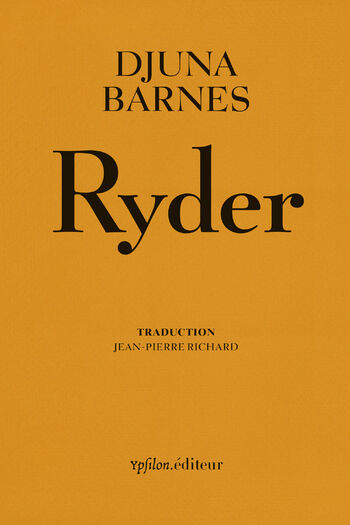1/05/2014
« Djuna Barnes, au centre de l’érotisme et de la mort », par Michel Vignard
Il est rare que deux rééditions fassent un événement. Publié en 1936, Le Bois de la nuit a été traduit en 1957 par Pierre Leyris. Paru en 1982 chez Christian Bourgois dans une traduction qui valut à Jean-Pierre Richard le prix Maurice-Edgar Coindreau, Ryder est le premier roman de Djuna Barnes. Il date de 1928.
Djuna Barnes entame ses histoires par des généalogies. Renvoyer les vivants aux morts est une façon de dire la vérité d’êtres sans attache. Félix, le héros du Bois de la nuit, est le fils d’une « [V]iennoise de grande force et militairement belle », morte en couche. Son père, juif, se prétendait « autrichien d’une lignée ancienne presque éteinte, exhibant, pour étayer son histoire, les preuves les plus stupéfiantes et les plus inadéquates ». Il meurt à cinquante-neuf ans, avant la naissance de son fils qui fait son « entrée dans le monde » trente ans plus tard avec pour tout héritage la passion de la noblesse, un titre usurpé et « deux portraits » d’aïeux inventés par son père.
Déflagrations
Autre héros de cette comédie des années 1920 qui se passe entre Vienne, Berlin et Paris, la vieille Europe et le Nouveau monde, le docteur Mathieu O’Connor. Ce gynécologue interdit d’exercice est un passeur. Par un mystère jamais vraiment élucidé, il a accouché la plupart des femmes de ce récit. Et quand ce n’est pas le cas, il joue volontiers les entremetteurs, ce qui, avouons-le, revient au même. Félix souhaite être père « car sans une pareille dévotion le passé tel qu’il le comprenait s’éteindrait dans le monde». O’Connor lui demande de quelle nationalité il choisira la mère de son enfant. « L’Amérique, répondit instantanément le baron. Avec une Américaine on peut tout faire. » Hélas, par une cruelle ironie du sort, à dix ans, le fils de Félix et Robine Vote aura « à peine la taille d’un enfant de six ».
Dans un monde sans ascendance ni destin et qui tient à peine debout, seul sauve du désastre un sens aigu et débridé de la conversation. Les personnages de Djuna Barnes en sont doués à un degré exceptionnel, un peu comme avant la Première Guerre mondiale les habitués du salon de Mme de Guermantes. C’est la principale modernité du Bois de la nuit, une façon de traiter les individus comme des déflagrations qui ponctuent le récit de leur souffle avant de disparaître aussi brutalement qu’ils sont apparus.
Le Bois de la nuit était le roman préféré de Susan Sontag, les hommes y font monde entre eux, et les femmes se retrouvent ensemble. Échappée du foyer de son époux, débarquant chez Nora, « Robine regarda autour d’elle avec égarement : “Je n’ai pas envie d’être ici”. Mais elle n’en dit pas plus long, elle n’expliqua pas où elle désirait être »s. La déflagration Robine-Nora, peut-être la plus violente de ce livre, laisse pantois le lecteur qui plus d’une fois doit s’interrompre pour laisser flotter dans le vide les échos de la stupéfiante beauté de ces pages inspirées de la relation qui lia l’auteur à la sculptrice Thelma Wood.
La vérité du mensonge
Huit ans auparavant, le coup de maître de Ryder avait imposé une jeune femme de 36 ans qui prenait non sans désinvolture possession de la littérature. Le texte porte aujourd’hui encore les astérisques des censeurs en « guerre contre l’écrit » qui imposèrent des coupes, ce qui ne surprend guère à un si haut degré d’ambition, de liberté et de réussite. L’appétit de Djuna Barnes est sans bornes. L’enjeu n’est pas d’être auteur, ni même auteure. Bien plus radicalement, c’est de réinventer un monde, dont même le monde des lettres a privé les femmes. Les cinquante et un chapitres de Ryder, que Jean-Pierre Richard présente comme autant de nouvelles, jouent chaque fois une partition à part, empruntant forme et ton aux registres les plus divers, du conte à la fable, du drame à la farce, de la berceuse au rêve, sans oublier l’érotisme et l’ironie salace. Ils en appellent aux plus grands, Rabelais, Shakespeare, Tristram Shandy, Djuna Barnes assumant l’héritage avec une légèreté décomplexée. James Joyce, dont l’Ulysse est paru six ans auparavant, parlera de « l’inconnue la plus célèbre du siècle ». Ce monde littéraire sens dessus dessous signe la revanche écrasante des femmes qui emportent de haut la partie. À commencer par Sophie, la mère de Wendell, le fils cadet, héros oisif et débauché de Ryder. Elle « prenait sa Julie sur les genoux pour lui raconter mensonge sur mensonge, la conscience en paix, convaincue qu’elle était qu’on ne sert pas de réalisme à un enfant. Elle lui parlait de sa jeunesse et racontait, telle qu’elle ne s’était jamais passée, sa vie de jeune fille (…) “Ce que j’en invente témoignera aussi, et la vérité n’en sera que plus belle” ; ce qui fut le cas ». Cette vérité du mensonge est la morale de l’art, une science des âmes qui sort droit du laboratoire de la littérature. Djuna Barnes est morte dans un petit appartement de Greenwich Village en 1982. Elle passait son temps à écrire et réécrire des poèmes. Elle-même et tout entière dans l’obstination qui l’a fait survivre au Bois de la nuit et à Ryder, ses deux chefs-d’oeuvre. En 2011, Étienne Dobenesque avait déjà traduit pour Ypsilon Le Livre des répulsives. Le même éditeur annonce L’Almanach des dames, traduit par Michèle Causse l’année de la mort de Djuna Barnes, et des inédits. Le tout dans des volumes élégants illustrés de dessins de l’auteur, ce qu’il convient de saluer.