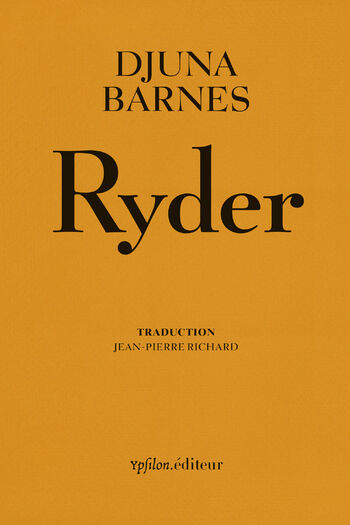1/05/2014
« Priape, au pied ! », par Éric Dussert
Réédition augmentée du premier roman de la « Lady of fashion », Djuna Barnes, brillant esprit libre des années 1920.
Les éditions Ypsilon reprennent le fil de l’œuvre de Djuna Barnes (1892-1982) par le début de la pelote : après Le Livre des répulsives, son premier livre de poèmes de 1915, c’est sa première prose de 1928, Ryder, qu’elles rendent à la vie dans une traduction complétée d’un préambule de l’auteur sur la censure et de quelques dessins. L’entreprise est louable car il reste à découvrir quelques beaux écrits de la « Lady of Fashion », pseudonyme qu’elle utilisa avec cet autre, Lydia Steptoe, au cours de sa carrière journalistique américaine (elle collabora à Vanity Fair et au New Yorker), carrière qui laissa à beaucoup le souvenir d’un esprit remarquable. La chronique a notamment retenu ce commentaire d’un homme lui avouant qu’une discussion avec elle lui provoquait des migraines… L’altière Djuna Barnes incarne la femme moderne et volontaire qui, dans la foulée de Virginia Woolf, Irène Hillel-Erlanger (Voyages en kaléidoscope) ou Raymonde Linossier (Bibi-la-bibiste), entreprenait avec Ryder de donner à sa fiction une forme nouvelle. Installée à Paris à la fin des années 1910, Djuna Barnes avait rejoint ces Américains « artistes » qui s’étaient exilés pour goûter les mœurs libres et l’intense activité culturelle de la capitale française. Elle y fréquenta natürlich Gertrude Stein, Natalie Barney, Sylvia Beach, ou James Joyce, et vécut une relation amoureuse avec la dévoreuse Thelma Wood durant un court lustre. L’aventure imprégnait son chef-d’œuvre Nightwood qui parut grâce à T. S. Eliot, amputé il est vrai, en 1936 à Londres, avec ses années houleuses et brillantes, pleines d’un panache unique. Traduit sous le titre de L’Arbre de la nuit par Pierre Leyris et reprit sans fin ni retouche, il constitua longtemps la seule pièce accessible en français de la talentueuse qui se fit silencieuse ermite jusqu’en 1958, date de la publication de sa pièce Antiphon (L’Arche, 1987).
Poète, nouvelliste ou romancière, Djuna Barnes reste une pièce essentielle du féminisme révolutionnaire ès-Lettres. Son Ryder en est une excellente démonstration qui dénonce chez elle et la fille d’un père volage aux mœurs fort malsaines et la lectrice très cultivée. Produit d’une époque qui s’affranchit des codes sexuels, elle dit dès ce Ryder, du nom de Wendell Ryder, personnage masculin central de ce roman familial dont le dessin tire à la satire écrasante — son principe tient tout bonnement du dieu Priape enconant à tour de membre les femelles du voisinage, sous l’égide de sa mère Sophie la raconteuse, y compris sa femme et sa légitime maîtresse —, son souhait d’une fable subversive qui saute les barrières morales, les menteries, la génération, la suprématie du mâle, ainsi que la forme romanesque traditionnelle dont la trame finit par apparaître après la mort d’Anatole France (1924). Pour retrouver in fine le régime biblique du flot de paroles de Rabelais et de Geoffrey Chaucer les vagues de fictions pendables, tout squelette autorisant la cristallisation de la matière vive du verbe ensemencé en littérature. « Car il faut que la nature tracasse les femmes d’une manière ou d’une autre, et quand ce n’est pas d’un bout, c’est de l’autre ; alors autant se préparer mentalement à recoller les morceaux, et à faire pas mal d’astiquage et de rangement, car je vois bien que je n’aurai pas mon mot à dire. »
Ryder avait tout de la satire mais aussi de la déclaration intime floutée — elle aurait été victime d’un viol — maquillée à larges coulées d’une encre inimitable. Au fond, ce roman des prémices est une geste combinée à une analyse dévoilée en chapitres fort peu chronologiques — au point que Jean-Pierre Richard se fend d’une postface de mise en ordre — laissant goûter la langue et forger une histoire de l’humanité depuis Noé où sont exprimés du mâle les horreurs et les inepties, et pour le reste, de tous la fantaisie.