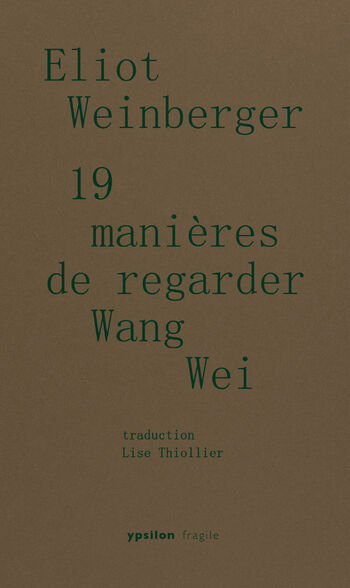1/06/2020
« Les belles apatrides », par Christine Plantec
Une réflexion vertigineuse sur ce que traduire veut dire, par Eliot Weinberger.
Soit un quatrain écrit il y a 1200 ans par Wang Wei (700- 761), poète et peintre de la prestigieuse dynastie Tang. Soit en 1987, la publication de 19 traductions du quatrain chinois à des époques et dans des langues différentes par le poète et essayiste américain Eliot Weinberger : 19 Ways of looking to Wang Wei. Soit en 2016, l’édition augmentée de 10 nouvelles traductions des pentasyllabes de Wang Wei comme si la tentative d’approcher le modèle d’origine ne devait jamais finir… Totalement absorbé par le sort réservé à ces « créatures » errantes que sont les traductions, Weinberger laisse non seulement libre cours à sa pente obsessionnelle — qui en l’espèce l’honore — mais il pose la question suivante : « Que se passe-t-il lorsqu’un poème, autrefois chinois et qui est toujours chinois, devient un poème anglais, français, espagnol ? »
Si le titre de l’ouvrage, littéral, expose le projet — 19 manières de regarder Wang Wei –, on constate assez vite que sous l’érudition des commentaires perce un auteur malicieux ne manquant pas de pointer les écueils et paradoxes de la traduction. Le principe de l’énumération chronologique peut paraître indigeste et pourtant c’est tout le contraire qui se passe. Le livre est un miracle d’intelligence, d’humour et de distance. L’air de ne pas y toucher, Weinberger dresse une histoire de la traduction dont les versions du poème de Wang, depuis 1919 jusqu’en 2006, rendent sensibles différentes tendances » : on y trouve les fidèles aux sources, les adeptes des notes de bas de page, les attachés au public cible. Il y a ceux qui se font un devoir d’« améliorer le poème d’origine », ceux dont l’ego se répand comme une flaque, ceux qui orientalisent le poème tel Witter Bynner qui, en 1929, « a l’air de regarder le monde (de Wang) à travers un voile d’opium reflété dans une centaine de timbales de vin ». Ainsi Weinberger parvient à montrer qu’on ne traduit finalement pas des langues mais des œuvres : « la traduction représente plus qu’un saut d’un dictionnaire à un autre ; il s’agit de ré-imaginer le poème ». C’est ce qui permit au bien peu sinologue Ezra Pound dans son recueil Cathay (1915) « de découvrir la matière vivante, la force du poème chinois » en l’actualisant dans une langue anglaise inventée sur mesure.
Rares sont ceux qui parviennent à tirer leur épingle du jeu. Nous en retiendrons trois : Octavio Paz, Gary Snyder et François Cheng. Et le fait qu’ils soient poètes dit non seulement un rapport singulier à la langue mais il souligne le fait que pour tout poète l’outil et la matière sont une seule et même chose. Or ce double usage simultané des mots est semble-t-il porté à son point d’incandescence dans la traduction.
Mais la jubilation que produit le texte de Weinberger est peut-être encore ailleurs. Construit comme un jeu de pistes qui élabore des possibles et confine au vertige, on s’égare, on croit retrouver son chemin, construire pour soi-même la traduction la meilleure, on y revient et ainsi de suite jusqu’à se dire que cette prose érudite nous mène au plus près de ce que traduire signifie et engage. Un long labeur de patience, d’humilité, d’effacement et de sensibilité car, en dernier ressort, il s’agit bien toujours d’y voir quelque chose, d’imaginer le paysage, la scène ou le moment. Il s’agit bien d’interpréter. « La poésie est ce qui mérite d’être traduit » annonce Weinberger. Et si — traducteur comme lecteur — nous savons bien que « le poème meurt quand il n’a plus d’endroit où aller », c’est sans doute parce que sans cette actualisation toujours recommencée du regard et la polarité intense qu’elle génère les mots sont lettres mortes.