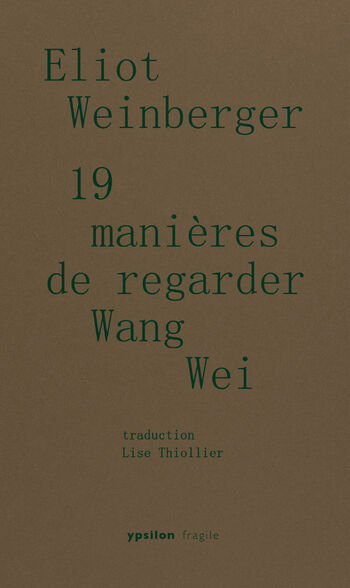5/06/2020
« (Notes de lecture) Eliot Weinberger, 19 manières de regarder Wang Wei », par Camille Loivier
C’est un livre remarquable que les éditions Ypsilon nous offrent, une fois de plus ; je voudrais le relire cent cinquante fois. Rien ne m’a plus enthousiasmée que de lire dix-neuf fois le même poème sans pourtant avoir l’impression d’en avoir fait le tour, mais au contraire, de chaque fois le découvrir, l’approfondir, c’est cela l’art de la traduction. Elle permet de multiplier à l’infini nos sensations, de les creuser, de les enrichir sans pourtant jamais épuiser nos ressources. Elle crée par multiplication sans copier, ni imiter, sans cloner, ni dupliquer ce que les techniques savent seulement faire. La traduction est par définition en marge de notre monde et la première phrase du livre « la poésie est ce qui mérite d’être traduit » devrait être peinte sur tous les murs. Elle remet les pendules à l’heure, on pourrait s’arrêter là, mais ce serait quand même dommage. Ce livre ne s’adresse pas aux érudits, il y a tellement d’humour et d’esprit dans ce livre, mais à tous ceux qui aiment écrire, lire, traduire, écouter, rêver, il doit en outre rendre accessible la poésie classique en mandarin à ceux qui l’ignorent encore.
Wang Wei est un des poètes les plus célèbres du VIIIe siècle, « regarder Wang Wei » nous indique d’emblée qu’étant poète et peintre, il est question, d’ailleurs, plus que de regarder, de « voir », donc d’expérience. J’ai lu la vingtaine de propositions de traduction du chinois classique vers l’anglais (français, allemand, espagnol) et sa restitution en français, (il faut saluer au passage la traductrice Lise Thiollier, car c’est une gageure) avec délectation, sans pourtant trouver, Octavio Paz s’en approche le plus, ce que je croyais y chercher, mais n’en est-il pas toujours ainsi ? Je me permets donc d’ajouter ma propre conception de la chose, qui vaut ce qu’elle vaut, et qui est redevable aux traductions de François Cheng sans pourtant qu’elles disent non plus ce que j’aie compris grâce à elles. Si dans le poème, il doit y avoir un « œil du poème », comme le pensaient les lettrés, autour duquel le reste tourne, ce serait pour moi le mot « fan » retourner, dont il est souvent question, avec son corolaire opposé et complémentaire au vers suivant « fu ». Octavio Paz souligne l’importance du parallélisme dans la poésie classique, il a raison, même si ici son rôle est ténu. « Fan », doit correspondre à une expérience liée au bouddhisme chan (zen) qui est un bouddhisme teinté de taoïsme, en outre approprié aux artistes, qui donc n’est pas que religion mais tout autant, expérience esthétique. Il me semble que le poème se comprend à partir de ce mot, seul. Et donc par un vécu ; je conseillerais donc à tout lecteur, en ce moment particulier mais en tout autre également, d’aller se promener dans une forêt quand il fait soleil, je pense qu’il comprendra parfaitement ce qu’a voulu dire Wang Wei avec sa lumière, ses ombres sur la mousse qui semblent poser tant de problèmes aux traducteurs, et qu’au retour, non seulement il appréciera mieux ce poème, mais il sera capable de composer une nouvelle traduction, car comme le dit si bien Eliot Weinberger « la grande poésie vit dans un état de perpétuelle transformation, de perpétuelle traduction : le poème meurt quand il n’a plus d’endroit où aller. » (p. 7)
extrait :
« Poésie parfaitement objective, impersonnelle, très loin du mysticisme d’un Saint Jean de la Croix, mais non moins profonde et authentique que celle du poète espagnol. Transformation de l’homme et de la nature devant la lumière divine, quoique dans le sens inverse de celui de la tradition occidentale. Au lieu d’humaniser le monde qui nous entoure, l’esprit oriental s’imprègne de l’objectivité, de la passivité et de l’impersonnalité des arbres, des herbes et des rochers, afin de recevoir, de manière impersonnelle, la lumière impartiale d’une révélation tout aussi impersonnelle. » (p. 40)