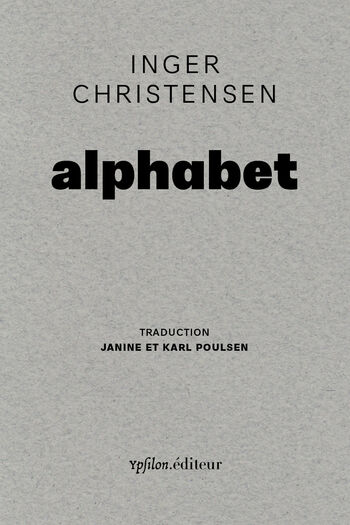18/02/2014
« Alphabet de Inger Christensen », par Emmanuel Requette
le premier néant décisif n’aura plus le droit d’écrire des poèmes comme le vent sait les écrire dans l’air ou dans l’eau
« Alphabet » est un recueil long composé selon un double modèle formel bien précis. D’une part, l’alphabet, comme son nom l’indique. D’autre part, la suite de Fibonacci. Bon l’alphabet, ça paraît simple. La suite de Fibonacci (du nom d’un mathématicien pisan du 13ème siècle), quant à elle, est une suite d’entiers dans laquelle chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent, dont le modèle est 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc… et dont la division d’un des termes par celui qui précède approche peu à peu du nombre d’or. Pour être clair, le premier poème du recueil commencera par la lettre « a » et comportera un seul vers, le second par la lettre « b » et sera fait de deux vers, le troisième par « c » et comportera 3 vers, et ainsi de suite.
j’écris comme écrit le cœur qui bat le cri du sang et des cellules, des visions et des larmes et celui de la langue
On s’en doute un peu, cette double structure n’est pas gratuite. Elle n’est pas là par souci de rigueur. Le cadre qu’elle offre n’est pas que contrainte visant, par la restriction qu’elle opère, à explorer mieux le champ qu’elle quitte. Cette double structure est elle-même un enjeu. Ainsi, le recueil ne poursuit pas sa logique jusqu’à z mais s’arrête à n, et la suite s’interrompt de même avec un poème de 377 vers. Ce qui nous est montré là est la faillite du rapport entre une suite finie (l’alphabet) et une autre infinie (la suite de Fibonacci). Mais également celle de toute logique face à la poésie. Ces effacements des structures mathématiques et alphabétiques sont là aussi pour dire que des méthodes supposées « calquer » la réalité pour mieux l’appréhender sont insuffisantes. Et cette place, c’est à la poésie de l’investir.
et les jardins existent, l’horticulture, les fleurs
du sureau pâles et immobiles comme un hymne
effervescent ; et la demi-lune existe, la demi-soie,
toute cette brume héliocentrique qui a rêvé
ces cerveaux dévoués, leur chance ; et la peau
Inger Christensen fait d’abord rythmer des vers incantatoires où peut se déployer tout l’espoir performatif du langage. Ce qui existe n’existe que par le dire. Ainsi de mots qui existent encore, que l’on utilise, que l’on dit, mais dont la réalité dont ils semblent provenir a disparu ou revêtu d’autres atours langagiers. Ainsi du mot arabe « al-barqouq » qui a donné « abricotier » en danois et signifie maintenant prune dans sa langue originaire. Et qu’est ce qui existe en nous quand nous disons « mésembryanthème » du mollusque ou de la plante que le mot désigne? En naviguant dans ces eaux d’un langage où dire ne se limite plus à représenter, Inger Christensen, si elle fait œuvre d’hermétisme, nous démontre que cet hermétisme est enfantin.
cette dernière écriture hermétique que seuls d’ailleurs les enfants écrivent.
Peu à peu, dans le corps du texte, la poétesse fait surgir l’exact inverse de ce qui en sourdait. En contraste parfait de la poésie du Logos originel survient ainsi cette bombe atomique, seule capable de détruire tout irrémédiablement. Et en faisant ainsi se côtoyer décomposition dans le texte et destruction dans le monde, Inger Christensen réalise sublimement ce leitmotiv que devrait chercher à atteindre toute poésie :
L’existence de toute chose est une apparition à chaque fois qu’un dire singulier en saisit l’universalité.