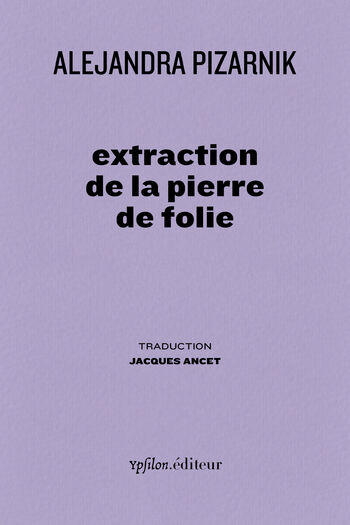10/04/2013
«Alejandra Pizarnik, pythie moderne», par Louise de Crisnay
Les éditions Ypsilon entame la publication de l’œuvre complète de la poétesse argentine disparue en 1972.
« Les métaphores d'asphyxie se dépouillent de leur suaire, le poème. La terreur est nommée avec en face le modèle, afin de ne pas se tromper. » Alejandra Pizarnik laisse sciemment les morceaux avariés gâter son poème. Le modèle est vicié, preuve qu'elle doit le racheter. Sinon rien : « CHERCHER - Ce n'est pas un verbe mais un vertige. Ça n'indique pas une action. Ça ne veut pas dire je vais à la rencontre de quelqu'un mais je suis gisante parce que quelqu'un ne vient pas. » Elle n'a pied que dans cette « urgence vide ». Il lui faut donc céder à «une mise en scène de plus», faire semblant de croire à des «métaphores d'asphyxie» et prendre parfois un faux départ, comme au début de «La parole du désir» («Cette texture spectrale de l'obscurité, ces mélodies au fond des os», etc.) pour ensuite écrire vraiment : «Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Il fait noir et je veux entrer. Je ne sais quoi dire d'autre. (Je ne veux pas dire, je veux entrer.)» Avant ce lieu, il y a un monde de métamorphoses qui exige de se faire «souffrir d'une manière aussi compliquée». Elle refait sur le papier les nœuds de cette «veille».
Failles. Figure majeure de la poésie argentine, suicidée en 1972, à 36 ans, Pizarnik est une sorte de Pythie moderne qui sape le mythe de l'inspiration. Mais ce n'est pas par défaut qu'elle consent à endurer l'attente, à consigner les moindres failles de ses états seconds, ses «offenses fantastiques», ses «fautes fantômes». L'impuissance à nommer et les tautologies qui en dépendent («Je désirais un silence parfait./C'est pourquoi je parle.») ne sont pas encore devenues, comme parfois aujourd'hui, des trucs poétiques usés jusqu'à la corde. L'impasse, chez Pizarnik, n'est pas une posture, encore moins le lot du paria. Au contraire, c'est le seul sujet digne, c'est-à-dire propre à réduire l'infernal écart avec les «cérémonies de vivre» : «Ame disjointe, âme conjointe, j'ai tant erré et vagabondé pour forger des unions avec l'enfant peint en tant qu'objet à contempler, et pourtant, après avoir analysé les couleurs et les formes, je me suis retrouvée faisant l'amour avec un garçon vivant au moment même où celui du tableau se mettait nu et me possédait derrière mes paupières closes.»
Inédits. Les deux éditions rassemblant les recueils parus de son vivant sont épuisées (Granit, 1984, et Actes Sud, 2005) et seule une partie de ses Journaux est disponible chez Corti depuis 2010. Pénurie qui a convaincu l'éditrice Isabella Checcaglini (Ypsilon), avec l'appui d'Anna Becciu, amie de Pizarnik et représentante de ses ayants droit, et du poète et traducteur Jacques Ancet, de travailler à la publication de ses œuvres complètes, prévoyant pas moins de quinze volumes en trois ans : nouvelles traductions et inédits.
Parmi eux, des textes écrits entre 1961 et 1972 ont déjà été réunis en novembre dans Cahier jaune, en référence au titre que Pizarnik donnait à ces proses jamais rassemblées de son vivant. Déjà, dans ses Journaux et les deux derniers recueils publiés avant sa mort, l'Enfer musical et Extraction de la pierre de folie, qui viennent de reparaître, Pizarnik, par «urgence vide», n'entend en fait rien d'autre que l'«urgence d'écrire en prose», que «les métaphores d'asphyxie se dépouillent de leur suaire, le poème». Obsession grandissante dans Cahier jaune et qui, sans doute, ne cessera de se préciser à mesure que sera traduite en français, en plus de deux nouveaux recueils, toute cette partie de son œuvre où il en est tant question : sa pièce de théâtre, l'intégralité de ses Journaux, ses essais entre autres sur Michaux, Breton, Artaud et d'autres textes inclassables, dont la très attendue Boucanière de Pernambouc ou Hilda la polygraphe. Pizarnik, comme le souligne Jacques Ancet dans sa postface à l'Extraction de la pierre de folie, a eu très tôt la si juste intuition que la poésie serait désormais l'«entre des genres», qu'il fallait à la fois «prosaïser le poème» et «poétiser la prose».
Génial. Autant dire être rongée par «la certitude d'une forme impossible de prose» et, en attendant, tordre le cou aussi bien au poème en vers, en prose, à l'aphorisme, au fragment, et même au conte, si elle se pique de tirer un cynique (mais génial) profit du Petit Chaperon rouge : «Mais le loup ne s'est pas déguisé en la mienne. La forêt n'est pas verte sauf dans le cerveau. Ma grand-mère donna le jour à ma mère qui à son tour me mit au monde, tout grâce à mon imagination. Mais là-bas, dans mon petit théâtre, le loup les dévora. Quand au loup, je le découpai et le collai dans mon cahier d'écolière. En somme, dans cette vie, on me doit le festin.»