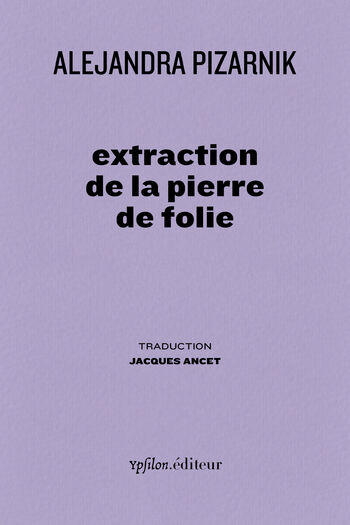1/05/2013
« Corps affamé », par Catherine Bédarida
Toute sa vie, Alejandra Pizarnik a combattu la folie avec les mots. Une voix toute en douceur déchirante.
Lorsqu’il découvre les poèmes d’Alejandra Pizarnik en 1974, le poète et traducteur Jacques Ancet est saisi : « Une voix se faisait entendre, une voix blessée, obscure et innocente à la fois. Et qui chantait. » L’auteure argentine (1936-1972) est alors inconnue en France, où elle a vécu quelques années de sa vie — une vie de souffrance, alcool qui apaise et détruit, hôpital psychiatrique, suicide. Alejandra Pizarnik naît à Buenos Aires, deux ans après que ses parents, juifs de Pologne, ont fui en Argentine. Les parents débarquent sans ressources, sans parler espagnol. Ils sont sans nouvelle de leurs familles, qui seront durement frappées par le génocide. « Je ne suis pas argentine. Je suis juive », écrit-elle dans ses Journaux (José Corti, 2010). Être juive, c’est appartenir à la même « maison » que Kafka dont, pendant un temps, elle lit un paragraphe du Journal par jour pour se donner des forces. Quarante ans plus tard, c’est l’œuvre de la poète qui manque de disparaître. Peu après sa mort, la dictature des généraux bigots s’abat sur l’Argentine. « Le cas de Jésus est tellement ridicule que je ne comprends pas sa popularité, fertile (maudite soit-elle) en guerres et en crimes », avait-elle noté dans son journal. Ses écrits, menacés, sont sauvés par son amie Olga Orozco et confiés à des proches, comme à la femme de Julio Cortázar qui emporte ses journaux hors du pays. Entre ces deux pôles tragiques, une œuvre éclôt, par besoin de vivre, survivre. « Je parle comme ça parle en moi. Pas ma voix qui s’efforce de ressembler à une voix humaine mais l’autre qui témoigne que je n’ai cessé d’habiter dans les bois », écrit-elle dans Extraction de la pierre de folie, un titre emprunté au tableau de Jérôme Bosch. Dans les années 1960, à Paris puis en Argentine, Alejandra Pizarnik rejoint les courants littéraires novateurs. Elle se trouve être contemporaine de Monique Wittig, dont le premier roman, L’Opoponax, salué par Marguerite Duras, paraît en 1964. Même rejet d’une frontière entre prose et poésie, même conviction que le langage est le lieu du combat, même refus d’une identité sexuelle assignée. Dans son journal, elle remarque : « Je crois que je [ne] connais pas [de] fille sans tendances homosexuelles et que je n’en ai jamais connue. » Un soir, après avoir passé la journée à attendre en vain la femme désirée, elle assiste à Ubu « par envie de voir massacrer, assassiner, exterminer et détruire ». Un court texte du recueil Cahier jaune enterre les classiques de la littérature lesbienne début de siècle. Au fil d’une scène où une jeune fille est violée par une « vieille à face de loup », elle expédie en quelques lignes « le décadentisme [...] à la Renée Vivien, à la Natalie Clifford Barney ». Homme ou femme, peu importe quand « notre besoin de tendresse est une longue caravane » et qu’elle prie de « faire l’amour pour être, quelques heures durant, le centre de la nuit ». Chez elle, domine le cri de la tendresse inassouvie, de l’amour déchiré, du corps affamé, assoiffé d’une totalité qui ressemble à la mort. Devant la faille originelle, il lui faut toujours revenir à la naissance, se faire renaître : « Il y a quelqu’un dans ma gorge, quelqu’un qui s’est conçu en solitude, et moi, inachevée, brûlant de naître, je m’ouvre, on m’ouvre, ça va venir, je vais venir. » (Extraction de la pierre de folie) La maison d’édition Ypsilon a entrepris de publier l’intégralité de l’œuvre d’Alejandra Pizarnik, devenue pour l’essentiel introuvable en français. Trois volumes viennent de paraître, douze autres sont en cours. Ypsilon a demandé une nouvelle traduction à Jacques Ancet, spécialiste de poésie argentine, qui a traduit entre autres Borges, Roberto Juarroz, Juan Gelman. « Je cherche à restituer toute l’intensité de cette oeuvre multiple, à faire connaître la face cachée d’Alejandra Pizarnik », explique-t-il. Il veut ainsi faire apparaître l’humour et l’insolence de la poète qui écrivait à 23 ans : « Je suis de celles qui font des moustaches à la Joconde. »