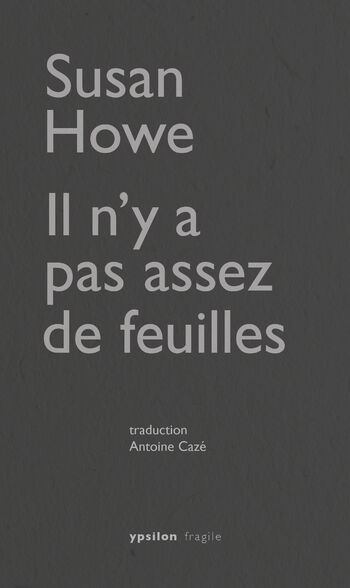24/11/2021
« Il n’y a pas assez de feuilles de Susan Howe », par Pierre Vinclair
Il n’y a pas assez de feuilles, le troisième volume de Susan Howe traduit par Antoine Cazé et publié par les éditions Ypsilon, n’a pas le même statut que Mon Emily Dickinson et La Marque de naissance, parus en 2017 et 2019. Si le livre ressortit bien, comme les précédents, à une forme d’« archéologie littéraire », pour reprendre l’expression du traducteur dans sa postface à La Marque de naissance (p. 317), celle-ci se donne non plus sous la forme de l’essai (fût-il très libre), mais du poème — ce qui implique un régime de lecture différent. L’extrait de correspondance privée donné en exergue de la postface le suggère : « Ce qui m’importe, écrit Susan Howe, c’est le son plus que le sens. Très profondément. J’accepterais une belle sonorité française dans n’importe quel mot — quelque chose qui donne la sensation d’un passé très profond qui résonne dans l’espace. » (p. 241). On mesure, avec une telle affirmation, la difficulté à laquelle fut confronté Antoine Cazé : toutes choses égales par ailleurs, la différence entre la poésie et les autres genres est sans doute que le poème réclame de son traducteur qu’il soit poète (c’est-à-dire, dans l’acte de traduction, en train de faire le genre d’opérations que fait un poète dans le poème : des jeux de mots, des allitérations, des parallèles, etc.), alors que ni le roman ni l’essai ne demanderaient l’équivalent (un traducteur de roman n’a pas à inventer d’intrigue ou se soucier de la cohérence des personnages, qui lui sont données ; de même l'organisation des idées dans un essai). Ainsi p. 37 de l’édition française, lorsqu’on lit par exemple « Écorcés soient mes bras mes cheveux soient feuillus // Fiancée soit mon arc ma lyre mon carquois », on se doute que cet « Écorcés » est la solution poétique à un problème de traduction. En l’occurrence, l’original dit : « Bark be my limbs my hair be leaf // Bride be my bow my lyre my quiver » (The Europe of Trusts, p. 17). On pense à Kurt Vonnegut dans Deadeye Dick : « “To be is to do”—Socrates. “To do is to be”—Jean-Paul Sartre. “Do be do be do”—Frank Sinatra. » Il n’y a pas là qu’une blague potache : en un certain sens, le poème est bien quelque chose comme le do-be-do-be-do du sens.
The Europe of Trusts, le titre original d’Il n’y a pas assez de feuilles : c’est-à-dire, comme le souligne Antoine Cazé dans sa postface, « l’Europe des confiances » mais aussi « l'Europe des Trusts » (responsables de la crise de 1929 et, par suite, de la guerre). Quelque chose qui serait à l’intermédiaire de l’histoire personnelle et de la tragédie collective. Le livre est composé de trois ensembles (d’abord parus séparément dans les années 1980, puis réunis en 1990 derrière un texte introductif intitulé « Il n’y a pas assez de feuilles pour couronner pour couvrir pour couronner pour couvrir » (« There are not leaves enough to crown to cover to crown to cover»), le tout lui-même précédé d’« Enfins » écrit par Howe à l’occasion de la parution française). Le premier d’entre eux, « Silence pythagoricien », mêle à un récit de la Deuxième guerre mondiale (le père de l’autrice y fut enrôlé) des considérations philosophiques arrachées aux pré-socratiques. Le deuxième, « Défenestration de Prague », se présente sous la forme d’un ensemble de fragments ponctionnés dans un traité de colonisation rédigé à la fin du XVIe siècle par Edmund Spenser. Le troisième, « The Liberties », tresse la biographie de la maîtresse de Swift, un récit autobiographique (la mère de Howe était irlandaise) et une réécriture affolée du Roi Lear. Trois manières d’articuler le privé et l’historique, l’Europe et l’Amérique, le poème et d’autres genres de discours. D’articuler : et de désarticuler.
La dernière phrase du texte de 1990 introduisant les trois parties, mettait en garde : « J’aimerais pouvoir tendrement faire sortir du côté sombre de l’histoire des voix qui sont anonymes, minimisées — inarticulées. » (p. 34). Si l’on comprend parfois ce qu’est en train de faire Susan Howe (comme lorsqu’elle entreprend l’ekphrasis de Melancolie de Dürer, p. 153-154 ; ou quand elle joue avec les mots implicitement contenus, « how », « no », etc., dans les lettres de son nom, p. 229), il est aussi de nombreux passages où, tout en admirant la virtuosité formelle de ses constellations de mots, on se trouve devant le poème comme une poule en face d’un couteau. C’est notamment le cas lorsque le vers se fait l’opérateur d’un refus ferme de la syntaxe, la page se donnant à lire telle une liste de propositions nominales abstraites, aux référents obscurs, les jointures en étant soustraites : « Espace-humain et espace nocturne / métaphorique // possession / cache-cache à la frontière // possibilité accomplie / carrefour au tournant // passe commence ciel et colore / Pour être sonore seul // hisse théorie et théorie […] » (p. 131). Si l’on se rappelle que Rancière, à propos de Mallarmé, distinguait « hermétique » (la signification se dérobe car une clé est cachée) de « difficile » (que l’on peut résoudre en faisant un effort de lecture), on comprend pourquoi Antoine Cazé parle de « poèmes hermétiques » dans sa postface (p. 247) : la prolifération des paratextes depuis les premières éditions des années 1980 (trois essais, dont l’un du traducteur) fournit d’ailleurs un ensemble de clés, capitales pour pouvoir apprécier les poèmes de Howe, à qui ne veut pas en rester à l’observation distancée, respectueuse, d’extravagances formelles (si celles-ci signent en effet la participation de l’autrice à « l’avant-garde » des années L=A=N=G=U=A=G=E, elles sont sans doute moins susceptibles d’intéresser à elles seules un lecteur se souciant moins d’histoire littéraire que de faire l’expérience de la vie du sens). Comme l’annonce par exemple « Enfins », le premier (dans l’ordre du volume) de ces paratextes (mais le dernier dans le temps), « The Europe of Trusts est mon moi irlandais maintenu à flot » (p. 27) : la désarticulation que propose Howe, loin de se cantonner à la dimension expérimentale d’un post-modernisme nihiliste, ou gratuit, vaut d’abord comme la tentative étonnante d’offrir dans l’étoffe même de sa propre existence la vie commune qui s’y entremêle, par des constellations privées (la règle de leur fonctionnement nous échappe) que les inconnus seraient invités à arpenter à leur guise, sur la page : la « sonorité de la pensée » (p. 33) rendue à l’espace — public — absolu.