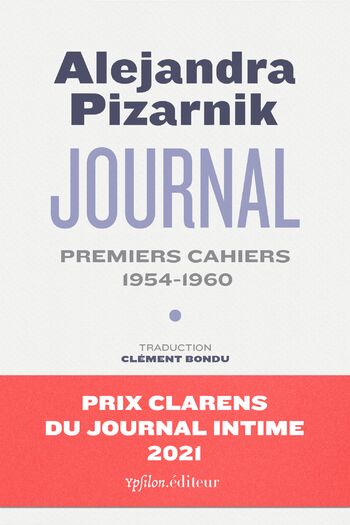17/06/2021
« Pizarnik : la musique de la douleur », par Thierry Clermont
« Je ne comprends pas comment les autres n’ont pas un terreur affreux (sic) du monde. J’ai peur des autres et de moi-même (…) Je voudrais vivre pour écrire. » Cet aveu en français, couché dans son Journal, en mai 1959, témoigne de ce que fut le destin d’Alejandra Pizarnik, morte à Buenos Aires, par suicide, en 1972, à 36 ans. La langue française, elle la connaissait bien et la chérissait, qu’elle perfectionna durant ses quatre années passées à Paris, au début des années 1960. Découverte de ce côté-ci de l’Atlantique en 2005 avec la parution de ses poésies complètes (Actes Sud), suivies de celle de son passionnant Journal (1959-1971) chez José Corti, Pizarnik occupe désormais la place qu’elle mérite dans le panthéon latino-américain. Aujourd’hui, les Éditions Ypsilon, qui ont publié tous ses recueils de poèmes, nous propose de découvrir son Journal de jeunesse.
Une œuvre singulière, saluée aussi bien par son aîné César Aira que par Mariana Enriquez et qui en son temps avait fasciné Julio Cortazar, Yves Bonnefoy, ou encore Mandiargues, qu’elle avait fréquentés à Paris, depuis sa chambrette de la rue Saint-Sulpice. Dans son oeuvre intime juvénile, elle nous dit à la fois tout son malêtre, ses ambitions littéraires, sa soif d’inconnu, alors qu’en 1960, elle a déjà publié trois recueils. L’année précédente, elle note : « La littérature c’est le temps (…). Et moi je hais le temps et je voudrais l’abolir. »
Une « folle mélancolique »
On la suit ici au fil des travaux et des jours, des nuits « aux crocs de loup », hésitante, exacerbée, l’âme à fleur de peau, obsédée par le vertige des sens. Elle lit plus que de raison, allant de Henry Miller, Virginia Woolf, Apollinaire, à Proust ou Kafka, en passant par ses compatriotes Bioy Casares et Alfonsina Storni, sans omettre Julien Green, les Journaux de Katherine Mansfield et Beauvoir avec qui elle se liera à Paris. Elle cite César Vallejo, Max Jacob, Rilke, Garcia Lorca, Mishima, Baudelaire, La Nuit obscure de saint Jean de la Croix. Attentive aux échos musicaux du monde, elle écoute aussi bien Piaf que Greco, Glenn Miller, Bach, ou encore le piano flamboyant d’Isaac Albéniz. Les exaltations sont entrecoupées de violentes périodes d’abattement, et tout cela nous est dit sans fard. À la date du 11 novembre 1955, on peut lire sous la plume de celle qui se disait une « folle mélancolique », malheureuse en amour, aussi bien avec les hommes que les femmes : « Une petite musique tourne et remue ma douleur. » Au printemps suivant, ce sera : « Je me console maintenant avec cet odieux cahier, ce Journal m’évoque de l’onanisme littéraire. »
Et quatorze ans avant sa mort littéraire, elle lâchera : « J’ai médité quant à la possibilité de devenir folle. Cela arrivera quand j’arrêterai d’écrire. Quand la littérature ne m’intéressera plus. De toute façon, cela m’est devenu indifférent de devenir folle ou pas, de mourir ou pas. » Le 25 septembre 1972, Alejandra Pizarnik est passée de l’autre côté du miroir. Découvrons-là, cette voix si touchante et particulièrement singulière.