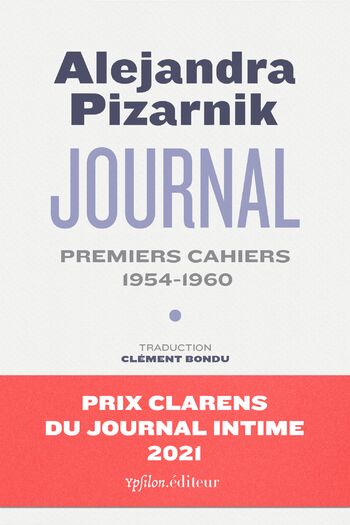1/03/2021
« Traduction / Sur quel texte travaillez-vous ? », par Clément Bondu
Portrait de l’artiste en jeune femme, Pizarnik a 18 ans quand elle commence à écrire le premier cahier de ce qui deviendra son Journal, sans qu’il soit possible de lui prêter au départ une quelconque velléité éditoriale (cela viendra assez vite). Au début, donc, tout a plutôt un air de défouloir. Cracher la rage, la souffrance qui est là comme depuis l’origine. Et puis, jouer à écrire, à penser, à construire sa vie avec ça, ou son rôle, c’est sans doute la même chose. Sans oublier cet humour acerbe, noir et joyeux qui, quoi qu’on dise, a de clairs accents argentins. C’est qu’il y a de la brillance là-dedans, et de la mise en scène, comme sur un théâtre, où il faut, parfois, avec la langue, avoir de l’éclat. On peut donc pardonner aisément à Pizarnik débutante certaines maladresses (s’il m’est permis d’en juger). Disons qu’à m’être confronté à sa langue, j’ai pu ressentir, voir, comprendre, traverser page à page ce qu’avait été pour elle la lente et difficile bataille menée, c’est-à-dire précisément celle du langage, du rythme, de la lucidité. Au long des carnets qui se succèdent, des années qui défilent, Pizarnik cherche à travers le langage une langue qui lui serait propre, une voix inédite, singulière, qui peu à peu, sans qu’on s’en rende compte tout à fait, advient. Et c’est à cela qu’on assiste. À la naissance d’une langue, d’un être, à soi. À ses métamorphoses. La place qu’y tiennent les rêves et la psychanalyse n’y est sans doute pas pour rien. Le journal est cette chambre où l’espace et le temps sont ouverts, offerts à l’inconscience, à la magie, à la sexualité. Car oui, fondamentalement, pour Pizarnik, la langue est sexuelle. C’est une chose « orale » avant tout. Il y a la bouche, les mains, les yeux. Ce qui écrit, touche, entend, regarde, désire, mange, comble. C’est avec la langue, avec l’écriture, qu’on pourra (peut-être) espérer répondre à ce « manque» qu’il y a là, quelque part en nous, celui que Pizarnik appelle la « carencia » : ce qui nous fait défaut, et qui a sans doute à voir avec l’imaginaire, le fantasme, la mémoire, l’invisible, ou comme dirait Marguerite Duras, avec la nuit1 .
En ce qui concerne mon travail, j’ai donc essayé, le plus possible, de rendre compte de cette oralité-là, de cette matérialité rythmique, physique, sensorielle, de cette voix. En essayant de ne jamais expliquer, ne jamais lisser, au contraire : garder les aspérités, les secrets, les ambiguïtés, les troubles, mais aussi l’ironie, la clarté, la netteté, la simplicité, quand elles sont là. C’est une bataille de chaque phrase, de chaque page. Car Pizarnik elle-même se bat avec la grammaire et la langue espagnoles, dans une tension permanente. Elle ne cherche pas à « bien écrire » mais à « écrire bien », c’est-à-dire de la seule manière possible et nécessaire pour elle, et qui n’est jamais donnée pour toujours, jamais gagnée, mais perpétuellement en train de se construire. Le journal, à cet égard, ressemble souvent à une sorte d’atelier, comme celui d’une peintre. Un espace sans contrainte où l’on peut se mettre à l’oeuvre d’une autre manière, en marge des livres aboutis, les poèmes travaillés, retravaillés, choisis, que Pizarnik (Flora Alejandra, puis Alejandra tout court) publie dans ces âges. C’est La terre la plus étrangère en 1955, La dernière innocence en 1956, Les aventures perdues en 1958.
Pour le reste, c’est l’incandescence. Pizarnik est à Buenos Aires, elle vit chez ses parents, puis elle est à Paris. Elle est étudiante, elle est écrivaine, elle travaille, elle vit. Le journal suit le passage du temps. Il en est l’archive, le témoin, et le sera jusqu’au bout. C’est cette épaisseur, sans doute, cette densité, qui lui confère sa force, comme toute oeuvre qui traverse la mort pour venir jusqu’à nous. Quant à la légende, elle tient en quelques mots. On sait de ces cahiers qu’ils ont fait leur voyage, passé de main en main, d’un continent à l’autre, traversé plusieurs fois l’Atlantique, échappé à certaine dictature, trouvé place pour un temps dans l’appartement de Julio Cortazar à Paris, puis dans celui d’Olga Orozco à Buenos Aires, finissant par échouer dans la bibliothèque de l’Université de Princeton, New Jersey, bien au chaud, à l’abri, avec ses manuscrits et sa correspondance : Pizarnik, Alejandra, « département des livres rares et des collections spéciales ». Le Journal rejoint alors ceux de Katherine Mansfield, de Julien Green, de Baudelaire, de Pavese, qu’elle cite abondamment parmi ses lectures. Et on peut donc penser que ça lui aurait plu de voir ses cahiers réunis pour devenir ce pavé de mille pages que sont les Diarios (1954-1971) en espagnol2 , elle qui rêvait tant d’écrire « en prose », d’écrire « un roman ». C’est de là que nous sommes partis, l’éditrice et moi, d’accord pour tout traduire, avec ses longueurs, ses contradictions, ses libertés. C’est d’ailleurs ce qui fait l’intérêt et la particularité des journaux, comme des correspondances : donner à entendre le trajet d’un être en entier, sans retouches, comme un grand, un furieux brouillon où la vie, le sexe, la mort, l’angoisse, le plaisir, l’inquiétude, la mélancolie, le rêve et la folie se mêlent à tel événement quotidien, tel détail, telle broutille dont on ne distingue pas vraiment si cela aura de l’importance ou non, et laquelle. C’est ainsi : on reçoit, on redonne, en vrac. Et la couleur du ciel, et la colère du jour, telle lecture, telle pensée, tel fragment de poème, sans accorder de valeur intrinsèque aux choses, sans se dire qu’il y aurait davantage de gloire à laisser derrière soi qu’on a passé la journée à lire Proust, ou à écrire des poèmes, que d’avouer qu’on s’est enivré dans une fête et qu’on a couché avec X ou Y. C’est l’image de nos vies. Personne n’en tient la vérité, pas même nous. Il faut tout prendre ensemble.