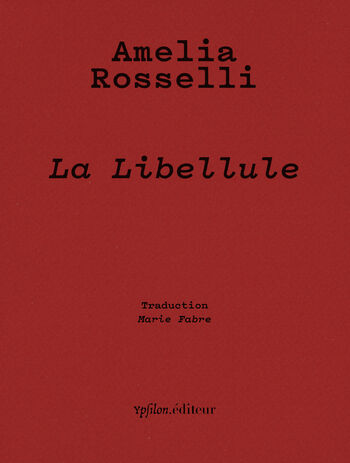16/05/2014
« D’une traite », par Sophie Ehrsam
La qualité d’un livre ne se mesure pas au nombre de ses pages. Témoins ce long poème d’Amelia Rosselli et ce récit en épisodes brefs Fabienne Swiatly, qui permettent en outre de relativiser le clivage habituel entre prose et poésie.
Les éditions Ypsilon publient, après Variations de guerre (QL n° 1070), une autre œuvre d’Amelia Rosselli1 . Il semble qu’elle ait voulu voir dans la « libellule » du titre un diminutif de « libelle » autant qu’un symbole de liberté ; l’image est aussi adaptée à sa poésie à la fois légère et féroce, équilibrée et insaisissable.
Malgré le foisonnement des images inattendues qui caractérisent sa poésie, Amelia Rosselli teste ici, comme le signale Marie Fabre dans la postface, une nouvelle métrique, avec des vers de longueur typographique similaire : le texte italien rend cela très visible grâce à une police où chaque caractère occupe le même espace, comme sur une machine à écrire. Il est question de renouveler la langue poétique : « je ne veux pas soupirer après la sénilité de langues toscanes ». Pour autant, l’héritage de voix anciennes n’est pas nécessairement absent ; le va-et-vient diffus entre une voix féminine et une voix masculine n’est pas une nouveauté puisqu’on le trouve, par exemple, dans le Cantique des Cantiques.
(…) Toi dissipe si tu peux
mon enfantinage ; toi dissipe si tu veux,
ou peux, mon enchantement de toi, qui n’est pas fini :
mon rêve de toi que tu dois forcément seconder,
pour diminuer. Dissipe si tu peux la force qui
me conjoint à toi : dissipe l’horreur qui me revient
vers toi. Laisse que l’ardeur se fasse miséricorde,
laisse que le courage se délite en tout petits
bouts, laisse l’hiver s’étirer important dans
ses cellules, laisse le printemps emporter la
graine de l’indolence, laisse l’été brûler
violent et sans prudence; laisse l’hiver revenir
défait et carillonnant, laisse tout — reviens
à moi ; laisse l’hiver reposer dans son lit
de fleuve à sec; laisse tout, et reviens à la
nuit délicate de mes mains. (…)
La Libellule puise aux sources habituelles d’Amelia Rosselli – une forme de pugnacité, une inventivité dans les sonorités, un univers où cohabitent anges et sirènes, lilas et machines – mais aussi à des poèmes existants. Nul besoin de les connaître pour succomber aux charmes de La Libellule, mais la postface indique ces trois influences, construites autour de figures féminines : l’Hortense de Rimbaud (poème « H. » des Illuminations), la chimère de Campana (poème éponyme du recueil Chants orphiques) et l’Estrina de Montale (poème « Fausset » du recueil Os de seiche).
La voix féminine, dominante, pourrait donc être celle d’une poésie moderne répondant à ces voix antérieures : le matériau d’hier est réutilisé, reconnaissable par endroits, multiple mais fondu au creuset d’une nouvelle intransigeance, qui recourt parfois pourtant à des outils similaires. Les formes insolites, archaïsantes, de la langue de Rosselli, par exemple, ne sont-elles pas du même ordre que les mots rares ou locaux, comme « clarteux » (dans « H. ») employés par Rimbaud ?
Laissons le dernier mot à Marie Fabre, tant il est vrai que le traducteur est le meilleur des lecteurs : « un conseil pour la première lecture : celui de lire le poème d’une traite, d’entrer dans le flux vertical de ses boucles hypnotiques, de se laisser investir par cette voix fluctuante qui cependant ne “lâche” pas, qui ne vous lâche pas, qui n’en a pas fini ».
La Fulgurance du geste2 , c’est une cinquantaine de « vignettes », sur chaque page étroite une poignée de phrases. Une histoire d’amour, avec toute la palette des émotions : désir, colère, ennui, désarroi, regret. Comme tant d’autres, et pourtant... Il faut une véritable création langagière pour la faire vivre, faire jaillir l’inattendu dans ce qu’on croit convenu, un savoir-faire proprement poétique. Peu de mots prononcés par le couple (bien ciblés : Fabienne Swiatly a aussi écrit du théâtre), le récit fait la part belle aux gestes, bruits, regards. Quelques lignes, un blanc, une dernière ligne brève comme un titre à l’envers.
Il voulait être plus fort que son refus. Elle, tout en longueur, si fragile dans son absence de chair pourtant la tête droite. Il ne se trouvait pas assez beau et distrayait son regard avec des phrases drôles, baissant la lumière pendant l’étreinte comme une jeune fille timide. Il sera le mail aimé mais c’est elle qui en souffrira. Héros pour une éternité de secondes.
Pire qu’un étranglement.
Dans cet univers de l’infime essentiel, un ou deux points d’interrogation semés au gré des pages suggèrent les premières discordances. Une page presque entièrement blanche signe le basculement dans l’histoire du couple. Les temps, utilisés d’autant plus parcimonieusement que les phrases nominales et et autres infinitives abondent, participent à l’intrigue : tout commence comme il se doit dans la fiction, avec de l’imparfait surtout, un peu de présent pour l’immuable ; après le choc de la page blanche, le présentfigure le réel auquel on se cogne, une forme d’hébétude, le passé composé vient sans cesse rappeler la coupure entre présent et passé. À peine un rai de futur sous la porte de la dernière page, obscurci par la toute dernière phrase : « Ce qui était prévu aujourd’hui ? »
La « fulgurance » est certes celle du geste fort qui fait basculer l’intrigue, mais aussi et surtout celle de l’écriture (contenu, cadencée, intense) et celle, souhaitons-le, de la lecture : d’une traite.