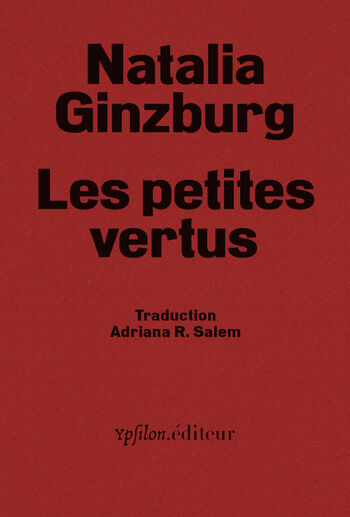1/05/2018
« Poésie réactive. Le métier d’écrire », par Céline Minard
Son métier est d’écrire, et comme pour Cesare Pavese, auquel elle consacre quatre pages aussi factuelles que touchantes, ce métier d’écrire est profondément intriqué au métier de vivre. Chacun des onze courts essais qui constituent Les Petites Vertus sont des morceaux de la vie de Natalia Ginzburg (1916-1991), de sa vie concrète, aux chaussures trouées, de sa vie d’enfant, d’adolescente, de femme mariée, d’exilée, de mère, et de sa vie spirituelle et littéraire en acte. Tout y est intime et distancé, pensé dans la langue avec une mesure de poète, sobre, une mesure d’avance.
La grande simplicité de sa prose est comme une eau vive, astringente, elle resserre les chairs. Son métier d’écrire est moral, éthique, il guide et tient sa vie, son rapport aux autres, au monde et avant tout à elle-même. Elle a pensé l’oublier, le mettre de côté, n’en plus vouloir mais il est revenu, elle a pensé s’en faire une consolation ou une distraction mais il s’est éloigné. Car ce métier n’est pas une compagnie, c’est un maître, « un maître capable de nous fustiger jusqu’au sang […]. Il nous oblige à ravaler notre salive et nos larmes, à serrer les dents et essuyer le sang de nos blessures, et à le servir. Le servir lorsqu’il le demande ». Et ce ne sont pas là des paroles de poète romantique, mais des faits.
Natalia Ginzburg a bien connu la douleur, comment aurait-elle pu y échapper dans l’Italie des années 1930-1940, en étant juive, communiste, antifasciste, mariée à l’éditeur Leone Ginzburg, juif, antifasciste, torturé et assassiné par la Gestapo dans les prisons de Regina Coeli. Elle l’a bien connue et se contente de la qualifier, « une vraie douleur, irrémédiable, incurable, qui a brisé toute ma vie », et d’admettre que son métier n’en est pas resté inchangé, qu’il lui faisait alors horreur, mais qu’elle savait aussi qu’elle recommencerait de le servir et qu’il la sauverait.
Honnêteté intraitable
Natalia Ginzburg ne pose jamais, elle affirme : « Sur la valeur de ce que j’écris, je ne sais rien. Je sais qu’écrire est mon métier », et toute sa force et sa puissance sont dans cette claire fermeté. Ni innocence ni regard détourné ni fausse pudeur, ces essais sont menés sous l’égide d’une honnêteté intraitable. Dans « Les rapports humains », l’avant-dernier texte du recueil, elle déroule les âges d’une vie qui n’est pas dite à la première personne du singulier mais du pluriel, « nous », parce que le « nous » lui importe, parce qu’il lui permet d’échapper au genre, aux contingences, et de faire apparaître un mouvement général de l’être humain, de l’enfance vers l’âge adulte. « Et maintenant nous sommes vraiment des adultes, pensons-nous ; et nous sommes surpris qu’être adulte soit cela, pas vraiment tout ce que, enfants, nous avions cru, pas vraiment une sûreté de soi, pas vraiment une sereine possession de toutes les choses sur terre. […] Nous sommes adultes par toutes les réponses muettes, par le pardon muet des morts que nous portons en nous. » Et au bout de cette « longue route qu’il faut parcourir pour avoir un peu de pitié », elle sait de quoi est faite la beauté poétique et qu’il n’y a qu’une façon d’aider les autres dans la recherche d’une vocation, « c’est d’avoir nous-mêmes une vocation, la reconnaître, l’aimer et la servir avec passion : parce que l’amour de la vie engendre l’amour de la vie ».