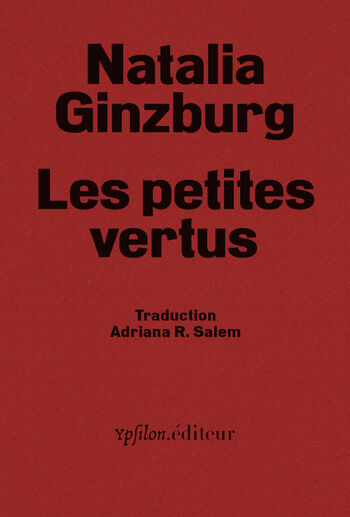2/05/2021
« Petites vertus de Natalia Ginzburg », par Pascal Gibourg
« Une maison n’est pas très solide. Elle peut s’écrouler d’une minute à l’autre. » — N. G.
Il n’y a encore que très peu de temps, je ne connaissais pas Natalia Ginzburg. Je ne dirai pas que je la connais, mais enfin je la lis. Je la découvre au travers des Petites vertus que vient de publier Ypsilon. A chaque texte, chaque page, chaque phrase, chaque mot, j’apprends à la connaître un peu plus, un peu mieux. Les petites vertus se composent de onze histoires, regroupées en deux parties. Je mentirais si je disais que je commence cet article comme il se doit, après avoir lu l’entièreté de cet ouvrage. Je viens seulement d’en finir la première partie. Mais pourquoi résister au désir de partager une découverte ?
L’écriture de Natalia Ginzburg est très belle, précise, simple, tranchante et drôle. Sa personnalité affleure à la surface de ces textes, j’ignore s’il en est toujours ainsi, ces écrits ayant une dimension autobiographique qui les rend proches. Ils ont été écrits entre 1944 et 1960, c’est dire que le monde qu’ils dépeignent - que ce soit un village perdu des Abbruzes ou la ville de Londres - n’existe plus, plus pareillement du moins, même si ce qui traverse un paysage - un sentiment, une intuition - perdure comme perdure l’effet causé par un traumatisme ou par une rencontre déterminante.
Natalia Ginzburg est italienne. Est-ce à dire que mon plaisir vient en partie du fait que j’entends quelque chose de l’italien dans le français ? Que quelque chose de sa voix et de son accent passe dans la traduction d’Adriana R. Salem ? Et sur quoi pourrais-je me fonder pour dire cela ? Sur l’oralité. Dans la préface à la traduction de la Nuit obscure et du Cantique spirituel de Jean de la Croix qu’il a donnée, Jacques Ancet définit l’oralité comme une forme d’indicible, plus précisément comme un « dire de l’indicible ». Ce n’est pas à proprement parler une musique, encore moins une idée. C’est quelque chose qui se perçoit à travers une écriture mais sans se réduire à ses composantes rythmiques, sonores ou signifiantes. Ancet parle d’une présence ou d’un effet de l’ « autre » qui hanterait le texte. Présence de l’italien dans le français, de Natalie Ginzburg dans le travail de traduction d’Adriana R. Salem ou bien encore de cette altérité présente dans le texte original et qui aurait migré dans la traduction - cette altérité propre à chacun par laquelle on se découvre en se transformant.
Dans un texte savoureux - on trouvera beaucoup de délicatesse et de saveurs dans ce petit livre aux allures de bréviaire, de goûts multiples, de sensations physiques, entendu que c’est principalement cela les petites vertus, les vertus du sentir, ses forces, ses puissances1 - qui s’intitule Les chaussures trouées, on peut lire ceci :
« Mon amie a un visage pâle et masculin, et elle fume avec un fume-cigarette noir. Lorsque je la vis pour la première fois, assise à une table, avec ses lunettes cerclées d’écaille et son visage mystérieux et méprisant, avec son fume-cigarette noir entre les dents, je trouvais qu’elle ressemblait à un général chinois. Je ne savais pas alors qu’elle avait des chaussures trouées. Je l’ai su plus tard. »
Grâce de la description, avec cette reprise habile du fume-cigarette qui devient de ce fait l’attribut de l’amie comme l’arc et les flèches le sont pour Diane. Bonheur de cette comparaison aussi, si bien amenée, surprenante, irrésistible, extrayant le comique du sinistre, et ce grâce à l’amitié - car c’est ce sentiment qui permet à ce portrait d’être à la fois sans aménité et plein de tendresse. Outre la beauté simple et presque évidente de cette écriture, c’est ce mélange de cruauté et d’affection qui caractérise souvent le regard singulier de cette auteure. On pourrait dire : cette vision des choses est très subjective ; mais je ne suis pas loin de penser le contraire : la pertinence d’un regard procède de l’observation, et plus celle-ci se fait attentive, plus la chose considérée apparaît dans son objectivité ; et plus le pli de l’écriture sera net, marqué, ici proche de la caricature sans cesser d’être juste. Il y a sans beaucoup de généraux chinois autour de nous, mais nous ne les voyons par car nous ne savons pas regarder.
Le portrait que Natalia Ginzburg fait de Londres et de l’Angleterre est également saisissant. Elle a une intuition : c’est que la tristesse londonienne est l’expression d’un dégoût alimentaire tout entier résumé en un mot : « food ». Son texte est très convaincant. Londres a changé, c’est incontestable, mais il est à craindre que bien des maux anglais viennent encore de ce petit mot désignant non pas tel ou tel met mais la nourriture en général, la nourriture en vrac. Une observation nous arrache un éclat de rire, puis s’en s’ajoute une autre, ensemble elles se liguent et à force d’humour s’impose une évidence : on ne mange pas en Angleterre, on se nourrit. On voudrait que ce soit faux mais ayant acquiescé au fur et à mesure de la démonstration on ne peut plus que se réjouir d’une chose : ne pas habiter Londres, ne pas être anglais.
Remarquable est aussi l’aptitude qu’a l’écrivaine à régresser dans un état enfantin doublé d’une acuité analytique de haut vol. Cette quête éperdue du bonheur à laquelle personne n’échappe, je paraphrase Rimbaud, est décrite dans le texte qui s’appelle Les rapports humains avec un sens du concret qui nous replonge immédiatement dans les affres de l’enfance et de l’adolescence. Oui, notre passé affectif est là, même si on ne veut pas toujours s’en aviser. Par ailleurs peu d’auteurs savent vraiment parler de l’enfance - je pense à Valéry Larbaud, à Henry James -, Natalia Ginzburg y parvient avec une aisance déconcertante. Le point de vue qu’elle adopte dans ce texte - la première personne du pluriel - ajoute à ce composé mystérieux qu’est la rencontre ratée ou réussie de l’amour (la réussite est de toute évidence plus mystérieuse que l’échec, malheureusement commun, même si les pouvoirs de l’illusion sont toujours surprenants). « Un jour nous rencontrons la personne parfaite. Nous restons indifférents parce que nous ne l’avons pas reconnue. […] De temps en temps, distraitement, nous nous demandons si nous ne sommes pas en train de nous promener avec la personne parfaite : mais nous croyons plutôt que non. » Admirable aplomb de la réalité qui ne demande pas même à être crue, sûre qu’elle est de devoir s’imposer avec le temps.
Je ne vais pas énumérer toutes les richesses que contient ce livre, ce serait presque indécent. Je voudrais toutefois, au moment de conclure, dire un mot de son aspect physique. Son format, plutôt petit, est idéal, son compacité attachante. Le grain de sa couverture est une invitation à la sensualité, il est doux à caresser, agréable à tenir en main. Sa couverture d’un rouge profond indique qu’il renferme quelque chose de précieux qu’il faudra cependant aller quérir (joie des profondeurs). Enfin, le lettrage rond et ventru, ainsi que cet adjectif « petites » écrit avec de grosses lettres noires prenant beaucoup de place, invitent à voir dans cette typographie cette part d’enfance et de jeu qui circule dans ces textes, car si Natalia Ginzburg ne craint pas de dévoiler ce que l’existence a de grave et d’attristant, elle ne le fait jamais sans greffer sur ce constat parfois amer un sourire doux, parfois grinçant, comme peut l’être un vieux portail ouvrant sur des trésors enfouis. C’est ainsi que la tentation de gâcher sa vie se trouve contrebalancée par les petits plaisirs de l’existence et qu’à la solitude s’ajoute l’amitié ou la vie de famille. Natalia Ginzburg était mère de trois enfants, son métier fut d’écrire, et même lorsqu’elle n’écrivait pas ce métier veillait sur elle, car il continuait de se nourrir d’elle et de ses expériences, il continuait de croître en elle à la manière d’un arbre sous lequel s’abriter. Dans la vie de tous les jours, l’écrivaine avoue une certaine timidité, matinée d’audace cependant, mais quand elle écrit, elle est à l’aise, elle n’envie plus personne, et ceci indépendamment de la question de la valeur de ce qu’elle produit. Sur ce dernier point elle peut être rassurée et ses lecteurs et lectrices la remercier. C’est ce que modestement les mots que je viens d’écrire voudraient être, par delà le temps et l’espace : l’expression d’une gratitude.
- Dans le texte qui s’intitule Les petites vertus et qui se situe à la fin de l’ouvrage, l’expression de « petite vertu » s’oppose à la notion de « grande vertu », comme le sens de l’économie par exemple, proche de l’avarice, s’oppose au sens de la générosité. Il a donc un sens nettement péjoratif. En tant que titre de livre l’expression « petites vertus » change néanmoins de sens. En effet, elle doit pouvoir s’appliquer à tous les textes et donc viser en eux ce qui les caractérise communément tout en les distinguant. Plus que les grands sentiments ce sont je crois les petites perceptions qui sont au cœur de l’écriture de Natalia Ginzburg, raison pour laquelle je crois pouvoir reconnaître dans ces petites vertus non seulement les puissances de sentir de l’auteure mais l’ensemble de ces forces qui détermine un regard et forge une sensibilité. ↩