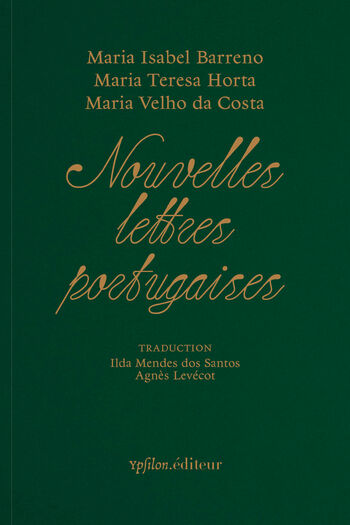10/07/2025
« Sororité, j’écris ton nom ! », par Sonia Da Silva
Nouvelle traduction de Novas cartas portuguesas, un livre qui à sa publication en 1972 posa une pierre angulaire du féminisme.
En mai dernier, alors que le Portugal connaît une inquiétante avancée de la droite à la suite d’élections législatives anticipées, les éditions Ypsilon font symboliquement barrage à l’intolérance et à l’extrémisme en publiant, en France, une nouvelle traduction de Novas cartas portuguesas (1972), livre-manifeste contre toutes les formes d’oppression signé par trois femmes. La publication de Novas cartas portuguesas dans une nouvelle traduction d’Agnès Levécot et d’Ilda Mendes dos Santos résonne de manière troublante en ce qu’elle remet au goût du jour, par ces temps incertains, une œuvre universelle des plus innovatrices, subversives et fondatrices de la littérature du XXe siècle.
Faisons un saut d’un demi-siècle en arrière pour situer la genèse de ce livre. Portugal, 1971 : l’intrépide poétesse Maria Teresa Horta (1937-2025) vient de publier « Minha Senhora de mim ». Ce recueil de poésie, qui célèbre le corps, le désir et la sexualité féminine, est jugé pour le moins inconvenant par le régime salazariste, qui d’emblée le censure. Le pays, très patriarcal et rétrograde, est toujours sous dictature et la liberté d’expression tout sauf un droit acquis. Sa posture de femme affranchie et d’autrice irrévérencieuse vaut à Maria Teresa Horta cette année-là un flot de menaces, d’insultes et même des agressions. Un soir, alors qu’elle rentre chez elle, une voiture fonce sur elle. Elle réussit tout juste à éviter le choc mais trois hommes sortent du véhicule, l’empêchent de fuir et la rouent de coups alors que l’autrice au physique si frêle est déjà à terre. Au cours de sa carrière littéraire, elle n’aura de cesse de rappeler cet épisode funeste : « J’ai été battue par trois hommes qui m’ont dit, tandis qu’ils me cognaient la tête contre le sol : “Ça, c’est pour que tu apprennes à ne plus écrire comme tu écris…” ». Maria Teresa Horta a survécu aux coups et s’est redressée avec une fureur redoublée.
« Faire bloc de notre corps »
Quelque temps plus tard, elle retrouve deux amies et consœurs qui se démarquent tout autant par des postures militantes et des écrits préconisant l’émancipation de la femme : il s’agit de Maria Isabel Barreno (1939-2016) et Maria Velho da Costa (1938-2020). Dotées d’une grande conscience politique, les trois jeunes insoumises, mariées et mères de famille, usent de leur plume pour refuser la terreur, l’injustice et la guerre coloniale. Un jour, alors qu’elles s’interrogent sur la manière de poursuivre leur combat « moins seules et moins désemparées », Maria Velho da Costa échafaude un plan : écrire un livre à six mains ! Si le livre d’une seule autrice peut causer autant de répression et de couardise, que peut bien déchaîner un livre écrit par trois femmes ?, demande-t-elle. La tonalité de la première lettre est donnée : « De nostalgies seules nous ferons une sororité et un couvent. « Soror » Mariana aux cinq lettres. De vengeances seules, nous ferons un Octobre, un Mai, et un mois nouveau pour couvrir le calendrier. Et de nous, que ferons-nous ? ». C’est en ces termes programmatiques que les trois complices se lancent dans une entreprise collective des plus singulières sous forme d’un échange épistolaire qui durera neuf mois…
Dans le sillage de Mariana Alcoforado
Pratiquant des genres littéraires distincts, elles décident de s’écrire à tour de rôle une lettre par semaine — mais en toute liberté formelle. Elles s’inspirent des Lettres portugaises publiées en 1669 et marquées par la voix plaintive de Mariana Alcoforado. Cette jeune religieuse portugaise cloîtrée dans un couvent de Beja sombre dans une tristesse abyssale après le départ d’un officier français dont elle est tombée amoureuse. Pourquoi prendre pour référent ce livre vieux de trois siècles ? Parce qu’il est le fait d’une religieuse qui a eu un amant et a écrit sur cet amour interdit, et ce faisant a abordé des thématiques qui continuent d’une actualité brûlante : passion et abandon, claustration féminine et acte d’écriture, cause nationale et épanouissement personnel, guerre territoriale et paix intérieure, ordre moral et tabous… Autant de thèmes à partir desquels travaillent avec ferveur les trois autrices qui se retrouvent tous les mardis dans un espace public pour déjeuner et parler de tout sauf de leur projet littéraire, puis se réunissent tous les vendredis soir au domicile de l’une d’elles pour présenter et discuter la lettre de la semaine et en remettre une copie aux deux autres afin de nourrir le propos et de poursuivre l’échange.
Un chœur anonyme
Le corpus des Novas cartas portuguesas — un ensemble composite de 120 textes datés mais non attribués — est constitué de poèmes ; de lettres fictives d’antan en résonance avec la vie de Mariana Alcoforado ; de lettres fictives sur les préoccupations de leur temps comme la guerre coloniale, le patriarcat, la répression, l’émigration ; de brefs essais sur ces mêmes thèmes ; d’autres ébauches libres. Hybride, cet ensemble est littéralement sui generis en ce qu’il fait fi de toute règle de construction, répondant uniquement à un fil chronologique linéaire, celui de la production des lettres en temps réel. Expérimental, il se veut à la fois réflexif et ironique, faisant la part belle à la citation, au pastiche, à la réécriture, à l’auto-dérision. Enfin, les trois Marias écrivent avec la volonté d’indisposer le lecteur en posant la question de la place qu’on nous assigne — sur le plan politique, social, sexuel, conventionnel, etc. « …à Beja ou à Lisbonne, derrière des murs chaulés ou sur les chaussés, il y a toujours une clôture prête pour qui tient tête aux usages. »
En avril 1972, l’ouvrage est publié tel quel par Estúdios Cor dont la directrice littéraire n’est autre que Natália Correia, figure sulfureuse de la scène littéraire portugaise qui, pour avoir organisé une volumineuse « Anthologie de la poésie portugaise érotique et satirique » publiée en 1965, connaîtra un retentissant procès pour atteinte à la morale. Il en sera de même, sept ans plus tard, avec la publication de Novas cartas portuguesas. L’édition est saisie et détruite peu de temps après sa diffusion par la censure du Estado Novo et les trois autrices sont poursuivies en justice pour avoir prémédité l’écriture d’un livre dont le contenu est jugé « malsain, pornographique et attentatoire à la morale publique ». L’affaire est grave : elles risquent la prison, qu’elles évitent contre paiement d’une importante caution. D’abord interrogées individuellement par la police politique puis appelées à se justifier devant les tribunaux, elles ne briseront jamais le pacte scellé en amont de leur entreprise, à savoir taire à jamais la source auctoriale des différents textes. Le procès s’ouvre le 25 octobre 1973 mais, reporté à plusieurs reprises, il sera classé sans suite le 7 mai 1974, au lendemain de la Révolution des Œillets.
Une réception contagieuse
Entre-temps, le scandale médiatique autour du procès dit des « Três Marias » déclenche un mouvement sans précédent. Des manifestations de soutien ont lieu ici et là, le procès est couvert par la presse internationale et plusieurs féministes protestent aux portes des ambassades portugaises à l’étranger. En France, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Delphine Seyrig et Christiane Rochefort s’en émeuvent, la féministe Monique Wittig se voit confier la tâche de co-traduire le livre (Seuil, 1974) et le mouvement de solidarité s’amplifie partout jusqu’à gagner en juin 1973 une visibilité planétaire avec la conférence de la National Organization of Women (NOW) à Boston, qui fit voter une motion en faveur de cette affaire devenue première cause féministe internationale. Cette traduction, remarquable en tout point et plus particulièrement en ce qu’elle contient un riche appareil critique, est dotée d’une introduction par Ana Luísa Amaral, poète portugaise et infatigable chercheuse à qui l’on doit une édition annotée des Novas cartas portuguesas en 2010, puis, quatre ans plus tard, une large étude sur le retentissement international de ce livre Novas cartas portuguesas. Entre Portugal e o Mundo (2014). La traduction reprend la très éclairante note des autrices de 1975, qui reviennent sur la genèse du projet et dont la réception a été, selon leur propre appréciation, « au-delà de nos craintes et de nos attentes ». En fin d’ouvrage, le lecteur lira avec intérêt la « Note à la première édition française » par Évelyne le Garrec et Monique Wittig (1974), ou encore l’éclairante postface d’Agnès Levécot et Ilda Mendes dos Santos sur la postérité de cette « CHOSE » — c’est en ces termes que les autrices ont désigné leur travail collectif. Enfin, de précieuses notes des traductrices rassemblées en fin d’ouvrage viennent contextualiser des termes ou justifier des choix. Cette œuvre, historique et inclassable, inaugure une poétique de la résistance sororale inédite et résonne aujourd’hui de manière toujours aussi vibrante par les éclats incantatoires qu’elle offre. Terminons en citant ce pied de nez tiré de la troisième lettre finale : « Ah ! mes sœurs, mais qu’est-ce qu’on a ri. »