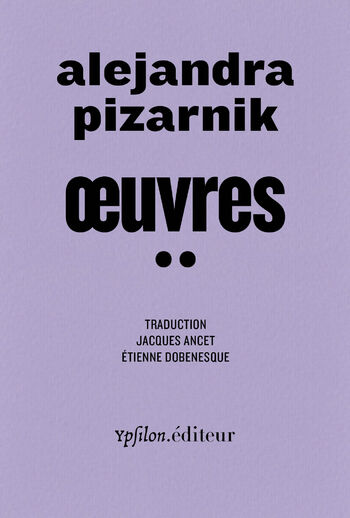23/06/2024
« Alejandra Pizarnik, et tout se tut », par Loutch
Dans la rue Montevideo, à Buenos Aires, se chevauchent des voitures et des piétons, des bâtiments modernes et des immeubles qui transpirent un XIXe siècle parfois désuet d’ornements, parfois génialissime de façades pittoresques. La rue est un maelstrom architectural qui ressemble plus à une hallucination mezcalienne qu’à un chef-d’œuvre d’harmonie florentine. Son agencement traduit l’amoncellement de décennies de conventions esthétiques disparates de manière si paroxystique qu’on croirait une image pédagogique pour mieux les comprendre. Un bâtiment de la Western Union Company, construit en baies vitrées, se déplie en face de l’université de Salvador, élevée en briques saumon, de taille beaucoup plus modeste, et ce à côté d’une enfilade de bâtiments de style européen, parfois lisses et bétonnés, d’autres fois pierreux et caviardés d’aspérités. Un peu plus loin — la rue est longue — se mirent un haussmannien, tressé de balustres et de balcons à joues, et des appartements fonctionnels, reconnus dans le monde entier pour leur diplomatie taciturne. Quelques arbres penchés servent de virgules d’ombre tous les quelques mètres où marcheurs et cyclistes se chamaillent pour l’étroit trottoir enjambé par la piste. La rue est immense qui voit des lignes électriques passer au-dessus, enroulées dans les branches, tenues aux poteaux qui lorgnent sur les balcons où s’accoudent quelques habitants égayés par le tintamarre quotidien de l’haleine vitale qui sourd ici, qui est un bruit pour l’oeil, une chanson pour tout curieux. La rue Montevideo est longue et exigue, son écho est celui d’une gorge nouée. Elle a l’océan non loin qui l’aborde.
En 1968, alors que la rue devait être semblable à tout autre chose, une jeune femme s’en vient habiter au numéro 980. Elle a 32 ans et fait de son nouveau logis un atelier poétique constellé de cartes, de petits papiers, d’écriteaux, d’un tableau sur lequel elle écrit à la craie. Le lieu est le premier véritable endroit “bien à elle” de son existence. Il lui vient de sa mère et de l’héritage perçu à la mort de son père quelques années plus tôt, mort qui, le jour où elle survint en janvier 1966, inspira une phrase typique de la claustration lapidaire de la poétesse :
« Papa est mort. »
Deux années après, elle s’établissait dans le prime lieu de sa deuxième vie, celle d’après la jeunesse, et ce lieu était ce petit écrin de deux pièces de la rue Montevideo, où Alejandra Pizarnik avait laissé visible et bien écrite cette phrase d’Antonin Artaud :
« Il fallait d’abord avoir envie de vivre. »
Pizarnik figure au milieu d’un indénombrable corum d’exégètes aujourd’hui. En Argentine, elle est identifiée comme l’ultime poète maudit par beaucoup, quand d’aucuns trouvent l’appellation réductrice et galvaudée par de trop simplistes analogies biographiques avec d’autres écrivains saturés de neurasthénie.
Sa naissance à Buenos Aires en 1936 la conduisit jeune dans un monde littéraire déjà âgé, qui réinventait ses avant-gardes pour en préserver la modernité ; paradoxal cheminement qui s’égrena dans le monde entier, qui voulait que l’aspect novateur soit consolidé et continu, de sorte que l’avant-gardisme devait rester d’avant, même après. Introduite dans les milieux littéraires son adolescence à peine évincée, par le biais de son professeur de Lettres Juan Jacobo Baraglia, alors qu’elle étudiait par alibisme la littérature, la philosophie et le journalisme, Pizarnik fut publiée très tôt, en Espagnol, qui fut sa langue d’œuvre et de parole sans être sa langue maternelle. Cette dernière, le yiddish, parlée par ses parents exilés d’Ukraine en Argentine dans les années 30, s’insinua dans sa poésie à travers quelques résurgences thématiques, sans emploi direct, puis dans son journal, où elle se souvient de chansons d’enfance, d’airs qui lui importent par séquences, achevés d’être les marques d’états mélancoliques. Ana Becciu, qui la connut, parlait de sa langue mi-disparue sur France Culture, il y a quelques jours :
« C’est sûr que cette enfance était marquée par ce paysage culturel, et qui a marqué aussi, plus tard, sa poésie. Sa langue poétique est teintée de ces deux langues : l’espagnol, mais surtout le yiddish.
En 1955, donc, paraissait son premier recueil, La terre la plus étrangère, signé du nom de naissance juxtaposé au nom d’autrice, qui, plus tard, deviendrait le seul autographe. Flora Alejandra Pizarnik intégrait la littérature livresque grâce — comme le précise César Aira, qui lui a consacré diverses études — au financement de son père. Pizarnik était alors, elle le serait toujours, préoccupée par son corps, son asthme, son bégaiement intempestif, ses crises d’acné, son poids, mal-être qu’elle compensait par une médication constante, faite d’amphétamines, d’antalgiques et d’analgésiques. La présence impondérable des douleurs corporelles l’endolorit sa vie durant et assiégea son écriture d’une tranchée métaphorique inexorable, qui faisait de l’adolescence du corps un spectre persécuteur, indépassable, et des médicaments un contrepoids essentiel, dont, jusqu’à la fin de ses jours, elle ne fit jamais l’économie. Ainsi du contexte d’émergence de ce premier recueil, imprégné par ses accointances littéraires, bientôt amicales, avec le surréalisme, qu’elle ne reniera jamais — son livre préféré parmi tous demeurera Nadja d’André Breton — et innervé par ce premier rapport au corps, lyriquement retranscrit dans ces premiers poèmes qui gravitent autour, notamment, du regard, de ce qui, accessible aux yeux, meurt en soi-même. Réminiscences :
« et le temps a étranglé mon étoile
quatre nombres tournent insidieux
en noircissant les confitures
et le temps a étranglé mon étoile
elle allait rebattue sur un puits obscur
les éclats pleuraient mes verdeurs
et moi je regardais je regardais
et le temps a étranglé mon étoile
rappeler trois rugissements
de tendres montagnes et rayons obscurs
de coupes jaunes
deux gorges râpées
deux baisers communicants de la vision d’
une existence à une autre existence
deux promesses gémissantes d’
effroyables et lointaines loquacités
deux promesses de n’être pas de n’être pas
deux rêves jouant la ronde du destin tout
autour d’un cosmos de
champagne jaune blanchâtre
deux regards assurant l’avidité d’une
étoile toute petite
et le temps a étranglé mon étoile
quatre nombre rient en d’hargneuses cabrioles
l’un meurt
l’autre naît
et le temps a étranglé mon étoile
des sons de nénuphars ardents
déconnectent mes ombres futures
une vapeur déconcertante remplit
mon recoin ensoleillé
l’ombre du soleil triture la
sphinge de mon étoile
les promesses se coagulent
face au signe d’étoiles étranglées
et le temps a étranglé mon étoile
mais son essence existera
dans mon intemporel intérieur
elle brille essence de mon étoile ! »
Si la conque intime de Pizarnik semble close et sans ajournement aucun, si la souffrance qui l’entraîne dans sa manie médicamenteuse paraît déterminer un tempérament solitaire et contrit, il est acquis que Pizarnik fut, au contraire, une molécule sociale des plus vives. César Aira de décrire cette veine qui contraste avec l’obélisque intérieur que charrie sa poésie :
« L’événement biographique le plus notable de ces années-là fut sa sociabilisation, contrairement à ce qu’on aurait pu attendre. Une parfaite cohérence avec son personnage aurait exigé la solitude, ou, du moins, une forme d’isolement ; quoi qu’il en soit, malgré l’intensité de sa vie sociale, elle préservait, pourrait-on dire, et sûrement l’a-t-on déjà dit, un espace secret, inviolable, etc. [...] Mais, à dire vrai, personne n’était moins solitaire ; son cercle quotidien, de jour comme de nuit, était le plénum littéraire de Buenos Aires, au grand complet, sans exception. »
Le questionnement sur l’existence et la mélancolie scripturaire ne s’étalaient guère, comme on pourrait le croire, dans la mondanité. Les amitiés de Pizarnik furent promptes et certaines grandioses, ses entretiens n’avaient rien du déplaisant échange de désespoirs que certaines âmes coulantes d’affliction distillent le plus souvent. La douleur cavalait de son visage à son ombre, de son ombre à son reflet, de son reflet à l’écriture, sans arroser l’audience directe qui, plutôt que repoussée par la personnalité de Pizarnik, était, en réalité, éperdue devant sa rêveuse dispersion et sa verve évasive.
Comme d’autres surréalistes avant elle, Pizarnik créa un double littéraire. Ce procédé, qui revêt parfois un attrait spécieux et se limite à un jeu pour muscadins, trouve, dans une sincérité confondue à l’indispensable, une saisissante fécondité littéraire, dépassant le simple thème du miroir et de la dissociation. De célèbres doubles la précédaient, Lord Patchogue, double de Jacques Rigaut, personnifié celui-ci, que l’auteur incarnait dans la vie même, envoyant des lettres à son adresse signée Rigaut auxquelles il répondait par d’autres signées Patchogue, concourant ainsi à dialoguer pour le plaisir de ses deux rôles. Un autre double littéraire, peut-être plus proche de celui de Pizarnik, bien que significativement lointain, fut celui de Claude Cahun, qui ne portait pas de nom, mais se déclinait à travers la profusion d’attributs pronominaux désignant chacun une silhouette incomplète du “Tout Cahun”. Des phrases, qui frôlent l’aphorisme, conjuguent jusqu’au frémissement la pluralité des arcanes intérieures. Dans Aveux Non Avenus (1930) :
« La sirène succombe à sa propre voix. »
« En vain j’essaye de remettre mon corps à sa place (mon corps avec ses dépendances), de me voir à la troisième personne. »
Dans La terre la plus étrangère, l’exaltation du regard rejoignait un langage descriptif, concentré sur le paysage ou des éléments isolés. L’intériorité ne faisait pas encore loi, ou, pour le dire autrement, sa législation cadrait avec une suite d’impressions sensibles étrangères à la discussion du soi au soi. Une année après, à la parution de La dernière innocence, la poétique de Pizarnik désertait l’objectivité pour ne plus quitter le concert pneumatique : l’extérieur devint un lieu d’interaction et s’acquitta de son contenu descriptif ; la poésie de Pizarnik avait trouvé son instrument de musique dans le moi conjugal. Cendres :
« La nuit s’est brisée en étoiles
en me fixant hallucinée
l’air crache la haine
son visage embelli
par la musique
Bientôt nous partirons
Rêve secret
aïeul de mon sourire
le monde est décharné
il y a un cadenas mais pas de clefs
il y a l’effroi mais pas les larmes.
Que vais-je faire de moi ?
Parce qu’à Toi je dois ce que je suis
Mais je n’ai pas de lendemain
Parce qu’à Toi je...
La nuit souffre. »
La deuxième particularité, hormis cette subjectivité dialogique, plus formelle cette fois, fut la recherche de la brièveté. Les poèmes de jeunesse en font moins cas que ceux qui suivront, toujours est-il que le tison des vers se trouve dans une petitesse pensée vers l’intensité impressionniste. Pizarnik, pour composer, collait parfois des phrases entre elles, écrivait sur des surfaces effaçables afin de visualiser le corrigible et le superflu. Cette formalisation énigmatique se mariait avec un usage labyrinthique de confusions syntaxiques et de renversements sémantiques, empruntés à un de ses maîtres, Antonio Porchia, auteur des Voix, courtes proses qui sonnent comme des conseils poétiques et confinent au pur jeu de sens :
« Tu ne vois pas le fleuve de pleurs parce qu’il lui manque une larme de toi. »
César Aira, sur cette inspiration majeure :
« Porchia a joué un rôle fondamental dans la création du style de Pizarnik et dans sa façon de procéder. [...] La solution choisie par Pizarnik dès 1956 consista à mettre ce mécanisme au service d’une imagerie surréaliste (que le mécanisme de distorsion logique rendait clairvoyant ou hallucinatoire) et elle s’en servit en même temps pour disloquer la position du sujet, ajoutant ainsi une touche insolite au mythe du poète maudit. »
C’est ainsi que Pizarnik écrivit, ainsi qu’elle abrégea la phrase pour contourner les longueurs émotives et tricoter, en ce sens, son désistement quant aux choses du monde et son intérêt primordial pour le phrasé intérieur. Dans la poésie de Pizarnik, chaque objet versifié est la cause d’une exclusion, une raison d’avoir peur, une âcre pulsion de timidité, comme l’écrit Laura Vazquez à ce sujet :
« Car, dans cette oeuvre, écrire n’est pas s’exprimer, et ce n’est pas se dire soi-même, se définir et se nommer, mais au contraire s’extraire de soi, et se débarrasser de toute réduction à une identité, à un savoir et à la certitude orgueilleuse qui pourrait l’accompagner [...] L’effacement du moi est présent partout dans l’œuvre de Pizarnik. »
Pizarnik partit en France en 1960, berceau et lange du surréalisme, tendanciellement essoufflé à cette époque tardive. La langue n’incommoda rien du périple parisien, Pizarnik connaissant le français dans le détail de la lecture et de l’apprentissage scolaire. Toutefois, ses soirées furent moins de rendez-vous français que de crépuscules entourés d’immigrés sud-américains, parmi lesquels Julio Cortazar, qui l’accueillit dans les poussières métropolitaines.
Alors entretenue par ses parents, Paris lui est si neuf qu’elle y trouve du travail. Comme beaucoup d’écrivains étrangers, elle vit dans des chambres d’hôtel, écrit et publie quelques chroniques. Paris ne parvient, cependant, à étouffer ses douleurs ; ses psychanalyses non plus. Pizarnik est saisonnière de ses angoisses, son étoile s’estompe mais demeure visible. En 1962 paraît L’arbre de Diane. Recueil imprimé à Buenos Aires tandis que son démiurge vaque à Paris. Poème 10 :
« un faible vent
plein de visages pliés
que je découpe en forme d’objets à aimer »
Poème 13 :
« expliquer avec des mots de ce monde
qu’un bateau m’a quittée en m’emportant »
Poème 33 :
« un jour
un jour peut-être
je m’en irai sans rester
je m’en irai comme qui s’en va »
Inversions pronominales, ciselures inflorescentes, la poésie est sublime, et la fêlure. Geste cristallin et mauve que l’écriture de Pizarnik meurtrie de devoir trouver un espace qui convient à l’absence. L’arbre de Diane est de ces courts recueils qui affaiblissent l’aveuglement des lumières et rendent aux poèmes leur rôle de chevet à poser sur une épaule. Vicente Huidobro, qui définissait la poésie moderne comme une partie d’échecs contre l’infini, n’eut pu se douter que quarante années après sa maxime, une poétesse la changerait en partie d’infini pour en finir avec le jeu d’échecs.
Alors Pizarnik rentra à Buenos Aires en 1964 après avoir visité une partie de l’Europe, et son père mourut, comme nous l’avons dit, deux ans plus tard. Il y eut d’autres recueils portègnes, Les travaux et les nuits (1965), le plus célèbre ; Extraction de la pierre de folie (1968), dédié à sa mère, qui mêlait la brièveté à des textes en prose plus élargis. Il y eut une bourse Guggenheim qui la rétribuait dans l’optique d’écrire un livre, qui la mena à New-York où elle se heurta à une crise personnelle infiniment douloureuse. Le livre fut finalement écrit et parut en 1971. C’était une étude prosodique et spectaculaire de la vie de la Comtesse Bathory, personnage conjectural, voire spéculatif, qui aurait assassiné de nombreux hommes au XVIe siècle. En dépit du livre, Pizarnik ne sut découvrir où s’épargner. César Aira :
« Elle prit enfin l’avion, le 3 mars 1969. Deux mois plus tard elle était de retour à Buenos Aires. Ce voyage semble avoir été un cauchemar sans rémission, ainsi qu’en atteste la correspondance où elle tente d’expliquer à ses amis pourquoi elle n’est pas allée les voir et ne les a pas non plus appelés. D’après une de ces lettres, elle resta à New-York une vingtaine de jours, insomniaque, avec des crises d’asthme, sans pouvoir acheter de tranquillisants faute d’ordonnance, dans la crainte qu’un imprévu bureaucratique l’empêche de repartir. De là, elle prit un avion pour Paris, où elle chercha, dit-elle, un endroit où s’installer, conformément à ce qui était prévu au départ. Elle revit les vieux amis avec plaisir, mais une fois revus, il n’y avait pas grand-chose à faire en leur compagnie. “Après toutes ces belles rencontres, j’ai décidé de me mettre au travail, et tous ces appartements inconfortables (sans salle de bain) et si chers m’ont fait penser au mien, vide, confortable et qui m’attend.” C’est sur cette note raisonnable que s’achève son dernier voyage. »
Dans la rue caméléonne, au numéro 980, une jeune femme, le souffle métallique et entrecoupé, sortit pour ne revenir que plusieurs mois après. C’est qu’elle rejoignait alors le séjour blanc de l’internement, harassée par les sujétions de son corps, par la pharmacopée qui l’astreignait. Sur son ardoise, la craie grinçait encore la nuit, quand elle s’isolait dans l’écriture toujours recommencée :
« l’agonie
des visionnaires
de l’automne »
Les accalmies retrouvées la ramènent à ses amitiés. Elle voit Olga Orozco, son intime éternelle, de jeunes poètes en visite qui lui extraient des conseils ; le mal l’absorbe à nouveau et le froid des pastilles avec lui ; elle écrit la nuit, revenue chez elle, écrit :
« je pleure, je regarde la mer et je pleure.
je chante un peu, très peu.
il y a une mer, il y a la lumière.
il y a des ombres, il y a un visage.
un visage aux traits de paradis perdu.
j’ai cherché.
pourtant j’ai cherché,
pourtant j’agonise. »
Dans la rue immense et droite, axe en biseau où, aujourd’hui, se dressent, hybrides, chacun des temps architecturaux du XXe siècle, une femme passait entre 1970 et 1972 ; égayée, elle courait les librairies. C’est là-bas qu’elle rencontra la jeune Ana Becciu, par hasard, qu’elle lui donna spontanément les épreuves d’un livre à paraître, tapuscrit honorant une bienheureuse rencontre, en échange duquel Ana Becciu, ne pouvant prévoir, lui donna deux paquets de cigarettes. Le soir, Pizarnik dînait ou écrivait, encore :
« qu’est-ce que cet espace que nous sommes
une idée fixe
une légende enfantine
jusqu’à nouvel ordre
nous ne chanterons pas l’amour
jusqu’à nouvel ordre »
En 1971 parut L’enfer musical, qui commençait ainsi :
« et qu’est-ce que tu vas dire
je vais seulement dire quelque chose
et qu’est-ce que tu vas faire
je vais me cacher dans le langage
et pourquoi
cette peur »
Le 25 septembre 1972, au 980 de la rue Montevideo, la jeune Ana Becciu s’en va visiter son amie. Elle retrouve son corps las, trop las pour les secours, trop las pour revenir. Pizarnik, comme tous les soirs, s’était encombrée de médicaments. Elle dut s’endormir sans savoir que la dose, excessive, l’empoisonnerait. Longtemps, il fut question de suicide, pour la mythologie, pour la caractériser. Or, il semble qu’il ait été, ce soir-là comme tous les autres, question de silence seulement, que les paupières une fois fermées, Alejandra Pizarnik pensa les rouvrir, et qu’elle plongea, silencieuse, à l’endroit le plus faillible du poème, dépeuplé d’encre et grouillant de rumeur, l’endroit où les “on-dit” du vers fomentent, où la phrase déborde, cet endroit qu’elle cherchait à dompter et qu’elle sut malmener, dont elle emporta le frisson avec elle, quand, ce matin-là, Ana Becciu la trouva silencieuse, dans l’appartement silencieux, au milieu de cet immense endroit qui parlait sans cesse, ce bavard et silencieux silence.
En remerciement aux éditions Ypsilon, qui travaillent à la réédition de l’œuvre complète d’Alejandra Pizarnik avec tant de minutie