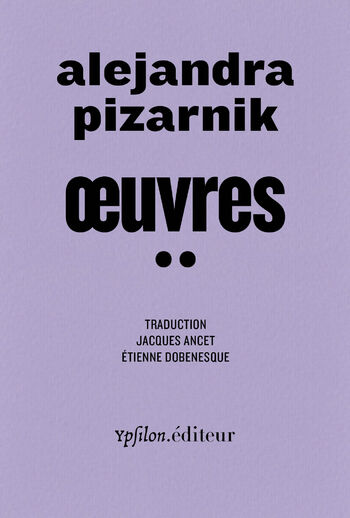2/05/2024
« Œuvres, d’Alejandra Pizarnik : à fleur de nerfs », par Thierry Clermont
Alejandra Pizarnik Parution d’un nouveau volume des oeuvres complètes de la poète et diariste argentine qui s’est suicidée en 1972.
Admirée par ses compatriotes Julio Cortázar, César Aira, Mariana Enriquez, qui a avoué sa fascination pour sa « furie secrète », l’érudit Alberto Manguel ; proche durant ses années parisiennes d’Yves Bonnefoy, d’André Pieyre de Mandiargues, et du Nobel Octavio Paz, qui préfaça l’un de ses recueils, Alejandra Pizarnik est plus présente que jamais parmi nous, un demisiècle après sa mort volontaire, à 36 ans. Poète écorchée, diariste désinhibée, prosatrice bien inspirée, cette « folle mélancolique et sereine », comme elle se définissait, a mené un long combat post mortem pour se faire une place parmi les plus grands, parmi les plus singuliers des auteurs latino-américains. Une lutte couronnée par la publication de l’édition critique de son volumineux Journal (plus de mille pages), en 2013, chez Lumen sous le titre Diarios.
En France, les éditions Ypsilon viennent de parachever l’édition de ses œuvres complètes avec un deuxième volume. Il reprend des œuvres traduites auparavant et publiées séparément : Les Perturbés dans les lilas, son unique pièce de théâtre, Textes d’ombre, son dernier livre, sur lequel elle travaillait au moment de sa mort, Cahier jaune, un recueil de proses diverses, datées des années 1960, Approximations, qui rassemble tous les poèmes mis de côté au fil des années, entre 1956 et 1972, et enfin La Terre la plus étrangère, son tout premier livre, publié à Buenos Aires, dans sa vingtième année.
Tous ces textes intimistes disent le mal de vivre de cette femme à fleur de peau, à fleur de nerfs, passant de l’exaltation provoquée par une lecture, un paysage, un refrain populaire (Piaf, Gréco…) ou une rencontre à l’abattement le plus complet, au dégoût de soi. « J’ai peur des autres et de moi-même, confiait-elle dans son Journal, à 23 ans. Ce n’est pas bon de vivre dans une peau. Je le dis par expérience. Je voudrais vivre pour écrire. »
« Déchirer le voile »
C’est sans doute la trentaine de textes formant le Cahier jaune qui témoigne le mieux de son vertige des sens et du tourbillon mal accordé entre le monde et sa vie, et qui la poussait à « déchirer le voile », pour reprendre son expression. Elle y confiait ceci : « Quelque chose gît, pourri ou malade entre le oui et le non… […] Peu importe ce qu’on me dit parce que personne ne me dit jamais rien quand il croit me dire quelque chose. J’écoute seulement mes rumeurs désespérées, les chants liturgiques venus de la tombe sacrée de mon enfance illicite. » Et un peu plus loin : « J’écoute le bruit de l’eau qui tombe dans mon sommeil. Les mots tombent comme l’eau moi je tombe. Je dessine dans mes yeux la forme de mes yeux, je nage dans mes eaux, je me dis mes silences. Toute la nuit j’attends que mon langage parvienne à me configurer… »
Jeune, elle disait qu’une petite musique tournait et remuait sa douleur (« Gira cierta musiquilla que revuelve mi dolor »). Tourments soulagés à peine par ses nombreuses et compulsives lectures : Kafka, Marguerite Duras (qu’elle avait traduite), Henry Miller, Virginia Woolf, Nerval, Apollinaire, Proust, sa compatriote Alfonsina Storni, les Journaux de Katherine Mansfield et de Cesare Pavese, le poète péruvien César Vallejo, Simone de Beauvoir, qu’elle rencontra à Paris au début des années 1960, La Nuit obscure de Jean de la Croix. Hantée par la fêlure, condamnée au doute et à la peur, déchirée par ses amours malheureuses et ses espoirs inaboutis, cette femme à la beauté foudroyante écrivait dans un des poèmes recueillis dans Approximations : « Ivre du silence / Des jardins abandonnés / Ma mémoire s’ouvre et se ferme / Comme une porte au vent. » Et le grand vent lui allait si bien. Celui des temps noirs et des royaumes dévastés.