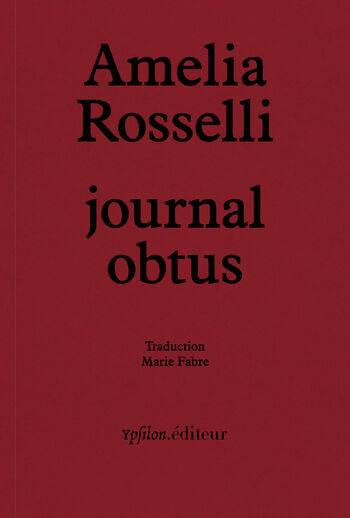17/01/2025
Amelia Rosselli en « lumière exacte », par Claude Grimal
La maison d’édition Ypsilon a fait connaître en France la poésie d’Amelia Rosselli (1930-1996) avec Variations de guerre, La libellule, Un Chinois à Rome et présente aujourd’hui sa prose grâce au très mince Journal obtus, aussi complexe et fascinant que ses vers.
L’œuvre d’Amelia Rosselli, d’une surprenante créativité, ne peut se lire sans les éléments biographiques et politiques qui l’informent, car, tout en n’en disant rien ou presque rien, elle est entièrement fondée sur l’histoire du XXe siècle et sur son destin personnel. Née en 1930 à Paris, elle est la fille de l’antifasciste Carlo Rosselli, exilé en France et assassiné avec son frère à Bagnoles-de-l’Orne en 1937 par la Cagoule sur les ordres de Ciano, gendre de Mussolini. Sa mère, Anglaise qui avait été activiste au Labour Party, dut alors fuir avec ses trois enfants en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis. Amelia fut élevée entre trois langues et dans quatre pays ; d’abord intéressée par la musique (elle collabora avec John Cage et Luigi Nono) avant de se tourner vers l’écriture, elle ne revint s’installer définitivement en Italie, à Rome, qu’en 1950. La mort de son oncle et de son père, puis de sa mère et de sa grand-mère ainsi que de son ami Rocco Scotellaro, les déracinements successifs, l’obsession de la persécution politique et de la surveillance (le fascisme italien, le maccarthisme, la CIA…), détruisirent peu à peu un équilibre mental fragile ; à vingt-quatre ans, hospitalisée dans la clinique de Ludwig Binswanger, elle avait été diagnostiquée « schizophrène paranoïaque ». Elle se suicida en 1996 en se jetant par la fenêtre de son appartement romain. Le lendemain, elle devait participer à une lecture sur Apollinaire, et elle venait de recevoir le prix San Valentino d’Oro.
Ses premières poésies publiées le furent en 1963, grâce à Pier Paolo Pasolini, dans Il Menabò d’Elio Vittorini et Italo Calvino ; suivirent au fil des ans des parutions dans d’autres revues ou en recueil. Son écriture, travaillée par le chaos du monde et de la psyché, profondément hantée par trois langues, apparaît d’abord comme un « prodige sonore ou une séance de spiritisme », si l’on reprend les mots du romancier Emanuele Trevi qui en est un admirateur, mais elle est loin de n’être que cela car elle tire sa puissance des grandes connaissances linguistiques et littéraires de Rosselli.
Dans Journal obtus, présenté ici en édition bilingue, se trouvent rassemblés « Premières proses italiennes » (des textes de 1954 qui chroniquent des promenades dans Rome le long du Tibre, fleuve « panthère »), « Note » (un journal tenu en 1967 et 1968) et « Journal obtus » daté de 1968, « début d’une autobiographie très peu biographique », « unique écrit intime [de l’autrice] […] pas encore tout à fait compris d’[elle]-même », selon les propres termes de Rosselli.
Les textes de Journal obtus parlent d’un malaise et d’une souffrance qu’ils interrogent avec stupeur et tiennent à distance grâce à une prose déchirée qui avance par à-coups, reprenant et modifiant images et sensations. Tout est soumis à bouleversement par le biais de la discontinuité du temps et de l’espace, de l’absence de cohérence logique, des changements de pronoms et de métaphores… Tout est parcouru par les fulgurances du sens et du lyrisme.
Mais les « récits » désarticulés et visionnaires du recueil s’achèvent parfois sur des fins brutales et sans appel. C’est le cas du « Journal obtus », écrit dans ce que Rosselli appelle « une prose sauvage » ; il chronique, si l’on peut dire, sa lutte pour ou contre la vie et s’achève de manière frappante sur un retournement du vieux thème de la révélation : « Et ainsi, ce fut lumière exacte : elle se persuada d’avoir trouvé sa dimension vitale : le pas savoir, le pas voir, le pas comprendre. » Rarement « dimension vitale » aura autant ressemblé à celle de l’annihilation, compagne de toujours d’Amelia Rosselli.