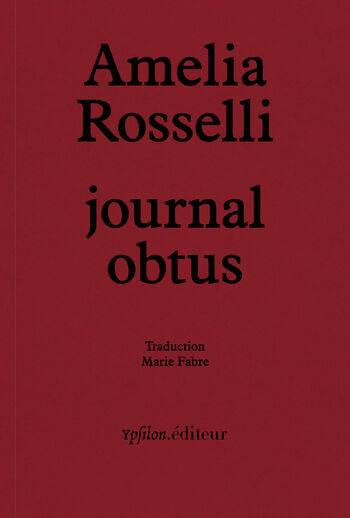13/12/2024
« Journal obtus », d’Amelia Rosselli : le feuilleton littéraire de Tiphaine Samoyault
LANGUE, TERRE D’EXIL
Amelia Rosselli (1930-1996) n’a pas vraiment de langue maternelle, son histoire en ayant décidé ainsi. Née à Paris, où son père, l’antifasciste Carlo Rosselli, fondateur du mouvement de résistance socialiste Giustizia e Liberta (« justice et liberté »), était réfugié, elle avait une mère anglaise et a d’emblée entendu et parlé trois langues. Après l’assassinat de Carlo et de son frère, Nello Rosselli, commandité par Mussolini à l’organisation française d’extrême droite de la Cagoule, en 1937, la famille fuit à Londres, puis aux Etats-Unis. Elle ne revient à Rome qu’après la guerre et Amelia Rosselli, qui découvre ce pays pour la première fois à l’âge de 18 ans (à l’exception d’un très bref séjour à Florence chez une grand-mère lorsqu’elle avait 5 ans), choisit de s’y installer. Lorsqu’elle commence à écrire, en 1952, elle le fait dans les trois langues de son enfance, et publie tantôt des recueils chacun dans une langue différente, tantôt en mêlant les trois langues au sein d’un même recueil (par exemple Diario in tre lingue, « Journal en trois langues », 1959-1960, non traduit). Elle sera d’ailleurs reconnue comme poète de langue anglaise bien avant de sortir de la confidentialité en Italie et d’être publiée en France.
Après onze ans d’expérience trilingue, elle fait le choix de l’italien comme langue principale, tout en continuant à faire affleurer les deux autres. Elle adopte la langue du père, mais pour en faire un territoire instable, bousculé par le deuil et l’exil. Son premier recueil publié en italien, chez Garzanti, en 1964, Variations de guerre (traduit par Marie Fabre, Ypsilon, 2012), joue constamment avec le français et l’anglais. Sa langue est plurielle et hérite des Cantos, d’Ezra Pound (Flammarion, 2002 ; rééd. 2013), qui mêlaient à l’anglais l’espagnol, le grec, le chinois. Journal obtus paraît d’abord en français. Il contient des textes écrits pendant les deux périodes et rassemble les expérimentations faites par Amelia Rosselli dans la prose. Les premiers datent des années 1950. Ils sont écrits en marchant le long du Tibre, « beau petit fleuve petit cadavre ». Ils sont une brève et intense question adressée à la ville de Rome : « Mon existence où m’as-tu jetée ! » Les autres textes sont écrits à la fin des années 1960, à une époque où Amelia Rosselli s’est définitivement engagée dans l’écriture et où elle revendique « ne pas croire aux mots mais au contraire, les déterminer au coup par coup ».
Tout terrain est instable
On l’entend, pour Rosselli, tout terrain est instable. « La vie est un puits vide et il s’agit de respecter son vide. » Certaines images sont plus obscures. Je rappelle pour l’anecdote que Pasolini (1922-1975), qui a fait une note pour accompagner les premières publications de Rosselli en revue, lui avait demandé un glossaire expliquant certaines images qu’il jugeait trop opaques (et qui témoignaient chez elle de l’influence du surréalisme). La maladie psychique la rend encore plus fragile. Des voix l’assaillent et la conduisent régulièrement à l’hôpital, où elle subit plusieurs fois les électrochocs qui portent atteinte à sa mémoire, ce qu’elle raconte dans Storia di una malattia (« histoire d’une maladie », 1977, non traduit). Elle est extrêmement sensible aux conflits et aux guerres dans le monde qui la précipitent dans des angoisses sans nom. « Maintenant, je ne voudrais plus être personne, pensa-t-elle – et elle se fondit dans un nouveau comportement pouvant lui permettre d’être ce qu’elle désirait être, c’est-à-dire personne. »
Musicienne – au début des années 1960, elle collabore avec John Cage et Luigi Nono, suit des cours de Stockhausen à Darmstadt (Allemagne), élabore des instruments –, elle rêve d’une langue universelle, rythmée et sonore, délivrée des contingences et des malentendus de la vie commune, une langue visant une musicalité complexe, ni angélique ni harmonieuse, mais agressive et nouvelle (comme celle des compositeurs avec lesquels elle a travaillé). Elle fait des lectures à haute voix, dans son italien accentué, qui portera toujours la marque d’un ailleurs. Journal obtus est plusieurs fois monté au théâtre, vibrant de ses sonorités non familières.
« Et ainsi, ce fut la lumière exacte : elle se persuada d’avoir trouvé sa dimension vitale : le pas savoir, le pas voir, le pas comprendre. » L’écriture permet de se libérer des certitudes, des liens acquis. La langue sauvage de la poésie et ici de la prose littéraire déplace la langue courante et fait saillir les angles (c’est la définition de l’obtus). « Je n’ai pas compris l’aspect inattendu du monde, avec ses toits contractés par une longue maladie. » Chaque phrase délivre une pensée dense et brûlante qu’on voudrait noter.
La poésie italienne du XXe siècle est sans doute la plus belle et la plus riche du monde, mais elle n’a pas laissé beaucoup de place aux femmes. Amelia Rosselli est l’une des rares à avoir pu la prendre (avec Maria Luisa Spaziani – 1922-2014 – et Patrizia Cavalli – 1947-2022 –, notamment). Pourtant, elle a eu besoin d’autorisations masculines (Vittorini, Pasolini, Moravia – qui est un lointain cousin –, puis Fortini et d’autres) pour s’imposer. Elle est reconnue et célébrée de son vivant et relève pleinement, aujourd’hui, du canon de la poésie italophone, tout en n’appartenant à aucune langue ni à aucune identité située, sauf peut-être à l’exil.