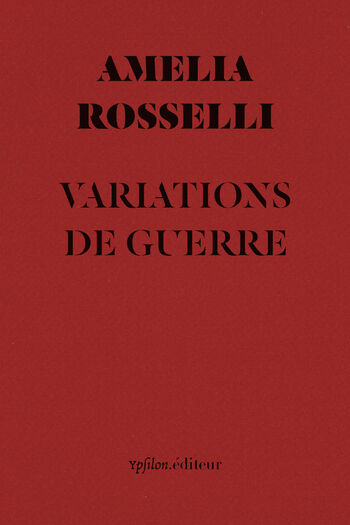1/10/2012
« C’était la grâce qui balbutiait des mots décousus », par Sophie Ehrsam
Ce recueil est un bel hommage à Amelia Rosselli et un remarquable travail de traduction dont il est à souhaiter qu’il permette à cette poétesse italienne d’être mieux connue en France. Une œuvre incandescente mais cadencée, riche d’influences multiples, qui interpelle.
« Cherchez-moi et passez hors » : un unique vers au front d’une page, défi ou promesse ? Un vers représentatif d’Amelia Rosselli, musical, contenu mais ouvert. Sa poésie présente des aspects divers, tant dans la forme (néologismes et archaïsmes cohabitent) que sur le fond : Cassandre et Électre voisinent avec — « s’avoisinent de » — Jésus et les saints, des fêtes précolombiennes avec des gratte-ciel.
Faut-il s'en étonner de la part d'une Italienne née à Paris de mère anglaise ? Elle a vécu en Italie, en France, en Angleterre, aux États-Unis ; pour autant, comme le précise dans la préface le critique Jean-Baptiste Para (lui-même poète et traducteur), elle se considérait comme « réfugiée » et non cosmopolite. De ces premières années sous diverses latitudes, Amelia Rosselli semble avoir gardé des échos de lectures et de langues multiples: mots d'autres langues laissés tels quels, emprunts liturgiques, influences rimbaldiennes, broderies sur trame shakespearienne (« dans le délire d'une petite nuit d'été »). Son italien, reconstruit et sous influences, emprunte à diverses époques, diverses langues, divers registres et n'est pas exempt de formes mutantes restituées dans la traduction par des trouvailles telles que « revestiaire » et « chantcelle ».
Auto-baptisée « fille de la Seconde Guerre mondiale », Amelia Rosselli n'était pas étrangère aux morts violentes (son propre père a été assassiné), et sa poésie en porte des traces : pièges, armes, sang, larmes, en adéquation avec le titre, Variazoni belliche (Variations de guerre). Ce titre donne une autre clé de lecture, celle de la musique. Si le français n'a pas les accents toniques de la langue italienne, on perçoit dans la traduction des jeux de sonorités et une rythmique singulière :
Cette sirène qui est une douce chanteuse dans ses herbes de
paille et de désordre ; cette sirène qui chante et qui n'en peut
presque plus : cet arbre qui couvre la misère et en rend la
vie moins mélancolique : cette gymnastique diurne et nocturne
cette manie de grandir ; ce rêve et ce sommeil cette
misère et cette mort : ces fleurs et ces tristesses :
le deuil ne rime à rien ! C'était pour toi que je tombais et renaissais.Cette misère et cette chanson sont mortes.
C'est particulièrement dans la seconde partie du recueil que se fait jour le mouvement de spirale ou d’oscillation qui caractérise cette poésie. Dans la première partie, le lecteur est davantage frappé par les « lapsus » (erreurs volontaires) qui ont tant contribué à intéresser Pasolini à cette œuvre (voir sa « Note sur Amelia Rosselli », incluse dans la postface). Tout au long de l'œuvre cependant, ce ne sont que montées et descentes, escaliers et tourbillons, fermetures et ouvertures, une atmosphère « piranésienne » (soulignée par Antonella Anedda). Dans « Espaces métriques » (voir la postface), Amelia Rosselli a livré ses réflexions sur la construction poétique, y compris ses doutes sur le vers libre : « en interrompant le vers même long à une quelconque fin de phrase ou à un quelconque mot dissocié, (…) je scindais le cours de ma pensée en strates inégales et en significations dissociées. L'idée n'était plus dans le poème entier, en tant que moment de réalité dans mon esprit, ou participation de mon esprit à la réalité, mais elle se déchirait en de lents escaliers et on ne pouvait la retrouver qu'à la fin, ou nulle part ».
Le combat poétique consiste donc à donner un cadre au foisonnement linguistique ; certains poèmes du recueil ont un aspect monstrueux, une force volcanique qui leur ont valu d'être comparés à des « caillots de matière où cendres et incandescence cohabitaient » (Zanzotto), à une « émulsion qui prend forme pour son compte » (Pasolini). La lecture chronologique des poèmes permet d'appréhender ce travail qui tend vers une forme plus maîtrisée, mais toujours à la limite du déséquilibre. Les images se condensent ; on passe de « regarde le mouvement du cœur / se faire tuf » à « ton cœur de tuf » au fil de la recherche d'un état poétique — justement — entre éruption organique et figement minéral.
En guise d'entre-deux peut-être, seconde peau mais extérieure au corps, pièce aux contours définis mais épousant le mouvement, tel est le vêtement. La comparaison bien connue entre textile et texte est ici justifiée : contre les mots trompeurs qui paradent sous de fausses couleurs (« la gloire avec son châle du trouble inventait de nouvelles chansons »), Amelia Rosselli cherche un langage vrai, qui ne délaisse pas les mots durs-amers, ni les hiatus, ni les lapsus et au besoin crée de nouveaux vocables, si difformes soient-ils, de nouveaux rythmes dans la quête d'une « parfaite dysharmonie ». Tâche éminemment poétique : « je réinventais des syllabes abstruses, grandiloquaces », « je tramais des injures et mélangeais les genres ».
Mélange des genres ? Entre enfer et paradis, on entend ici des prières aux accents canailles, des chansons pour enfants et soldats aux rythmes révoltés : « conduisez-moi à la comptine / qui rabat de son poing l'antique vertu des prêtres / jouisseurs ». L'imaginaire est peuplé de dragons et d'archanges mais aussi de riches et de pauvres, le tout dans la mélodie d'une ville où chaque syllabe compte, qui n'exclut ni les trams, ni les étoiles, ni les hirondelles. La fable, constamment frottée au réel, est à la fois indispensable et dérisoire : « Contre / tout et toutes les misères je dressais des châteaux de cartes vite démolis / par ma main sagace ». Toujours la voix poétique introduit quelque distance depuis son « nid d'ironie ». Le poème est aussi une chambre avec vue, dans laquelle la pensée se cogne les ailes, mais avec une fenêtre sur le monde ; c'est peut-être surtout un labyrinthe de souvenirs, d'angoisses et de questions.
Dans une langue qu'on pourrait dire syncrétique, Amelia Rosselli joue sur une large gamme de longueurs de vers et de poèmes, joue avec la ponctuation : absente aux vers les plus haletants, en rafale aux plus hésitants. Une poésie qui parle à l'oeil et à l'oreille, à la tête et au cœur.
Ô hirondelle, toi qui pleine de grâce inventes tes mots et siffles
libre hors de toute plantation
avec toi je danserais bien au-delà des nids précis je saurais la
cime indulgente. Si viennent à se répéter les tourments automouvants, si la rébellion doit
être atténuée, si ta plume tombe par terre qu'au moins je puisse rêver !