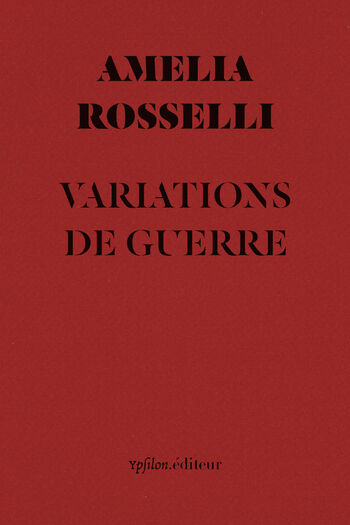7/06/2013
« Amelia Rosselli, Variations de guerre », par Jean-Nicolas Clamanges
En étrange langue que notre langue même, voilà où nous plonge cette traduction des Variazioni belliche (1964) jusqu’ici inédites en français, d’Amelia Rosselli (Paris, 1930-Rome, 1996). Comme si l’impact de cette extraordinaire poésie, elle-même si étrange paraît-il, en sa propre langue, révélait des possibilités latentes dans la nôtre, non tellement inédites (la langue d’avant la cure Malherbe ou la lignée expérimentale jusqu’à Novarina), qu’inlassablement classées à part ou (re)confinées à la marge à peine réapparues, par le courant normatif de nos Lettres hexagonales.
Réinventer les mots et la grammaire de la Tribu donc, pour faire entendre quelque chose des Variations de guerre rosselliennes, tel est le parti inventif et audacieux adopté par Marie Fabre, leur traductrice :
« Rosselli se délecte d’idiomatismes dont elle aime à faire glisser le sens, s’arrête sur chaque spécificité syntaxique, grammaticale, sonore ou graphique pour l’explorer et l’exploiter. Elle cherche dans la langue son noyau singulier jusque dans ses « erreurs ». Le choix a été de se tenir au plus près de cette langue italienne, quitte à rendre un français déstabilisé par celle-ci, et donc lui aussi marqué par des processus de distorsion et de contamination (…). Le dispositif poétique de Rosselli est si fort qu’il est capable de réactiver certaines possibilités inédites de la langue française elle-même contenue comme « langue dormante » (dans ce dispositif) s’éveillant au fil de la traduction – cela à condition d’aller chercher ses angles morts, quitte à caresser sans cesse l’incorrection (l’insurrection). »
Pari tenu, et brillamment ! Par exemple:
Dans l’éléphantiasis de la journée se conduisait une rapide
débandade de causes et d’effets. Des affects se concluaient
dehors et dedans le ruisseau. Tout était bien
inoculé dehors et dedans la cellule. La
cellule de toutes les fraîcheurs s’isolait désolée
dans sa vieillerie. Je conduisais une compétition grandiloquace
et la pulchritude des journées était une barrière
à la communion. Pour pardonner la compétition je réinventais
des syllabes abstruses, grandiloquaces comme le vent qui germe
en floraison sèche. Conditionnée à faire grâce à la foule
et les pauvres relever, la compétition terminait faussée par
les marches coupables dehors et dedans la compétition
des riches et idiots en dehors du passe-temps du soleil. (p. 66)
Ou pour le revival de la vieille langue d’amour amer :
Qu’a donc mon cœur qui bat si suavement
et luy le rend désespéré, et les
plus durs sondages ? toi Ces
scolances que j’y imprimay av’ant qu’el
se tormentât si
férocement, tous ont disparu pour luy ! Ô si mei
lapins courants par mei nerfs et par les
givreux canaux de mea lymphe (ô vie !)
ne stoppent pas, alors là oui, qu’moi je m’y
approchoy de lae mortae ! En toute franchetés mon âme
toi porte-lui secours, je t’étreins, toi, –
trouves ceste Parole Suave, toi reviens
à l’idiome compris qui fait que l’amour reste. (p. 30)
« Je rimais au gré de mon pouvoir
et je participais au vide »
Dès son entrée en vie d’écriture, c’est-à-dire extrêmement tôt, Amelia Rosselli a cherché des formes universelles à l’expérience humaine, tant au plan vital que spirituel, transversalement, si l’on peut dire, à la diversité des idiomes de l’espèce, à ce qu’elle nomme un babelare commosso – un babèlement ému – dans le premier poème du livre ; cela comme intuition d’une forme à trouver hic et nunc pour rendre le vif de l’affect, son immédiat rythmique qui s’avère toujours mentalement spatialisé : « … au gré de la situation que mon cerveau affrontait à chaque détour de ma vie, à chaque déplacement spatial ou temporel de mon expérience pratique quotidienne (…) je notais d’étranges densifications dans la rythmicité de ma pensée, d’étranges arrêts, d’étranges coagulations et changements de temps, d’étranges intervalles de repos … : de nouvelles fusions sonores et idéales selon les changements du temps pratique, des espaces graphiques et des espaces qui m’entouraient continuellement et matériellement ».
Ce témoignage qu’elle livre en 1962 dans un texte théorique sur sa poétique que lui a demandé Pasolini, ici traduit sous le titre Espaces métriques, résonne avec toute une culture moderne du ‘stream of consciousness’ (Joyce), des recherches surréalistes sur le « fonctionnement de la pensée » (Breton), des expériences (subies) d’Artaud ou (délibérées) de Michaux sur les rythmes et les vitesses, les lenteurs, voire les arrêts ou suspensions des processus mentaux, etc. La culture d’Amelia Rosselli est à cet égard très précise et quasi expérimentale. Son Diario in tre lingue (1955-1956) – elle maîtrise le français et l’anglais qui sont ses langues d’exil depuis l’enfance – montre par exemple qu’elle a l’habitude de s’exercer à la métrique comparée sur diverses langues, y compris le latin et le grec – autant sur de la prose courante que sur des vers ; qu’elle réfléchit sur le rythme des phrases complexes en latin, chez Proust, Dante, Lautréamont ; qu’elle s’exerce à diverses réécritures sur ce plan, avec Rimbaud ou La Fontaine, etc. Ce que nous lisons comme œuvre achevée (par éclairs et non sans gouffres il est vrai…) dans les Variations, est le produit d’un laboratoire central intime en perpétuelle recherche, dont ce journal nous donne la chance de savoir qu’on y travaille dans les trois langues à la fois, sans compter les autres … et toutes époques mêlées, car cette exilée de l’Italie fasciste (Mussolini a fait assassiner son père) vit et pense avec John Donne, Eliot, Rimbaud, autant qu’avec Leopardi, Pétrarque ou Montale.
Née à Paris travaillée dans l’épopée de notre génération
fallacieuse. Échouée en Amérique parmi les riches champs des possédants
et de l’État étatique. Vécu en Italie, pays barbare
Fui l’Angleterre pays de sophistiqués. Pleine d’espoir
dans l’Ouest où pour l’heure rien ne croît. (p. 58)
Sa question n’est pas tant de trouver sa langue : elle assume totalement son plurilinguisme foncier, que de rendre son vers capable de rendre et transmettre une expérience totale. C’est ce qu’elle a cherché longtemps, n’étant pas satisfaite du vers libre des Modernes, jugé trop versatile, trop complaisant à toutes mains, pour maîtriser un « procès créatif » qui s’éprouve et se joue pour elle comme « une fusion de plusieurs éléments mal distingués mal séparables », ainsi qu’elle l’écrit, directement en français, dans un récit intitulé Le Chinois à Rome. Désespérant longtemps de sa capacité à inventer la prosodie qu’il lui fallait, elle dit qu’elle l’a découverte un peu par hasard en se tournant vers le sonnet italien de la Renaissance. Mais avant d’y venir, il faut insister d’abord sur le caractère de réappropriation dépaysante et foncièrement dissonante qu’a recouvert le choix de faire son œuvre en italien : elle y apporte une culture : Pound, Eliot, S. Plath (qu’elle traduit), l’avant-garde française, etc., qu’elle pratique depuis longtemps, alors que sa génération la découvrait et la lisait surtout en traduction ; en outre, sa langue d’auteur doit intégrer son histoire linguistique, laquelle reflète ou transpose elle-même quasi organiquement une histoire politique déterminée par l’antifascisme et la condition de l’exilée. Il se peut ainsi qu’elle reste encore une exilée dans cette langue même comme d’ailleurs dans la nôtre et toutes les autres. C’est peut-être aussi une définition possible de la condition poétique en général, quand elle est authentique.
[…]