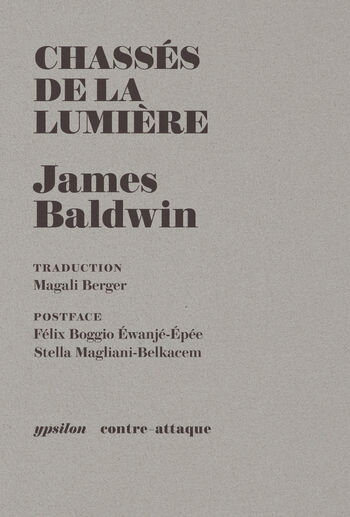10/05/2017
« James Baldwin, l’écrivain qui n’appartient à personne », par Lise Wajeman
À l’occasion de la sortie du film documentaire de Raoul Peck consacré à James Baldwin, I Am Not Your Negro, voyages dans les romans et les essais de cet écrivain majeur né dans une famille pauvre de Harlem, figure de l’activisme noir sans être affilié à aucun mouvement, et qui a achevé sa vie en France, loin d’une identité imposée.
Un jeune héros africain américain est attiré dans le guet-apens d’une famille blanche, qui cache derrière ses sourires trop avenants le mauvais sort qu’elle réserve aux Noirs : prendre possession de leur âme. Un esclavage en mode paranormal, moderne, presque insoupçonnable, mais mortel. « Get out », « tire-toi », clame le titre du film d’horreur racialisé, sorti le 3 mai, au pauvre jeune homme pris au piège du pouvoir blanc. Conjonction de calendrier : le documentaire de Raoul Peck, sur les écrans mercredi 10 mai, réplique à la menace par un refus qui vaut affirmation de soi – « I Am Not Your Negro », « Je ne suis pas votre Nègre ». Sur les affiches, le beau regard de James Baldwin répond aux yeux terrifiés du jeune homme en passe d'être envoûté. Si le film sur l’écrivain, mort en 1987, ne cesse de résonner avec le présent – le mouvement Black Lives Matter, l’Amérique de Trump –, c’est parce qu’il dénonce les continuités politiques de l’histoire américaine.
Agrandir l’image
Le documentaire de Peck se déploie autour d’un manuscrit que Baldwin a laissé inachevé, Remember This House, un texte consacré à trois figures du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, Medgar Evers, assassiné en 1963, Malcolm X, assassiné en 1965, et Martin Luther King, assassiné en 1968. La parole de Baldwin, énoncée par Joey Starr en version française, se dépose sur des images d’archives anciennes et récentes : on passe des photos de lynchage début de siècle à la vidéo montrant Rodney King passé à tabac par des policiers en 1991 ; des images des émeutes de Watts (1965) à celles de Ferguson (2014).
Il ne s’agit pas de dire que rien n’a changé, de l’Amérique de la ségrégation à celle de Barack Obama : il s’agit de pointer la permanence de discours et de structures qui visent à désigner un « problème noir », quand le problème est celui de l’Amérique. C’est ce qu’explique Baldwin sans relâche, et qui vaut pour alors comme pour aujourd’hui.
On ne mesure plus aujourd’hui la notoriété qu’a connue Baldwin de son vivant. Comme celle des héros de Harlem Quartet, son dernier roman, l’histoire personnelle de l’écrivain épouse l’histoire des luttes pour les droits civiques sans être pour autant une vie de militant. Né dans une famille pauvre de Harlem, il est élevé à la dure par un beau-père prêcheur, dans un monde où les Noirs sont libres – alors que sa grand-mère était née en esclavage – mais pas égaux, contrairement à ce qu’affirme la doctrine en vigueur, « separate but equal ». Bientôt écrivain remarqué – son deuxième roman, La Chambre de Giovanni, qui évoque une passion homosexuelle, fait scandale lors de sa parution en 1956 –, il devient une figure de l’activisme noir.
Agrandir l’image
Baldwin n’est affilié à aucun mouvement en particulier : il observe d’un œil critique les Black Muslims et, s’il accompagne la marche sur Washington au cours de laquelle Martin Luther King prononce son célèbre discours « I Have a Dream », il constate l’échec des mouvements pacifiques. Durant cette même année 1963, alors qu’il fait une tournée de conférences dans le Sud, plaidant pour les droits des Noirs américains, il écrit La prochaine fois, le feu : « Aux États-Unis la violence et l’héroïsme sont devenus synonymes sauf lorsqu’il s’agit des Noirs. » Il est placé sous surveillance par le FBI, déclaré « persona non grata » par le ministère de l’intérieur britannique.
Ces périodes d’engagement sont entrelacées d’allers et retours en France – il finira ses jours à Saint-Paul-de-Vence. L’échappée n’est pas seulement une respiration, elle est une condition de survie. Baldwin peut enfin cesser de subir cette identité qu’on lui impose de l’autre côté de l’Atlantique. Dans Face à l’homme blanc, recueil de nouvelles parues en 1965, l’un des multiples doubles fictionnels de l’auteur, ici un chanteur noir américain marié avec une jeune femme suédoise, décrit la liberté qui s’empare de lui sur un pont, à Paris : « Durant toutes ces années (…), j’avais transporté en moi le monde hostile et meurtrier. Peu importait ce que je faisais, disais ou ressentais, j’avais toujours gardé un œil fixé sur le monde, sur ce monde dont j’avais appris à me méfier dès que j’avais su mon nom, sur ce monde dans lequel je savais qu’il ne fallait jamais tourner le dos, le monde des Blancs. Et pour la première fois de ma vie, j’en étais libéré. »
La question noire est un problème blanc
La thèse de Baldwin sur la question noire est le pendant de celle de Sartre sur la question juive : c’est le Blanc qui fait le Noir. « Pour un Noir américain, à partir du moment où vous naissez, chaque bâton, chaque pierre, chaque visage sont blancs. Et comme vous n’avez pas encore vu de miroir, vous partez du principe que vous l’êtes aussi. Et le choc est grand lorsque, vers l’âge de cinq, six ou sept ans, vous découvrez que le drapeau auquel vous avez prêté allégeance, comme tout le monde, ne vous a pas prêté allégeance à vous. Et le choc est grand lorsqu’en regardant Gary Cooper éliminer les Indiens, alors que vous êtes de son côté, vous comprenez que les Indiens, c’est vous. » (« Le rêve américain et le Noir américain » (1965), article rassemblé avec d’autres essais dans Retour dans l’œil du cyclone).
La condition noire américaine est une expérience minoritaire, comparable à d’autres sans leur être assimilable : celle des Juifs en Europe, celle des Algériens en France. La situation des Noirs est définie par une « color line » qui leur assigne une condition. « Les Irlandais sont devenus blancs en arrivant ici [en Amérique] et ont commencé à monter dans le monde, tandis que moi je suis devenu noir et j’ai commencé à sombrer. » Être noir en Amérique, c’est ne pas pouvoir décider qui l’on est.
La seule solution consiste à tracer des lignes de fuite : « Afin de pouvoir vivre, j’ai décidé très tôt qu’une erreur, quelque part, avait été commise. Je n’étais pas un “nègre”, même si c’est ainsi que vous m’appeliez. Or, si à vos yeux j’étais un “nègre”, le problème avait à voir avec vous, avec quelque chose dont vous aviez besoin. (…) J’avais été inventé par les Blancs, et je savais déjà assez de choses à propos de la vie pour comprendre que lorsqu’on invente quelque chose, lorsqu’on projette quelque chose, c’est en réalité soi-même qu’on invente, qu’on projette. Nous voilà donc maintenant dans un pays entier persuadé que je suis nègre, et moi pas : la guerre est déclarée ! », explique Baldwin dans une conférence sur « L’enfant noir » qu’il donne à des enseignants new-yorkais (publiée dans Retour dans l’œil du cyclone).
Je ne suis pas votre Nègre, déclare le titre du film de Raoul Peck. Je ne suis rien de ce que vous m’imposerez : Baldwin ne cesse de rappeler qu’il est, comme chacun, irréductible à toute assignation. En 1949, il se fait remarquer pour un article très critique à l’encontre de Richard Wright et de la fiction protestataire, reprochant à l’auteur d’Un enfant du pays de figer ses personnages dans les catégories raciales imposées, sous couvert de les dénoncer, là où Baldwin réclame que les personnages leur échappent, éprouvent leur humanité, leurs contradictions, leur liberté, au-delà des cadres sociologiques.
Au centre de la somme romanesque qu’est Harlem Quartet, paru en 1979, se tiennent deux fratries : l’une est composée de Hall, le narrateur, et de son frère Arthur, chanteur renommé de gospel. L’autre est celle de Julia, enfant prêcheur prodige bientôt déchue, et de Jimmy, qui deviendra pianiste. Tous les personnages changent, se réinventent ; une seule chose est sûre, une seule étoile est fixe : l’amour qu’ils se portent. L’amour de Hall pour les siens, l’amour d’Arthur pour Jimmy. Hall tente d’expliquer à son fils de quinze ans ce qu’a été son oncle Arthur : « Bon Dieu, quoi ou qui que ton oncle ait pu être, et il a été des masses de choses, il n’a jamais été la pédale de personne » (« he was nobody’s faggot »). Plus loin, le narrateur délivre sa conviction : « Notre histoire c’est l’autre, voilà notre seul guide. Une chose est absolument certaine : on ne peut renier ou mépriser l’histoire de quiconque sans renier ou mépriser la sienne propre. » De ce mouvement dialectique, Baldwin ne cesse de témoigner, dans sa vie comme dans ses textes.
Baldwin aime les femmes et les hommes ; il sait bien que les Black Panthers le trouvent bizarre, avec ses allures queer. Mais il s’en amuse, car ce n’est pas pour lui un enjeu de vie ou de mort, alors qu’être noir est une mise en danger permanente. Si le sujet majeur des romans et nouvelles de Baldwin est l’amour, le grand objet de ses essais est la peur. La peur hante les Noirs, constamment : « La peur que je perçus dans la voix de mon père (…) lorsqu’il se rendit compte que je croyais vraiment pouvoir faire toutes les mêmes choses qu’un petit garçon blanc et étais absolument décidé à le prouver, était très différente de celle que je pouvais entendre lorsque l’un de nous était malade (…). C’était une autre peur, la peur que l’enfant, en défiant les postulats du monde des Blancs, ne se place en travers des forces de destruction » (La prochaine fois, le feu).
Mais, en un geste de retournement remarquable, Baldwin fait changer la peur de camp. « Les Blancs sont habités par la peur, soigneusement étouffée, que les Noirs puissent vouloir faire subir aux autres ce qu’ils ont eux-mêmes subi » (« La culpabilité de l’homme blanc », Retour dans l’œil du cyclone). Le problème noir, c’est le problème des Blancs : ce sont eux qu’il faut libérer. L’écrivain se penche avec toute son intelligence et sa douceur sur le fléau de ces hommes qui ont cru pouvoir construire leur vie sur l’humiliation d’autres hommes.
« Porter témoignage de la vérité »
Les livres de Baldwin donnent une compréhension profonde de ce que signifie être noir en Amérique. Paradoxalement, cette intelligence intime, celle qui passe à la fois par les sentiments et la raison, naît moins des fictions, tenues à distance par le cadre de la narration, que des essais, qui comptent parmi ses textes les plus personnels : l’écriture en première personne convoque ici une sensation, là une anecdote, abolit la frontière entre considérations théoriques et expérience singulière.
Publié pour la première fois en 1972, Chassés de la lumière opère cette conjonction magique entre une critique politique aiguë et des récits autobiographiques, qui s’entrelacent en une progression sinueuse et pourtant limpide. C’est un souvenir : « Il y a longtemps de cela, j’ai connu une fille blonde, au Village ; nous avions fini par ne plus jamais sortir ensemble de l’immeuble. Elle était beaucoup plus en sécurité seule dans les rues qu’avec moi – réalité brutale et humiliante qui a détruit d’avance tous les liens que nous aurions pu réussir à tisser entre nous. » C’est un constat : « Aujourd’hui comme hier, les Américains blancs ne peuvent pas croire à la réalité des injustices supportées par les Américains noirs. Ils ne le peuvent pas parce qu’ils sont incapables d’affronter ce qu’elles révèlent sur eux-mêmes et sur leur pays. »
C’est l’histoire d’un habit : pour une soirée au Carnegie Hall avec Martin Luther King, Baldwin fait l’acquisition d’un costume. « Quelque deux semaines plus tard, je portais ce même costume pour l’enterrement de Martin. » Il explique à un journaliste qu’il ne pourra plus jamais porter ce vêtement. Peu de temps après, son ami d’enfance le contacte : il a appris par un journal que « je possédais un costume dont je ne voulais plus, or, s’il s’en souvenait bien, nous avions la même taille ». Baldwin entreprend de porter l’habit à cet ami qui ne l’est plus : « Lui ne pouvait pas se permettre d’avoir dans sa penderie des costumes qu’il ne mettait pas, il ne pouvait pas se permettre de les jeter. En un mot il ne pouvait pas s’offrir mon désespoir élégant. »
Mais tout tourne mal : la voiture que Baldwin a réservée pour le trajet s’avère être une limousine – bien trop luxueuse pour une visite dans le Bronx, la discussion polie vire à l’invective parce que son hôte défend la guerre que mènent les États-Unis au Vietnam. Du deuil d’un ami au deuil d’une amitié, l’histoire pourrait s’arrêter là, mais elle ne serait pas juste. Alors qu’il éprouve combien son ami et sa famille le condamnent, Baldwin remarque : « Après tout, ce costume sanglant était leur costume, il avait été acheté pour eux et même payé par eux : Martin avait existé grâce à eux (…) et le sang qui raidissait le tissu du costume était le leur. Mais ce qui nous séparait, c’est qu’ils ne le savaient pas. » Le costume de riche est celui des pauvres, il est l’emblème d’une lutte commune en même temps que d’une séparation. Dans aucun de ses textes, Baldwin n’occupe une posture de surplomb dogmatique : il puise au contraire sa force dans son attention aux faiblesses, contradictions, tours et détours du réel, car c’est là que gît la vérité.
James Baldwin, La Chambre de Giovanni, traduit de l’anglais (États-Unis) par Élisabeth Guinsbourg, Rivages poche, 208 p., 8,15 €
—, La prochaine fois, le feu, traduit par Michel Sciama, Gallimard, 144 p., 8,20 €
—, Face à l’homme blanc, traduit par Jean-René Major, Gallimard, 336 p., 8,80 €
—, Retour dans l’œil du cyclone, traduit par Hélène Borraz, Christian Bourgois, 256 p., 18 €
—, Chassés de la lumière, traduction révisée de Magali Berger, Ypsilon, 232 p., 17 €
—, Harlem Quartet, traduit par Christiane Besse, Stock, 700 p., 12,20 €