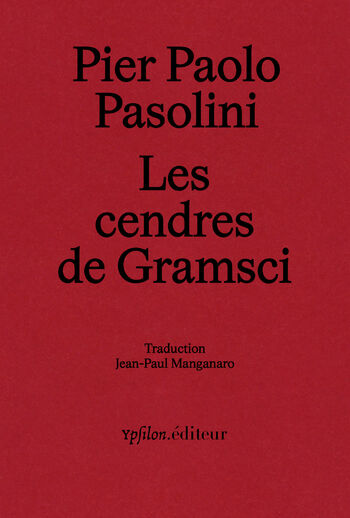1/09/2025
« Pasolini, vision du futur », par Mariia Rybalchenko
À l’occasion des 50 ans de la mort du poète et cinéaste italien, sauvagement assassiné sur la plage d’Ostie, près de Rome, les éditions Ypsilon et Lanskine publient des recueils de poèmes inédits en français : Transhumaner et organiser (1971), ainsi que la version intégrale des Cendres de Gramsci (1957), recueil qui résume le mieux la quête politique et poétique de Pier Paolo Pasolini (1922-1975).
En visitant récemment l’exposition de Thomas Schütte, à la Punta della Dogana, à Venise, je suis tombée sur un curieux projet de l’artiste allemand, datant de 1992 : créer un mémorial à Pasolini, près d’Ostie, en ouvrant au public la tour San Michele, construite en 1568 par Pie V, et aujourd’hui à l’abandon. À la place de ce mémorial, près de la plage où le cinéaste est mort, se dresse une sculpture insignifiante dans un parc grillagé qui portent son nom. Il était lui aussi hanté par un projet de mémorial : le « monument des Désespérés », mentionné dans un des poèmes de Transhumaner et organiser.
Conformisme, passivité bourgeoise, oubli de la charité, dictature de la consommation, désacralisation, oligarchie, effacement culturel, refus de la liberté : ce qui nourrissait le désespoir de Pasolini était aussi la source de sa poésie violente, donc authentique. « Le livre peut devenir un produit de consommation, l’édition aussi ; la poésie, non », disait-il en 1969. La poésie est donc inutile, et c’est là que résident sa beauté et sa force. Transhumaner et organiser en témoigne. Ce livre est le dernier ouvrage publié du vivant de l’auteur, en 1971 : soixante-trois poèmes du recueil, pour la plupart parus dans la revue d’Alberto Moravia, Nuovi argumenti, entre 1968 et 1970. Voici donc sa première édition en français, traduite par la poétesse Florence Pazzottu.
Ces poèmes, souvent ancrés dans la vie même de l’auteur, montrent quel paradoxal visionnaire était Pasolini : Transhumaner et organiser impressionne par son actualité. Le recueil aurait dû s’appeler les Six Premiers Chants du Purgatoire et autres poèmes communistes, mais Pasolini a finalement opté pour trasumanar — que Florence Pazzottu traduit par transhumaner, c’est-à-dire outrepasser l’humain, afin d’éviter des références contemporaines au transhumanisme (le verbe trasumanar venant de Dante, dans le premier chant du Paradis de la Divine Comédie [1321]), tandis que organizzar (organiser) fait référence à Gramsci.
Ces poèmes sont écrits, dit Pasolini, avec « sur mon dos la main sacrée et onctueuse de saint Paul/ qui […] pousse à faire ce pas ». « Transhumaner et organiser » signifie donc vivre sa vie dans la charité, comme un apôtre ; outrepasser des choses qui ne s’expliquent que par l’intelligence humaine, donc limitée et trompeuse. Une poésie au vocabulaire argotique ou latinisant, souvent « désagréable », qui tend au désenchantement poétique, et
« difficilement consommable », selon l’auteur.
Piété
Athée, Pasolini ? Dans son roman Actes impurs (1982), nous lisons cette troublante confidence : « J’ai connu pendant les mois les plus féroces de la guerre une expérience d’absolue solitude, qui a affiné extraordinairement ma vie spirituelle ; quand j’ai trouvé le nom de “mystique” pour cet état d’intériorisation, j’ai commencé à attendre la grâce — c’est-à-dire la possibilité de concevoir l’Autre, Dieu. » La poésie de Pasolini ne manifeste donc pas une simple curiosité pour des matières métaphysiques ni pour le vocabulaire religieux comme outil poétique. Dans Transhumaner et organiser, bien plus que de la fascination banale d’un non-croyant pour le monde religieux, on a affaire à une perplexité devant le sacré doublée d’une expérience de la grâce que Pasolini a réellement vécue — cette « religion naturelle », comme il appelait la foi de sa mère, Susanna, catholique pratiquante dont « l’imagination lui a soufflé une infinité de doutes ». Arrêtons-nous sur le poème « L’énigme de Pie XII », qui renvoie à la personnalité du pape Pie XII, resté silencieux devant le sort fait aux juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Selon Pasolini, cette passivité a plus tard engendré le « visage odieux » du laïcisme et de lois d’où la charité est exclue, « en vous interdisant toute compréhension qui soit d’amour et non d’intelligence », et qui « […] eh oui messieurs, est le fruit de la mauvaise religion./ En fait il est devenu, lui-même, dis-je une religion. » N’est-ce pas plus que jamais le cas aujourd’hui ?
Pasolini homosexuel ? Sans nul doute, mais voici le début de « La présence », poème qui clôt le livre, et peut-être le plus beau de Transhumaner et organiser : « Ce qui était perdu était céleste/ et l’âme malade, sainte ». Rédigés après la sortie de Médée (1969), ces vers nous rappellent les décors arides et austères du film, et aussi la tendresse profonde, voire l’amour étrange et si singulier que Pasolini éprouvait pour Maria Callas, pour qui cette adaptation de la tragédie grecque fut l’unique rôle au cinéma. « Il n’y a pas un jour, une heure, un instant/ où l’effort désespéré puisse cesser ;/ tu t’agrippes à n’importe quoi/ faisant venir l’envie de t’embrasser. »
Lumière
Cette année, qui marque le cinquantenaire de sa mort, voit aussi paraître la première traduction intégrale (et bilingue) du recueil Les Cendres de Gramsci, signée Jean-Paul Manganaro. Salué à sa sortie, en 1956, par Italo Calvino qui voyait là un événement poétique majeur, le livre rassemble, outre le poème éponyme, « L’Apennin », « Le chant populaire », « Picasso », « Meeting », « Récit », « Tableaux frioulans », « Une polémique en vers », « La plainte de l’excavatrice », « La Terre de Labour » : poèmes qui dressent un constat sur l’Italie de l’immédiat après-guerre, pauvre, par endroits en ruines, et qui évoquent aussi la déchirure intérieure du poète : un petit bourgeois (sa mère était institutrice et son père militaire) en proie à la désillusion marxiste et mal à l’aise devant le monde nouveau. C’est pourquoi les Cahiers de prison (1948) d’Antonio Gramsci, qui témoignent de la solitude du penseur dans le débat public et la bataille des idées, sont devenus si importants pour le Pasolini de cette période. Le marxisme, la linguistique, les questions civilisationnelles, médités par Gramsci, et notamment son concept d’« hégémonie culturelle », l’ont poussé à imaginer leur dialogue dans le cimetière des Anglais, à Rome, où repose le philosophe.
Composés entre 1951 et 1956, alors que ses convictions communistes chancelaient, Pasolini s’adresse personnellement à Gramsci pour lui confier son désir de faire partie de l’histoire et ses contradictions intérieures liées à son milieu plutôt aisé : « Pauvre comme les pauvres, je m’attache/ comme eux à d’humiliants espoirs, / comme eux pour vivre je me bats/ chaque jour. Mais dans ma désolante/ condition de déshérité, moi, / je possède : et c’est la plus exaltante/ des possessions bourgeoises, l’état/ le plus absolu. Mais tout comme je possède l’histoire, / de même elle me possède ; j’en suis éclairé :/ mais à quoi sert la lumière ? »
Lit-on vraiment Pasolini ? Regarde-t-on vraiment ses films ? Le monde culturel contemporain ne cesse de faire allusion à sa vision politique et culturelle : nombreuses sont les tentatives pour le placer à gauche ou à droite, sous les bannières de l’homosexualité, de l’athéisme, du marxisme, du catholicisme, etc.
Ses contradictions le plaçaient avant tout dans la tragédie d’un être paradoxal et en porte-à-faux, donc intempestif et critique à l’égard des valeurs, ou (plus souvent) des pseudo-valeurs, de la société dans laquelle il vivait. C’est ce qui rend sa pensée inclassable, donc irrécupérable, et son œuvre exemplairement plurielle.