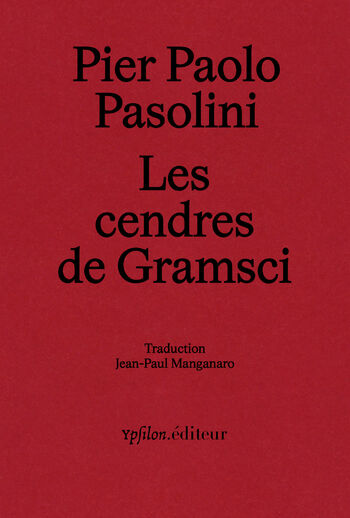25/03/2025
« Des mots en actes de baptême », par Emmanuel Laugier
Les Cendres de Gramsci paraît intégralement, soixante-huit ans après sa parution. Ce livre déchirant de Pier Paolo Pasolini, animé par la lutte des classes, la mélancolie, le vitalisme et la conscience de la dévoration du capitalisme à venir, possède la vigueur d’une nouvelle jeunesse.

En mars 1957, Pasolini corrige quelques vers de ce qui sera Les Cendres de Gramsci et envoie l’ensem ble aux éditions Garganzi. C’est pour lui à la fois en finir avec une période d’écriture révolue (les onze sections du livre ayant été publiées en revue entre 1951 et 1956) et marquer par ce livre « trente ans de passion et de travail ». Pourtant rien n’y est révolu, c’est plutôt un mouvement révolutionnaire qu’il opère, tant par la forme (il s’emploie essentiellement à reprendre la contrainte de la fameuse « terzina », tercet, de la Divine Comédie de Dante) que par une lecture politique et critique de l’histoire. Mais c’est par le mode d’un partage du sensible vitaliste et rageur qu’il s’y emploie. Les Cendres de Gramsci (très partiellement traduit en France en 1990) paraît un an après le XXe Congrès du PCUS en URSS, qui condamne Staline, suscite autant d’espoir que de consternation. L’invasion de la Hongrie aggravera le contexte. Le livre divise, agace. Son titre est d’abord un salut à un frère, plus qu’un hommage, à la figure de l’intellectuel marxiste et communiste que fut Gramsci, à l’épistolier des Lettres de prison et au penseur des Cahiers (29 volumes), écrits entre 1929 et 1935, Pasolini les découvrant dès 1948. Gramsci devient l’emblème d’une lecture vivifiante et hétérodoxe du marxisme jusqu’à perpétuer la volonté d’un communisme comme humanisme intégral. Cette logique d’engagement (organique et théorique) appelle un nouage entre pensée et praxis, elle ménage une place essentielle à la subjectivité de chacun, son autonomie à « mettre en crise » toute valeur factice de l’existence et de la société bourgeoise. Si Pasolini avec Les Cendres de Gramsci a peut-être mythifié l’innocence des lumpenprolétariats et autres communautés ouvrières, c’est aussi le transfert d’un élan de croyance et de combat (pour eux) digne de son Évangile selon Saint Matthieu (1964) qu’il y a insufflé.
Ce que Gramsci imaginait des convergences entre ouvriers et paysans, Pasolini le déploie à fleur de peau dans ses Cendres. Les onze sections, dans leur disparate, nouent en une unité sous-jacente « ce rêve d’une chose » (Marx) dont l’acte consisterait à « lier les marginalités ». C’est ce que magistralement Judith Balso (in Europe « Pasolini », n° 947/2008) montre de cette hargne politique anti-réactionnaire, laquelle s’incarne dans Les Cendres et fait de Pasolini un poète de l’expressivité et un lecteur aigu du réel et de ses effets d’abord non ouïs. Tendre l’oreille, en la collant sur le rail traversant une morne plaine, et y percevoir le bruit à venir du temps (dont celui d’une Italie vivante), telle est la logique d’écoute passionnelle que Pier Paolo Pasolini tente : « rasant les anciens murs//et les tufs de l’abattoir, il s’y imbibe/de sang putride, et de toute part/agite ordures et odeur de lisière.//C’est un bruissement, la vie, et ceux perdus/en elle, la perdent sereinement,/si leur cœur en est plein : à jouir […]//et puissant/en eux ».
Cette passion expressive fait violence aux normes métriques, elle tord le phrasé, en recourant à l’accumulation syntaxique, à la redondance, au baroque de figures croisées (allitérations et paronomases, ajouts et suppressions de pieds à des rythmes normés, etc.), afin de viser et de perforer l’institution, sous quelque forme qu’elle prend. L’écrivain Walter Siti (dès 1972) indiqua le mouvement de ce livre : « C’est un langage qui construit, qui juge, qui qualifie politiquement les choses, mais au lieu de se déployer dans sa dimension indépendante, il vient au contact d’une mesure stylistique autre, qui se trouve comme humiliée ». L’impureté du rythme et le « malheur métrique » des Cendres, enchaînés qu’ils sont en ces tercets, œuvrent aux « denses noyaux » lyriques du chant pasolinien. Ces « poemetti » (à l’inverse du « poema » épique) ont le pouvoir de « remplacer l’analogique par la logique, la grâce par la méthode ».
Avec les poèmes frioulans de La Nouvelle jeunesse (1941-1971), ceux de La Religion de mon temps (1961), Poésie en forme de rose (1964), Transhumaniser et organiser (1971) et bien sûr le poème filmique La Rage (1963), c’est tout « l’amour de l’humble, la compétence en l’humilité » (Gianfranco Contini) que Pasolini se sera employé à cerner dans la vitalité d’une langue des marges. Cette passion, le cri tique Giuseppe Leonelli la dit « omniprésente, et comme tout ce qui apparaît (elle risque) un infléchissement de soi : être avec Gramsci et contre Gramsci, à l’intérieur et à l’extérieur du monde, fermé sur lui-même et perdu dans les rues les plus reculées ». Les Cendres de Gramsci la représente au plus haut point, par la structure de chaque poème et par leurs préoccupations en miroir : le devenir de l’Italie des années 1950, la question méridionale et celle de l’Afrique, la question de l’habitation (campagnes et faubourgs), les luttes partisanes (son frère assassiné Guido) et enfin « une interrogation insistante sur la validité de la catégorie d’histoire » (Judith Balso).
Ajoutons à cette unité la propension de Pasolini à parier sur la division comme puissance réfractaire et pensée des inconciliables. On peut lire Les Cendres de Gramsci comme la méthode d’un esprit qui ne cesse de se diviser en deux, ainsi dans les vers de « L’Humble Italie », les hirondelles tournent sur les petites places, « Ici les vents africains brûlent/l’hiver ensoleillé : naissent/des charniers de fleurs, c’est déjà l’été/Les gamins dans des poches/déjà impures glissent leurs mains ». Des poches où de nouveaux gestes vrais se créent, non sans violence, non sans pugnacité.