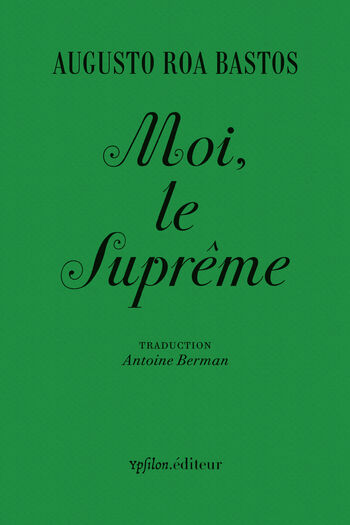26/06/2020
« Le tyran qui lisait Candide », par Philippe Lançon
En 1967, il n’y a pas que les guerres du Vietnam et des Six Jours, de Gaulle, les Beatles et les Rolling Stones. Il y a aussi le chaudron politique et littéraire latino-américain. Cette année-là, le Péruvien Mario Vargas Llosa (ou le Mexicain Carlos Fuentes, selon une autre version) propose à quelques écrivains de cette région du monde d’écrire une nouvelle sur « son » dictateur. Ils ont l’embarras du choix, sur le fond et sur la forme. Le dictateur : est-ce un sujet, une mode, un personnage, une métaphore, une création, un destin ? C’est en tout cas une ombre familière et démesurée projetée sur les peuples.
Dans le Mot magique, l’un des destinataires de Vargas Llosa (ou de Fuentes), l’écrivain guatémaltèque Augusto Monterroso, écrit : « Parmi les multiples choses que l’Amérique latine n’a pas inventées, il y a les dictateurs, qu’ils soient folkloriques ou même sanguinaires. Les dictateurs sont aussi vieux que l’Histoire, mais nous autres, nous nous sommes empressés d’assumer joyeusement cette responsabilité, tandis qu’en Europe, où l’on a eu du mal à vivre sans eux depuis que les Romains leur ont donné un nom, les gens ont commencé à penser il y a quelques années que, tiens donc, c’est drôle, comment les Hispano-Américains peuvent-ils imaginer des types aussi bizarres ? oubliant qu’eux-mêmes sortaient à peine de Salazar, Hitler, Mussolini, sans compter Franco, toujours en vie. »
Massif littéraire
Le projet de Vargas Llosa (ou de Fuentes), faute de textes, est abandonné. Cependant, il a peut-être stimulé l’écriture de trois romans publiés dans la décennie suivante : l’Automne du patriarche, de Gabriel Garcia Marquez, en 1975 ; le Recours de la méthode, d’Alejo Carpentier, en 1974 ; et, la même année, Moi, le Suprême, d’Augusto Roa Bastos. « Je veux croire, écrit Monterroso, que Roa Bastos a trouvé qu’une nouvelle était bien trop courte pour tout ce qu’il avait à dire dans un roman. » L’écrivain paraguayen entreprend Moi, le Suprême en 1968. Il lui faudra six ans pour l’écrire. Le résultat est à la hauteur du silence qui l’a précédé : un sommet de ce massif littéraire hispanique constitué par les « romans de dictateur ». Ce sont des années où le formalisme, l’ambiguïté et la recherche d’un langage performatif nourrissent l’intelligence du récit. Si un chef-d’œuvre est un monde où le lecteur se multiplie en se perdant, Moi, le Suprême en est un. Ecoutons le dictateur, qui est un lettré : « Origine de l’écriture : le Point. Unité infime. De même que les unités de langue écrite ou parlée sont à leur tour de petites langues. […] Le Pouvoir Absolu est pareillement fait de petits pouvoirs. Je puis faire par les autres ce qu’ils ne peuvent faire par eux-mêmes. Je puis dire aux autres ce que je ne puis me dire à moi. Les autres sont des lunettes grâce auxquelles nous lisons dans nos propres esprits. » Ainsi fait l’écrivain, ce Suprême sur papier.
Exil en France
Le livre est d’abord publié en Argentine, où les militaires n’ont pas encore pris le pouvoir et où Roa Bastos vit en exil depuis 1947, animant un atelier d’écriture avec le romancier Ernesto Sabato. En 1977, il est publié par les éditions Belfond. Antoine Berman, qui le traduit, est un théoricien de la traduction. Il meurt en 1991. Augusto Roa Bastos reçoit le prix Cervantès en 1989, l’année où il retourne au Paraguay après la chute du dictateur Alfredo Stroessner. Il meurt en 2005. En France, où il a vécu en exil de 1976 à 1989 et enseigné à Toulouse le guarani (la langue des Indiens du Paraguay, une langue populaire qui est aussi parlée par tous dans le pays), le livre était devenu indisponible. Un nouvel éditeur, Ypsilon, le republie dans la même (et excellente) traduction. C’est une belle édition, soignée. La couverture est d’un vert violent comme ce qu’il reste des forêts subtropicales du Paraguay. La mise en page particulière, liée à la forme du récit, est celle voulue par Roa Bastos. Elle rappelle certains livres de Claude Simon ou d’Alain Robbe-Grillet. Raymond Roussel a influencé l’auteur. Le texte est suivi d’une interview inédite, où il explique au traducteur son parcours, comment il a écrit son livre. L’œuvre est infiniment complexe. Ce qu’il en dit est clair, simple et modeste.
En 1968, Roa Bastos a 50 ans. Il en avait 15 lorsqu’il a participé à la guerre meurtrière du Chaco contre la Bolivie (1932-1935). Pour la deuxième fois en un siècle, elle fit du Paraguay une peau de chagrin habitée par des veuves. Ensuite, tout en écrivant des poèmes, des romans, des recueils de nouvelles, il a été reporter et scénariste. Il est correspondant de guerre à Londres, au moment où les bombes allemandes y tombent. La discipline fataliste des Anglais l’impressionne. Dans un train qui le conduit à Glasgow, il rencontre et interviewe le violoncelliste Pablo Casals. A Edimbourg, il s’entretient avec un grand poète espagnol exilé depuis la guerre civile : Luis Cernuda.
Lui-même, bientôt, s’exilera. Ce qui le préoccupe, c’est de restituer le chant profond d’un peuple, dans toutes ses dimensions. Ce peuple est à la fois indien, espagnol, métis ; il est essentiellement paysan et bilingue. La langue indienne, le guarani, est orale, agglutinante ; elle crée des concepts à travers des objets à la fois concrets et imaginaires, comme le « météore-hasard ». La langue espagnole est celle de l’école, de l’écrit. Elle n’est ni agglutinante, ni adaptée à l’abstraction concrète propre aux Indiens. Moi, le Suprême perturbe cette langue (et donc, la langue française, qui a les mêmes qualités et les mêmes limites) en la faisant travailler contre elle-même. La multiplication des néologismes, des mots-valises, n’est pas un artifice. C’est une façon d’agglutiner à l’indienne les idées, les objets, et de mettre de l’oral dans une forme qui lui résiste. Dans un entretien donné en 1976 à la télévision espagnole, Roa Bastos explique qu’au Paraguay, quand quelqu’un veut exprimer quelque chose d’essentiel, lié à une émotion profonde, « il est fréquent qu’il le dise en espagnol, puis le répète en guarani ».
Moi, le Suprême est un livre où il n’y a que des voix et des documents. Les actions, les descriptions, les souvenirs, les réflexions, tout passe par elles et par eux. Parfois, le dictateur parle ou dicte des textes à son secrétaire, Patiño. Parfois, il raconte sa vie et défend ses actions dans une « circulaire perpétuelle ». Parfois, il écrit dans son « cahier privé ». Mais ce cahier, ces circulaires, sont eux-mêmes interrompus par un « correcteur » ultérieur, agressif, qui entre sans y avoir été invité. Et souvent, en bas de pages qui finissent par constituer des pages entières sur d’étroites colonnes, il y a des « notes du compilateur ». Ce sont, entre autres, des témoignages de voyageurs étrangers de l’époque, comme ceux des frères Robertson, des Anglais. La rencontre imprévue de l’un d’eux avec le dictateur, dans la nuit, après une partie de chasse, est une merveille de précision et de magie. Elle révèle les multiples aspects du personnage et justifie l’une de ses sentences : « La raison du mystère est le mystère lui-même. » Les différentes formes de récit se chevauchent, se complètent, se rectifient, se contredisent, se répondent, s’éclairent, s’informent, se désinforment, se pervertissent. A la télé espagnole, Roa Bastos a expliqué cette composition chorale : « Le Paraguay, pour moi, a toujours été un grand miroir lumineux et brisé. J’ai essayé de réunir les morceaux, pour que puisse de nouveau se dessiner l’image profonde d’une collectivité. »
Scribe obséquieux
Le roman s’ouvre sur un « pasquin », une parodie anonyme qu’on a clouée sur le portail de la cathédrale d’Asunción. Elle commence par ces mots : « Moi, le Suprême… » Le dictateur y proclame sa propre mort et exige que son cadavre soit décapité, sa tête placée au bout d’une pique place de la République trois jours durant. Qui l’a écrit ? Pourquoi est-ce écrit sur le papier dont il se sert exclusivement ? Qui a eu accès à ce papier ? Le dictateur enquête, réfléchit, parle sans fin de la mesquinerie et de l’inutilité des écrivaillons, avec Patiño. Ce scribe obséquieux est méticuleux, doué d’une grande mémoire, mais le Suprême ne cesse de l’engueuler, de l’éduquer, en regrettant qu’il ne soit pas un perroquet : « Pourrais-tu inventer un langage dans lequel le signe serait identique à l’objet ? Y compris aux objets les plus abstraits, les plus indéterminés ? L’infini. Un parfum. Un rêve. L’Absolu. Pourrais-tu faire que tout cela se transmette à la vitesse de la lumière ? Non. Tu ne le peux pas. Raison pour laquelle tu es trop et pas assez, tout comme en ce monde bavards et menteurs abondent, tandis que les honnêtes gens font défaut avec un remarquable acharnement. »
Ce dictateur, José Gaspar de Francia, n’est d’abord pas une créature de roman. C’était un terrible honnête homme, le père de l’indépendance et de l’autonomie du Paraguay. Il est né en 1766, sept ans après la publication de Candide, qu’il a lu. Au chapitre XIV du roman de Voltaire, le héros et son serviteur, Cacambo, arrivent au Paraguay. Le second connaît bien le pays. Il dit à son maître : « C’est une chose admirable que ce gouvernement. Le royaume a déjà plus de trois cents lieues de diamètre ; il est divisé en trente provinces. Los padres y ont tout et les peuples rien ; c’est le chef-d’œuvre de la raison et de la justice. » Candide et Cacambo font irruption, comme Don Quichotte, comme le marquis de Sade, comme d’autres, dans la conscience du dictateur qui parle, qui écrit ; mais ils le font comme des personnages réels. Ils ont rencontré le grand homme et participé à l’histoire du pays.
Ancien élève du séminaire des jésuites, Francia est aussi francophile que Roa Bastos. Il lit Pline l’ancien, César, Cervantès, Rabelais, Montaigne, Pascal, Rousseau, Diderot, Voltaire. Il admire aussi Robespierre et Napoléon. Nommé consul d’une junte en 1811, il devient rapidement dictateur à vie et le reste jusqu’à sa mort, en 1840. Le roman, qui n’a rien de chronologique, déploie ses ondes sur une période beaucoup plus longue, puisqu’il prend fin en 1973, l’année où s’achève sa propre écriture. On a compris alors, depuis longtemps, que le Suprême n’est plus qu’un crâne enfermé dans une boîte à nouilles, que sa sépulture a disparu (ce fut le cas dans la réalité). Dans l’entretien à la télévision espagnole, Roa Bastos explique : « Dans mon roman, il y a un point de départ, un personnage historique, qui n’est qu’un point de départ […], et il y a une part mythique : qu’arrive-t-il au pouvoir absolu face à la précarité, à la solitude de celui qui porte ce pouvoir ? Car cette passion de l’absolu est l’un des plus anciens cauchemars de l’espèce humaine… » Moi, le Suprême déploie ce cauchemar, dans les formes du cauchemar. Quoi d’autre pourrait les accueillir, sinon un crâne vide ?
Jésuites liquidés
L’obsession de Francia était de libérer son pays des pouvoirs étrangers, religieux, culturels, financiers qui l’ont dominé ou convoité. Qu’il y soit parvenu en fera peut-être, aujourd’hui, rêver plus d’un. L’indépendance et l’égalité totales sont en effet les objectifs qui, au départ, l’animent. Il liquide les jésuites, les militaires et les élites à la solde de l’Espagne ou des Argentins. Grâce à lui, tout le monde apprend à lire, compter, écrire, phénomène alors unique en Amérique latine ; mais il ferme collèges et séminaires : l’éducation s’arrête à la fin du primaire. Il veut réduire à rien l’espace politique et culturel qui sépare le dictateur du peuple. Cependant, par haine de l’anarchie, la révolution est soumise à un fouet de fer. Les Indiens qui pillent sont massacrés, les prisons se multiplient. Il élève une « pépinière de rats », qui l’aide à voir comment agir sur les hommes. L’ordre et la paix règnent. Le peuple, correctement nourri, est satisfait.
Sous le règne de Francia, on ne peut entrer ni sortir du pays, ni circuler dedans, sans l’autorisation du dictateur. Le naturaliste français Aimé Bonpland sera retenu pendant dix ans, puis soudain expulsé. Dans le roman, il dit le jour de son départ : « Je sais très bien que le Suprême est inexorable dans sa rigueur comme il est implacable dans sa bonté. Quand il ne le voulait pas, aucune force au monde ne pouvait m’arracher d’ici. Maintenant, il croit que je dois partir, et aucune force au monde ne pourra le faire revenir sur sa décision. Il en fut bien ainsi, don Aimé. Les pages de cette terre vous ont vraiment appris quelque chose. » Dans ce passage, ce sont deux morts qui parlent : le naturaliste, puis, dans les deux dernières phrases, le dictateur. Tout au long du livre, les voix se mêlent comme ça, sans guillemets, sans artifice typographique, sans transition, sans que jamais pourtant on ne puisse les confondre. Elles dialoguent à travers l’espace, le temps. Le livre enferme son lecteur dans un pays étouffant et magique. Il en fait un explorateur, le naturaliste d’une épopée humaine.
Dans l’entretien à la télévision espagnole, Augusto Roa Bastos disait : « Je crois que l’écrivain n’est qu’un médiateur. L’important, ce sont les livres. » La publicité sur l’auteur le gênait, « d’abord parce que je suis timide, ensuite et surtout parce qu’il me semble que ce qu’on ne peut améliorer avec des mots, mieux vaut le laisser au silence ». Moi, le Suprême s’achève donc, logiquement, sur une « Note finale du compilateur », autrement dit, sur l’un des masques de l’écrivain avalé par sa propre création. « La présente compilation, écrit-il, a été tirée - il serait plus honnête de dire soutirée - de quelque vingt mille dossiers publiés ou inédits ; d’une quantité égale de volumes, feuilletons, journaux, correspondances et témoignages cachés, consultés, épiés et récoltés dans des bibliothèques et des archives officielles et privées. Il faut ajouter à cela les versions recueillies dans les sources de la tradition orale, et quelque quinze mille heures d’entrevues enregistrées au magnétophone, alourdies par des confusions et des imprécisions ; ces entrevues ont été faites aux descendants présumés du Suprême, qui s’est toujours vanté de n’en avoir aucun ; à des épigones, des panégyristes et des détracteurs non moins nébuleux et présumés. » Bref, « à l’inverse des textes ordinaires, celui-ci a d’abord été lu, et ensuite écrit ».
Chez des écrivains publicitaires, une telle déclaration aurait l’air d’une tentative d’intimidation ou d’un accès de fausse modestie ; mais, outre que la note finale n’est pas un post-scriptum, puisqu’elle fait partie du récit, elle rappelle comment les multiples traces de la réalité ont conduit le lecteur dans les forêts profondes et indéterminées de la fiction : « Ainsi, imitant encore une fois le Dictateur (les dictateurs remplissent justement cette fonction : remplacer les écrivains, les histoires, les artistes, les penseurs, etc.), le compillateur déclare, en reprenant les termes d’un auteur contemporain, que l’histoire contenue dans ces Notes se réduit au fait que l’histoire qui devait y être contée n’a pas été contée. Par conséquent, les personnages et les faits qui y figurent ont gagné, par la fatalité du langage écrit, le droit à une existence fictive et autonome, au service du non moins fictif et autonome lecteur. » L’auteur auquel Roa Bastos fait allusion, c’est Robert Musil : la phrase se trouve dans l’Homme sans qualités. L’écrivain est un homme sans qualités. Il se confronte à l’impossibilité d’écrire absolument l’histoire, le langage et la vie d’un peuple, de même que le dictateur se confronte à l’impossibilité d’exercer sur ce peuple un pouvoir absolu. L’un et l’autre sont solitaires, tout-puissants, perdus. Ce sont des morts où circulent, comme des courants d’air, les voix qu’ils contrôlent et qui leur échappent.
Trente ans plus tôt, Roa Bastos écrivait sa première nouvelle, « Lutte jusqu’à l’aube ». Il y était déjà question de Francia. Ce texte de jeunesse avait été perdu, oublié peut-être. L’écrivain le retrouva par hasard, au moment où il effectuait des recherches pour son roman. Il était rangé entre les pages du Traité de la peinture de Leonard de Vinci.