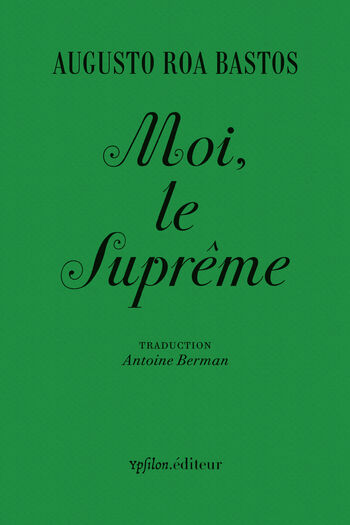5/04/2020
« Dans le “trou noir du pouvoir absolu” d’un caudillo paraguayen », par Ludovic Lamant
Augusto Roa Bastos a tressé le monologue d’un héros de l’indépendance du Paraguay, devenu dictateur « suprême et perpétuel » de 1814 à 1840. Texte majeur en Amérique latine, Moi, le Suprême, publié en 1974, ressort en France.
Dans la littérature latino-américaine, Moi, le Suprême, publié en 1974 en Argentine, appartient à un genre bien balisé au XXe siècle, le « roman de dictateur ». Le texte est souvent rapproché du Recours de la méthode (1975), du Cubain Alejo Carpentier, de L’Automne du patriarche du Colombien Gabriel García Márquez (1975) ou encore, plus récemment, de La Fête aux boucs du Péruvien Mario Vargas Llosa (2000).
Mais l’expérience de lecture imaginée par Augusto Roa Bastos, un journaliste et écrivain paraguayen (1917-2005), ne renvoie à rien d’autre. Les éditions Ypsilon viennent de republier la traduction française d’origine, réalisée en 1977 par Antoine Berman, en prenant le parti de conserver l’agencement graphique de l’édition originale (chez Siglo XXI) – que les précédentes éditions françaises ne respectaient pas.
C’est loin d’être un détail, tant Moi, le Suprême est une construction architecturale virtuose, enchâssement de discours programmatiques et de confessions murmurées et délirantes, compilation de circulaires administratives, de mémoires d’aventuriers et de notes de bas de page techniques, qui déboulonnent tout à la fois la statue du dictateur et le statut de l’auteur.
Ce texte, pour lequel Roa Bastos a reçu le prix Cervantès en 1989, évoque la figure du « père » du Paraguay, José Gaspar de Francia, héros de l’indépendance (1813) devenu dictateur « suprême et perpétuel » de ce petit pays logé entre l’Argentine et le Brésil, de 1814 à 1840. Il cohabitait à l’époque avec les grands généraux des indépendances sudaméricaines, de Simón Bolívar à San Martín, en passant par Manuel Belgrano, mais il parvint, lui, à fonder un pays indépendant du joug des Espagnols.
Roa Bastos déroule le portrait d’un tyran malade et en fin de vie, admirateur de la philosophie des Lumières, obsédé par l’astrologie et les pierres précieuses, qui n’a jamais capitulé à l’idée de forger une « Confédération des États libres d’Amérique latine » – une utopie calquée sur le modèle des États-Unis d’Amérique, qui n’adviendra pas. Sentant la mort approcher et cible de tentatives de déstabilisation dans le pays, il reconstruit l’histoire de son règne, à travers un exercice de dictée à son secrétaire, Polycarpe Patiño.
Le délice du texte vaut aussi pour la galerie de portraits que le caudillo dresse : les anciens partisans du régime devenus traîtres à la cause (des « pasquins »), les émissaires argentins et brésiliens qui manigancent pour reconquérir le Paraguay, en vain (ses innombrables « visiteurs-plénipotentiairesespions-négociateurs »), les aventuriers, commerçants et médecins – suisses, français ou britanniques – passés par le Paraguay, et qui ont, un temps, fréquenté le « Suprême ». Souvent, le texte juxtapose le monologue du grand homme et les extraits – véritables – des mémoires des hommes en question.
Le procédé pourrait paraître lourd, il se révèle d’une grande efficacité, idéal pour passer d’un point de vue à l’autre, et produire d’étonnantes accélérations et éclats d’intelligence. Par exemple lorsque le caudillo revient sur les subterfuges déployés pour humilier un énième envoyé de Buenos Aires en 1813, lequel, dans ses mémoires reproduits en notes de bas de page, décrit avec emphase les méthodes de tyran du « Suprême ». Par endroits, le livre devient un dossier de pièces à conviction, reproduisant in extenso les correspondances, par exemple celle avec Simón Bolívar himself.
Cet abandon lugubre dans le « mystérieux trou noir du pouvoir absolu », selon l’expression de l’auteur, dans un entretien réalisé en 1978 (et reproduit en postface), passe par la quasi-absence, au cours des 500 pages, de passages descriptifs. Impossible de dire exactement à quoi ressemble le dictateur. Le texte s’organise autour d’une parole du « Suprême » dédoublée : la « circulaire officielle » (la leçon d’Histoire faite à Patiño) et le « cahier privé », plus intime, où il semble parfois s’adresser à un éventuel successeur.
Une troisième strate s’ajoute, déjà mentionnée : les notes de bas de page et éclairages historiques, nombreux, qui complexifient – et ridiculisent parfois – le monologue délirant du tyran, rassemblés en général sous l’expression de « note du compilateur ». « Compilateur » et non « auteur » : la différence est majeure. Roa Bastos, né à Asunción en 1917, et qui a dirigé le principal journal indépendant du Paraguay avant de fuir le pays après le coup d’État de 1947, dit avoir voulu « supprimer l’auteur traditionnel », en finir avec la conception d’un auteur propriétaire de son œuvre et de ses personnages.
Moi, le Suprême porte autant sur l’exercice du pouvoir quotidien au Paraguay (avec les paysans, les indigènes, les militaires, etc.) que sur les puissances de l’écriture, dans laquelle le caudillo, ivre de paroles, s’enferme. Ses doigts finissent par dégouliner de sang alors qu’il écrit. Roa Bastos consacre des pages surprenantes au porte-plume du « Suprême », doté d’une « lunette-souvenir » à une extrémité, qui devait lui permettre d’observer des « métaphores optiques » en même temps qu’il écrivait, et que lui, Roa Bastos, jure avoir récupérée en 1947.
Après s’être installé à Buenos Aires en 1947, d’où il écrivit ses premiers textes de littérature, Roa Bastos dut fuir l’Argentine après le coup d’État militaire de 1976. Il poursuivit sa vie d’exilé à Toulouse (où il enseigna le guarani, l’une des langues officielles du Paraguay), avant de revenir dans son pays à la chute d’Alfred Stroessner, en 1989. Le cas Stroessner fait l’objet d’un autre livre (Le Procureur, traduction de François Maspero, Seuil, 1997), mais son ombre plane bien sûr déjà dans Moi, le Suprême. Il n’est pas exclu, non plus, de reconnaître bien d’autres caudillos plus contemporains, du Brésil et d’ailleurs, dans les traits de ce « Suprême » du XIXe siècle.