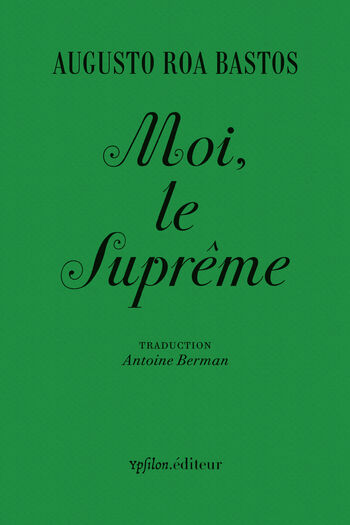9/06/2020
« Trois raisons de (re)lire “Moi, le Suprême”, la fresque historique du Paraguayen Augusto Roa Bastos », par Youness Bousenna
Grande figure de la littérature sud-américaine, l’écrivain a dépeint la vie du dictateur et fondateur du Paraguay José Gaspar de Francia dans le magistral “Moi, le Suprême”. Paru en 1974, cet époustouflant récit est aujourd’hui réédité par les éditions Ypsilon.
Paru initialement à Buenos Aires en 1974 et traduit par Antoine Berman pour Belfond trois ans plus tard, Moi, le Suprême avait été republié au Seuil en 1993. Trente ans après sa dernière édition en France, le chef-d’œuvre d’Augusto Roa Bastos était épuisé. Les éditions Ypsilon viennent de réparer cette carence en proposant une élégante édition du roman paraguayen, ponctuée par un entretien entre l’auteur et Antoine Berman, qui nous offre l’occasion de (re)découvrir l’époustouflante fresque biographique conçue par Roa Bastos.
1. Parce que Roa Bastos est un écrivain majeur de la littérature paraguayenne
Augusto Roa Bastos a eu une existence au diapason des soubresauts du XXe siècle. Né en 1917 à Asunción – où il mourra, en 2005 –, il est l’un des plus grands écrivains de la littérature paraguayenne, couronné par le prix Cervantes en 1989. Imprégné par la lecture précoce de la Bible et de Shakespeare, il signera des poèmes, des contes et deux romans majeurs, Fils d’homme (1960) et Moi, le Suprême (1974), qui puisent leurs motifs dans les nœuds de l’histoire sud- américaine – la dictature, le christianisme, la tradition amérindienne. Roa Bastos, hispanophone mais qui a appris le guarani dans son enfance, écrit d’ailleurs dans ces deux langues qui fondent l’identité paraguayenne.
Mais l’écrivain fut aussi un homme de combats. Au début des années 1930, il participe, à 15 ans, à la guerre du Chaco qui oppose son pays à la Bolivie. Correspondant de guerre pour El País, Roa Bastos connaît aussi une carrière de journaliste qui le conduit à voyager en Europe. Et d’abord à s’initier à l’exil : en 1947, la guerre civile au Paraguay le pousse à vivre en Argentine – c’est de Buenos Aires qu’il écrira ses premières œuvres –, puis, après le putsch de 1976, à trouver refuge en France. Il enseigne alors la littérature sud-américaine à l’université de Toulouse, et ne reviendra dans son pays qu’à la chute de la dictature d’Alfredo Stroessner, en 1989.
2. Parce que le thème du roman est omniprésent dans la littérature latino-américaine
La littérature ne chemine jamais loin du pouvoir en Amérique latine, où coups d’État et dictatures de caudillos ont rythmé l’histoire moderne de ce continent uniquement composé de républiques. Une originale initiative littéraire a même été lancée en 1967 par l’écrivain et essayiste mexicain Carlos Fuentes et son camarade péruvien Mario Vargas Llosa. Ils imaginent un grand volume collectif, Los Padres de las patrias (Les Pères des patries), composé de nouvelles d’une cinquantaine de pages écrites par des écrivains sur leur « tyran national favori ». Pour ce projet, qui intéressait Gallimard, Carlos Fuentes mentionnait, en 1986 au New York Times, une alléchante liste d’auteurs : outre Augusto Roa Bastos, il citait l’Argentin Julio Cortázar, le Colombien Gabriel García Márquez, le Vénézuélien Miguel Otero Silva ou encore le Cubain Alejo Carpentier.
Finalement, l’ouvrage ne verra pas le jour – trop ambitieux, confie Fuentes. Mais plusieurs livres sur le pouvoir émergeront de la période. Le Recours de la méthode, d’Alejo Carpentier, est publié en 1975, tout comme L’Automne du patriarche, de Gabriel García Márquez. Un an plus tôt, Roa Bastos tirait Yo el Supremo de son exil argentin, peignant la vie du père du Paraguay, José Gaspar de Francia – pays qu’il gouverna de 1815 à sa mort, en 1840, sous le titre de « Dictateur suprême et perpétuel ».
3. Parce que “Moi, le Suprême” est une magistrale fresque politique et métaphysique
Mais Moi, le Suprême dépasse largement la simple chronique historique sur un dictateur. Pour éviter les pièges d’un roman enfermé par son motif, Augusto Roa Bastos – qui revendique une « pure œuvre de fiction » – a imaginé une narration singulière : la voix qui porte le récit biographique est celle de José Gaspar de Francia, à travers la dictée de ses souvenirs à son secrétaire particulier et des extraits de son journal personnel – l’écrivain n’intervient qu’en tant que « compilateur », et investit les notes de bas de page pour glisser des passages (réels) des Mémoires de ceux qui ont approché ou côtoyé le « Suprême ». Grâce à ce procédé en forme de collage, Roa Bastos tisse un monde que le lecteur voit à travers les yeux du dictateur.
Son introspection sera donc la nôtre, et là est l’autre intelligence de l’écrivain : offrir une grandeur métaphysique à son personnage, et se saisir du roman pour réfléchir à l’écriture du destin et à l’illusion des mots face à la mort. « Cette contradiction entre l’écriture et la condamnation de l’écriture est le dilemme principal du personnage imaginaire du roman », explique Roa Bastos dans l’éclairant entretien qui achève la réédition. Mais, poursuit-il, la mémoire ne peut « récupérer des “zones” perdues de la vie, de la conception de la vie, de l’intériorité et de l’existence mystérieuse de chaque intériorité [que] par la parole, les mots. La mémoire ne se met en marche, ne se déploie que grâce à la parole. Il n’est donc pas surprenant que l’auteur ou le compilateur sente que la parole est trompeuse, mensongère ; qu’elle constitue un masque qui, au lieu de révéler, cache ce qu’il veut exprimer ». Écrire ou ne pas écrire, telle est donc la question.