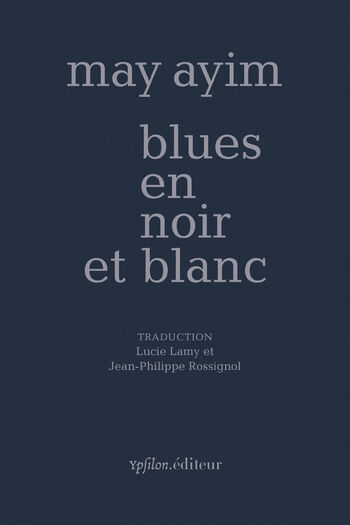21/12/2022
May Ayim, poétesse afro-allemande, entretien avec Lucie Lamy et Jean‑Philippe Rossignol, traducteurs, par Fabien Ribery
Dans la sphère francophone, le nom de May Ayim, poétesse afro-allemande, est quasiment inconnu.
Il fallait le beau travail de traduction de Lucie Lamy & Jean-Philippe Rossignol, l’enthousiasme et le savoir-faire d’une éditrice de nécessité, Isabella Checcaglini (éditions Ypsilon), pour découvrir une œuvre s’énonçant dans une langue de rage et de paix, sans excès de formalisme et hautement percussive, contre tous les racismes.
Le passage en français d’une telle poésie, concrète, de combat, hautement sensible sans effet de sentimentalisme, agrandit notre sensation de la liberté, par notre langue elle-même réinventée.
Lucie Lamy et Jean-Philippe Rossignol présentent ici une voix de grande singularité, très émouvante dans l’éclatement de ses points de vérité.
à minuit
la grêle se détachait
des nuages
ma solitude a explosé dans le silence
tu as entendu son écho
au matin
Dans quelles circonstances avez-vous rencontré pour la première fois la poésie de May Ayim ?
Lucie Lamy : Dans les années 2010, je tombe sur un article : le quai Groeben à Berlin, qui portait le nom d’un colonisateur allemand, avait été renommé quai May Ayim à l’issue d’une mobilisation citoyenne. Les vers extraits du poème « sans limites et sans honte » que l’article citait m’ont émue au point que j’ai eu envie d’en lire plus. C’est comme ça que j’ai découvert les deux recueils de poèmes : blues en noir et blanc et chant nocturne. Quand nous nous sommes mis à les traduire, nous nous sommes plongés aussi dans ses articles et ses essais.
Jean-Philippe Rossignol : C’était en 2020, pendant la préparation du numéro 27 de la revue Litterall. Nous cherchions des textes allemands contemporains à traduire en français. Notre angle d’attaque ? Trouver des écritures qui proposent un décalage, une vision et des imaginaires singuliers. Lors de nos échanges avec le collectif, accords et désaccords mêlés, Lucie a évoqué May Ayim, sa poésie, sa trajectoire. Ce qu’elle en disait était troublant quant à la situation politique du monde actuel. J’ai découvert blues in schwarz weiss. À Berlin, Lucie et moi avons traduit « hors du cadre ». C’était notre premier poème traduit à quatre mains et sans le savoir, le début d’une aventure poétique.
Quelle place occupe cette auteure dans la poésie contemporaine allemande ?
JPR : May Ayim se situe hors champ. Loin des cercles traditionnels d’influence. C’est une poésie de combat, donc ça se pratique à la marge. Mais la marginalité des années 90 est aujourd’hui lue, commentée, défendue. La Freie Universität de Berlin dispose d’un fonds May Ayim et son œuvre est une source d’inspiration pour une génération d’artistes et d’activistes qui s’inventent d’autres modèles. Il n’empêche que les luttes dont parle Ayim sont, elles, toujours à mener. Beaucoup de discours, mais peu d’actes.
LL: Difficile de répondre, même si, en effet, May Ayim est beaucoup lue depuis plusieurs années. Lorsqu’elles abordent le racisme, les œuvres contemporaines allemandes la citent fréquemment. Mais j’ai le sentiment que sa réception n’est pas encore émancipée des étiquettes qui la poursuivaient déjà de son vivant, et que ses textes sont parfois réduits à la « thématique » du racisme plutôt que d’être abordés par la langue. Cela dit, c’est une perception subjective et je pense que c’est en train de changer.
May Ayim, qui connut le traumatisme de l’abandon, est née en 1960 à Hambourg d’une mère allemande et d’un père ghanéen. Quel héritage a-t-elle reçu ?
JPR: Comment vit-on la situation d’être une déshéritée de l’amour au sens propre ? Je ne sais pas. J’ai la sensation que ce trauma est contenu dans le sens qu’elle donne aux “relations lointaines”. Dans ce poème, elle écrit : “sur ma peau / des baisers d’ombre en passant.” Son legs, ce ne sont pas des baisers, ce sont des baisers d’ombre. Et encore : ils ne font que passer.
LL : Peu après sa naissance, May Ayim est placée dans un foyer, puis dans une famille d’accueil, les Opitz. Ce qu’elle « reçoit » d’abord de ses parents, c’est l’expérience du rejet.
Le contact avec son père n’a jamais été totalement interrompu. Il lui rendait visite de temps en temps quand elle était petite, elle l’appelait « oncle Emmanuel ». C’est seulement pendant sa vie d’adulte qu’elle crée un lien avec lui et sa famille africaine. Elle voyage au Ghana dans le village de son grand-père et au Kenya dans la nouvelle famille fondée par son père. Ces rencontres restent sporadiques, mais les échos à la culture ghanéenne nourrissent sa poésie, via les « adinkra », ces motifs qui scandent le recueil, et les figures mythologiques comme afrekete. Ce n’est pas un héritage « reçu », mais construit.
À l’inverse, elle n’a jamais eu de contact avec sa mère et ne connaît rien de son histoire familiale en Allemagne. Au sein de la famille Opitz, elle est confrontée au racisme dès le plus jeune âge, malgré les bonnes intentions qui animent ses parents d’accueil. De ces trois constellations familiales, May Ayim reçoit peu de choses qui iraient dans le sens d’un héritage. Ses écrits parlent plus de rupture que de transmission.
Ne cessant de lutter, en textes et présence performée, contre le sexisme, le racisme et la logique biopolitique (on peut se souvenir de la définition de cette notion par Judith Butler : la sélection entre les pleurables et les non-pleurables), May Ayim est-elle une activiste ?
LL & JPR: Activiste et active. Les deux. Activiste, comme nous le rappelons dans « le visible passe inaperçu », notre postface à blues en noir et blanc. Elle co-fonde dans les années 1980 les premières associations pour les droits des personnes noires et étrangères en Allemagne. Elle s’engage dans la lutte anti-apartheid et les réseaux de solidarité entre femmes migrantes et allemandes. Elle intervient lors de congrès féministes et anti-racistes et organise le Black history month à Berlin en 1996. Au sein de l’université, elle met en lien les étudiants étrangers et/ou racialisés entre eux, encourage leur mobilisation et lutte pour une prise en compte des conséquences du sexisme et du racisme.
Active, car elle donne à sa langue poétique une énergie, une force ironique et un calme qui vous mobilisent quand vous la lisez. Sa poésie irrigue ses combats politiques : elle performe ses premiers poèmes dans des contextes militants ; les ouvrages collectifs qu’elle dirige font cohabiter littérature et essais ; lorsque le parti écologique l’invite pendant la campagne électorale de 1990, elle préfère intervenir comme poétesse, en lisant « contre la grisaille de la chair à saucisse – pour une république de la diversité ».
Comment définir le lyrisme de cette auteure au style proche du spoken word ? Qu’a-t-elle lu ? Quel est son legs littéraire ?
JPR : May Ayim a étudié l’orthophonie. Elle procède d’un lyrisme concret, vocal, comme si c’était une poésie du larynx. On le voit à sa façon de peser chaque mot, de le retourner, le faire entendre, sonner, dans sa manière de faire résonner les voix, les bribes, les phonèmes, les échos, les allitérations. C’est une musique très particulière. Sur la page, on entend les percussions de sa langue, mais on peut aussi imaginer un corps sur scène, une voix qui projette vers le public des vers composés, rythmiques, balancés. Au sens d’un équilibre sensoriel qui va de la scène au livre.
LL : On sait peu de choses quant aux lectures de May Ayim. Elle lit et dialogue avec des figures de la poésie africaine-américaine ou queer, comme Audre Lorde et Adrienne Rich. Elle cite comme source d’inspiration le poète dub et musicien de reggae Linton Kwesi Johnson. Ses poèmes contiennent aussi des allusions à Christa Wolf, Erich Fried et Rainer Werner Fassbinder.
Dans son texte placé en préface du recueil, la Guadeloupéenne Maryse Condé rapproche May Ayim de Léon-Gontran Damas. Qu’en pensez-vous ?
LL & JPR : Rapprochement pertinent au sens où May Ayim propose elle aussi une critique radicale du colonialisme. Mais sa poésie ne se rattache pas au mouvement de la Négritude dont le contexte correspond à une histoire qui n’est pas celle de l’Allemagne. Léon-Gontran Damas revendique ses origines noires contre les colons lorsqu’il évoque “(son) Afrique qu’ils ont cambriolés”. Ayim affirme de son côté une double appartenance : africaine et allemande, allemande et africaine. D’où la naissance du terme afro-allemand pour ne pas laisser l’Allemagne l’assigner à sa couleur de peau. Pas de cloisonnement entre la langue, le pays, la peau et les origines. C’est pour cette raison qu’elle parle du racisme, et non de la xénophobie, dont les personnes noires sont la cible. Ce n’est pas la haine des étrangers, c’est une stigmatisation raciale. Ayim attaque en ce sens les obsédés de l’origine ethnique. Ce sont les fantasmes increvables de l’extrême-droite, comme on les voit toujours à l’œuvre aujourd’hui.
Comment comprenez-vous la volonté de la poétesse d’écrire quasi systématiquement en minuscules et sans ponctuation ?
LL : May Ayim ne s’est pas exprimée là-dessus à ma connaissance. Il y a certainement une volonté de rompre avec deux marqueurs visuels forts de la langue allemande : les majuscules et les virgules grammaticales. Elle prend ses distances avec une langue qui est la sienne mais ne l’accueille pas. C’est un pas de côté par rapport à la langue « normale » ou en tout cas normée : une recherche formelle proprement littéraire. La quasi absence de majuscules met à égalité les mots. Cela fait d’autant plus ressortir les moments où les majuscules apparaissent, notamment pour marquer le féminin. Je perçois l’absence de ponctuation comme une manière de laisser les vers prendre le dessus. Le regroupement ordinaire des mots n’a pas lieu, ce sont les vers qui créent de nouvelles unités et un nouveau rythme.
JPR : La ponctuation est un art périlleux, facile en apparence, complexe en réalité. La graphie de May Ayim est comme un espace qu’elle avait trouvé, un endroit où elle se sentait bien. C’est peut-être un clin d’œil insolent à la belle versification allemande, aux codes poétiques soi-disant éternels, au caractère sacré de la langue qu’elle cherche à prendre de vitesse. Et les années 80-90 arrivent tout de même après un siècle d’avant-garde poétique dans le monde. La déconstruction du rythme et de la typographie, c’est une longue histoire. Pour n’accabler personne avec une foule d’exemples, je mentionnerai seulement Douze d’Alexandre Blok. Ouvrons ce petit ouvrage explosif et voyons avec quel sifflement Blok se sert du vers tonique libre pour décrire la Révolution. Ça se passe dans les rues de Petrograd en janvier 1918. Un siècle après, rien de neuf sous le soleil de l’invention rythmique ? Peut-être, mais les révolutions formelles proviennent de déplacements presque invisibles.
Quels sont les thèmes récurrents de la poétesse ? Comment décrire son lexique ?
LL & JPR : Si certains sujets semblent s’imposer d’eux-mêmes (le racisme, la réunification, l’abandon…), les textes dépassent largement les thématiques qu’ils évoquent au premier abord. Le politique est intime, et vice-versa.
Il y a une exploration du noir et du blanc à travers le recueil, de ses variantes et de ses connotations : les « blanchisseurs de l’histoire », « dénigrer », « blanchir »… Elle joue sur la polysémie du terme « weiß » qui est à la fois l’adjectif « blanc » et une forme conjuguée du verbe « savoir ». Le savoir, traditionnellement du côté des Blancs, May Ayim se le réapproprie et le déplace, comme dans le poème « hors du cadre » qui joue sur le regard ethnographique porté par les colonisateurs sur les personnes noires. Elle l’inverse sans le reproduire :
n’aie pas peur
visage pâle
c’est moi
On entend quelquefois dans ses textes des pointes d’accent berlinois. Comment le caractériser ?
LL & JPR : Dans ses poèmes, on entend les gens parler comme d’ordinaire, et c’est l’une des beautés du texte. On peut y voir l’influence du spoken word, mais c’est également un ancrage géographique. La poésie de May Ayim a lieu, au sens concret du terme. Cet accent berlinois peut prendre une coloration menaçante, dans la bouche des personnes qui la renvoient à un ailleurs. Mais c’est aussi la langue du « je » : elle affirme par là être chez elle à Berlin et dans cette langue.
N’a-t-elle pas cherché à dénoncer la fiction d’une Allemagne réunifiée, faisant fi de son passé nazi ?
LL & JPR : Avant la réunification, May Ayim est déjà confrontée à une nation qui se croit libérée de la violence nazie et raciste. C’est le sens de l’expression « venu à bout » (bewältigt) dans le poème « l’après », dédié à Martin Luther King. « Venir à bout du passé » (die Vergangenheit bewältigen), c’est le mot d’ordre mémoriel en Allemagne depuis les années 1970. Dans les textes de May Ayim, cette expression devient le symbole d’une société qui pense n’avoir plus rien à se reprocher et s’imagine débarrassée du poids du passé. Lorsqu’elle veut écrire son mémoire de fin d’études, puis sa thèse de doctorat sur les biais sexistes et racistes dans les thérapies langagières, les professeurs lui répondent que le sujet n’est pas pertinent au motif qu’il n’y aurait plus de racisme en Allemagne depuis longtemps. Mais elle sait que l’« aboutissement » du travail mémoriel est une illusion.
Au moment de la Chute du Mur en 1989 et de la réunification en 1990, la jubilation collective prend notamment la forme d’une célébration du « peuple allemand ». La fierté nationaliste débridée s’accompagne d’une augmentation du racisme au quotidien et d’un déferlement de violences envers les personnes perçues comme étrangères à cause de leur couleur de peau, qu’elles aient ou non la citoyenneté allemande. Dès le départ, May Ayim comprend les dangers de ce récit national émergent, qui ignore les crimes passés et présents. Dans son poème « l’allemagne en automne », elle rappelle que le 9 novembre n’est pas uniquement la date de la Chute du Mur, mais aussi celle du pogrom antisémite de la « Nuit de cristal » en 1938. En même temps, elle attire l’attention sur les nombreux assassinats racistes qui ont encore lieu à l’Est comme à l’Ouest. Ainsi, May Ayim est l’une des premières à « déranger la mémoire » de la réunification allemande, pour reprendre le titre de l’ouvrage critique Erinnern stören (Verbrecher Verlag, 2020).
May Ayim possède-t-elle une spiritualité ?
LL & JPR : C’est une question insoluble ! À première vue, le mot spiritualité ne convient pas à May Ayim, pas plus qu’on ne peut parler d’esprit ou de salut. Ces termes sont trop empreints de mysticisme pour lui correspondre. Et pourtant… Dans le poème “afrekete”, elle s’adresse à une divinité « farceuse, intersexe, artiste du langage et des métamorphoses ». Et que lui dit-elle ? Ceci :
je te vois
debout
dans le jardin
et le mouvement de ta rêverie
Puis plus loin :
j’aimerais savoir
à qui tu parles
à qui tu ne parles pas
et
ce qu’il y a
d’autre que toi et
avec toi
en toi
Très étonnant. À qui parle-t-elle vraiment ? Aux forces de l’invisible ici convoquées ? Au mystère de la présence ? De l’incarnation ? Qu’est-ce que voir le mouvement d’une rêverie en soi tout en cherchant l’autre ? Étrange. Sa poésie se trouve ici singulièrement déplacée. Est-ce à entendre comme un écho à La Licorne noire d’Audre Lorde ? Le présent et le passé immémorial dialoguent dans le passage des rituels.
Y a-t-il dans l’université allemande, comme en France, et a fortiori aux États-Unis, une véritable prise en compte des études post-coloniales ?
JPR : N’étant ni universitaire ni spécialiste des études post-coloniales, je peux difficilement me positionner, mais en lisant Norman Ajari et son essai Noirceur. Race, genre, classe et pessimisme dans la pensée africaine-américaine au XXIe siècle, on a l’impression que la France est encore à la remorque. Le pouvoir officiel est rétif à ces réflexions taxées de fléau “islamo-gauchiste” selon les termes d’une ancienne ministre de la République. Le pessimisme qu’analyse Norman Ajari, c’est la “capacité de la société blanche à dépasser sa négrophobie” et les voies pour “repenser radicalement l’avenir des vies noires dans le monde”. Autant dire que le travail à mener est colossal.
LL : Dans les universités allemandes, les études post-coloniales cohabitent avec d’autres approches. Une véritable décolonisation des théories et des méthodologies de recherche est un processus jamais abouti. May Ayim a été l’une des premières à porter ces questionnements au sein de l’université allemande, d’abord avec son mémoire sur l’histoire des personnes noires en Allemagne, puis en tant que chargée de cours. En 1992, elle organise avec Dagmar Schultz et Ika Hügel un séminaire sur le racisme, l’antisémitisme et l’ethnocentrisme dans la recherche et l’enseignement berlinois.
Vous êtes deux traducteurs. Travailliez-vous ensemble, côte à côte, ou à distance ? Comment avez-vous envisagé votre collaboration ?
LL : Il y a un plaisir à traduire à deux : entendre l’autre faire sonner les mots de l’original ou de la traduction, partager cette expérience intérieure et démultiplier les regards sur le texte. C’est beaucoup plus long que de traduire seule, mais s’il y avait assez de temps et d’argent, j’aimerais ne traduire qu’à deux, avoir toujours quelqu’un avec qui parler vraiment du texte. Cela implique des sensibilités qui se comprennent au-delà des désaccords, comme c’est le cas avec Jean-Philippe.
Il aurait peut-être été plus « efficace » de se répartir les textes, mais nous avons tout traduit ensemble, en partant en général d’une trame (un premier jet quasiment mot à mot) faite par l’un.e des deux.
JPR : Nous travaillons à Berlin et à Brest, à distance, mais aussi par e-mail, au téléphone, par visio. Nous trouvons des solutions pour tracer une ligne méthodique et nous y tenir. Chaque poème connaît plusieurs versions. C’est comme un palimpseste. On sait quand un poème “sonne” ou pas, quand on s’approche d’une meilleure alternative. On sait aussi qu’on pourrait retraduire sans fin. Mieux vaut faire preuve de modestie et de patience.
May Ayim est morte jeune, à trente-six ans. Comment expliquez-vous son suicide ? N’a-t-elle pas souffert de troubles mentaux ? Elle écrit dans « nouveau départ », comme un ultime espoir : « les étoiles / dans ma nuit / sont des larmes de joie argentées / prêtes à tout ! » Le cheminement de sa poésie ne procède-t-il pas d’un approfondissement de sa solitude, les derniers poèmes du recueil étant déchirants, prenant acte de la fin de l’amour ?
JPR: Ses larmes de joie sont concrètes pour moi. Des larmes de joie argentées, prêtes à tout ! Il faut se figurer ce que ça signifie, l’émotion d’un tel vers serre le cœur. Oui, des troubles étaient persistants chez elle. Dans chant nocturne, son recueil posthume, on voit à l’œuvre les démons et les combats quotidiens. Le difficile équilibre de l’amour, sa survie, sa précarité, sa dissolution. À la fin de son journal Le Métier de vivre, Cesare Pavese écrit ceci, avant d’abréger ses souffrances : “Il faut de l’humilité, non de l’orgueil. Tout cela me dégoûte. Pas de paroles. Un geste. Je n’écrirai plus.” Dans blues en noir et blanc, May Ayim sait accompagner la mort d’un espoir plus grand que la mort. C’est le magnifique texte « ANA ».
ANA tu es
partie de la vie
sans mépriser la mort
intensément
pour une vie
que nous continuerons à porter
LL: Quand on a connu des états limites de souffrance psychique, certains textes de May Ayim résonnent fortement. Mais je ne lis pas ses poèmes comme des clés pour élucider le mystère du suicide. Ils sont traversés par des moments lumineux comme ces larmes argentées, par des fulgurances combatives, par des instants d’abattement comme dans « annulation », et par des expériences violentes – l’abandon, la brutalité du racisme, les chagrins d’amour, la difficulté à faire confiance aux autres, mêmes aux amies les plus proches.
L’année de son suicide, 1996, est une année de crise. Épuisée par l’organisation du Black history month, elle s’effondre psychiquement. Entre janvier et août, elle fait plusieurs séjours dans des services psychiatriques et tente de se suicider. À l’hôpital, elle est confrontée au racisme qu’elle avait analysé dans ses recherches doctorales. À cette violence s’ajoute un diagnostic de la sclérose en plaques, dont elle ne subit pas encore de symptômes mais qu’on lui découvre au cours d’examens.
L’un des mots allemands pour désigner le suicide est Freitod, littéralement « mort libre ». Je ne sais pas s’il existe une liberté complète au cœur d’une telle souffrance, mais ce mot rappelle que la décision prise par May Ayim n’est pas réductible au déterminisme des causes possibles que nous pourrions identifier.
Y a-t-il une descendance à sa poésie ? Peut-on la rapprocher de la poétesse afro-américaine lesbienne Audre Lorde, dont l’un de ses textes pleure la mort ?
JPR : Entre Audre Lorde et May Ayim, c’est un lien de poésie radicale et de douce rébellion, pour reprendre le titre du recueil Radikale Dichterin, sanfte Rebellin (Unrast Verlag, 2021) consacré à May Ayim. La poésie et la rébellion me font penser à James Baldwin, à la violence dont il parle en 1970 dans le film Meeting The Man, face caméra, place de la Bastille à Paris : “Je ne crois pas aux Blancs, et je ne crois pas non plus aux Noirs. Mais croyez-moi, je ne connais que trop bien la différence. Un désespéré n’écrit pas. Lorsque vous vivez à l’ombre de la mort, cela vous donne une certaine liberté. Par conséquent, je suis complètement heureux et relativement libre.”
Dans notre monde, ces phrases donnent de l’élan.
LL: Audre Lorde et May Ayim étaient amies et compagnes de lutte. Audre Lorde passe l’année 1984 à Berlin et encourage May Ayim à écrire sa poésie et à publier son mémoire sur l’histoire des personnes noires en Allemagne. Cela donnera lieu à l’ouvrage collectif Farbe bekennen (« Affirmer sa couleur », Orlanda Frauenverlag, 1986). Le lien entre les deux poétesses est politique et intellectuel, bien que leurs œuvres soient très différentes.
Concernant sa postérité, May Ayim est aujourd’hui une figure centrale de la littérature afro-allemande et une source d’inspiration, comme en témoignent les deux volumes sisters and souls (Orlanda, 2016 et 2021). Ils rassemblent des textes écrits par des autrices inspirées par May Ayim, et le titre renvoie au poème « soul sister », dédié à Audre Lorde.
Vous préparez deux autres volumes de ses textes. Quelle en sera la teneur ?
LL & JPR : Le premier volume, Nouveau départ,rassemble un choix d’essais et d’articles qui permet de saisir différentes facettes de l’œuvre de May Ayim, notamment le passage du politique au poétique. Le deuxième volume, chant nocturne, correspond au recueil posthume paru en 1997, à partir des poèmes établis par l’autrice avant sa mort. Nous poursuivons ainsi le travail exigeant avec notre éditrice Isabella Checcaglini, chez Ypsilon éditeur. Ce sont des livres qui nous tiennent à cœur, que nous considérons comme une résistance et une fête.
sœur
pourquoi me transperces-tu
de tes regards
pourquoi veux-tu tout comprendre
saisir la souffrance
derrière mon rire
sentir
la fatigue
dans mes yeux
compter
les rides
sur mon front
observer
les cicatrices
sous ma peau
pourquoi veux-tu poser
tes mains froides sur mon cœur palpitant
nous sommes sœurs
toi et moi
nous sommes sœurs