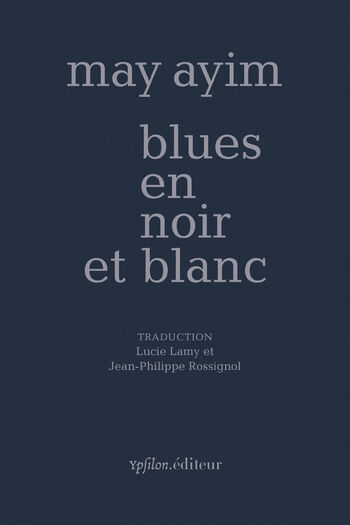8/02/2023
« Splendeur d’un combat », par Emmanuelle Rodrigues
Dans son premier livre traduit en français, May Ayim évoque ses espoirs et ses désillusions : une parole portée avec éclat contre le silence et l’oubli.
« Voix majeure de la littérature afro-allemande », tels sont les mots par lesquels les traducteurs présentent ici May Ayim, née à Hambourg en 1960, d’une mère allemande et d’un père ghanéen. Abandonnée à sa naissance par ses parents, elle grandit à Münster dans une famille d’accueil dont elle porte le nom, Opitz. Mais à partir de 1992, elle choisit comme nom de plume celui de son père biologique, Ayim. Engagée dans une lutte pour la reconnaissance des personnes afro-allemandes, elle fonde en 1986 un groupe, Initiative für Schwarze Menschen in Deutschland (Initiative pour les personnes noires en Allemagne). Paru en 1995 et préfacé par Maryse Condé, blues en noir et blanc révèle, selon elle, « l’écho d’autres sons de la diaspora » et une expression poétique comparable à celle de Léon-Gontran Damas, « l’un des pères de la "négritude" ». Admise dans un service psychiatrique à Berlin, une sclérose en plaques lui est diagnostiquée. En 1996, elle mettra fin à ses jours. Intitulé Nachtgesang, son second livre édité en 1997 sera donc posthume. blues en noir et blanc témoigne de son engagement et nous restitue l’élan de son combat. Écrire revient à faire connaître des luttes qui sinon resteraient ignorées et à leur donner une portée collective.
Dans Soul sister, où elle rend hommage à son amie Audre Lorde, écrivaine et militante américaine, elle rappelle : « en 1984 des femmes noires allemandes/ portèrent avec AUDRE LORDE le mot/ afro-allemand/ puisque nous avions de multiples étiquettes/ qui n’étaient pas les nôtres/ puisque nous ne connaissions pas de nom/ par lequel nous voulions nous nommer/ le racisme reste/ le visage pâle d’une maladie/ qui nous dévore en secret et en public ».
Criants de vérité, ses écrits invitent à faire corps avec les plus marginalisés socialement, avec ceux qui communément sont laissés pour compte ou encore persécutés pour ce qu’ils sont : les étrangers, les personnes malades. Par le biais de saynètes de la vie quotidienne, toute une fresque sociale se laisse percevoir. Ce n’est pas non plus sans audace que May Ayim pointe d’un regard lucide les formes courantes d’injustice. En rendre compte en les discernant au plus près, c’est persister à œuvrer contre le déni. Ainsi, déclare-t-elle : « sereine/ comme un miroir/ montrer ce qui est/ sans peur d’être anéantie/ par ce qui est dévoilé/ avant que ce ne soit dévoilé ». Quand il s’agit d’évoquer dans L’Allemagne en automne les crimes racistes d’hier et d’aujourd’hui, elle exprime sans détour ce qui est effectivement passé sous silence. Elle écrit alors : « ce n’est pas vrai/ que ce n’est pas vrai/ voilà ce qui s’est passé/ d’abord une première fois puis encore/ voilà/ nuit de cristal/ en novembre 1938/ tout d’abord/ des vitres se sont brisées/ puis/ toujours et encore/ des os humains/ de juifs et de noirs et/ de malades et de faibles de/ sintés et de roms et/ de polonais de lesbiennes et/ de gays de et de/et de et de/et et/ ». Et c’est aussi au cœur du langage qu’elle relève les traces de discriminations, de race, de sexe, de classe. Mais, faut-il le souligner, blues en noir et blanc donne à entendre, ainsi que le précisent les traducteurs, « l’oralité d’une poésie peuplée de voix et d’intonations, où l’on entend parler le berlinois, les médias, la petite-bourgeoisie, les conversations entre amies, les frères et sœurs de lutte. »
Ainsi, ces textes portent-ils leurs « messages pour l’avenir » avec autant de clairvoyance que d’élégance : « le long du fleuve/ un ciel bleu et noir au-dessus de moi/ orné d’étoiles argentées/ des arbres/ à gauche et à droite/ les branches chargées de nostalgie/ et le coeur qui espère/ je t’aime/ je n’attends plus ».