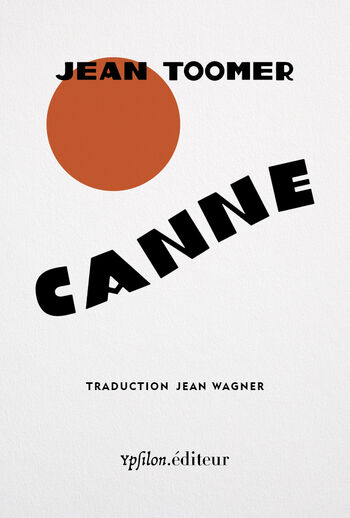1/05/2017
« Citizen Cane », par Anthony Dufraisse
Fond et forme, c’est sans doute l’une des scènes les plus signifiantes de ce livre. Au moment de quitter un club de Chicago avec sa cavalière, Bona, une Blanche au « teint vermeil », Paul, jeune homme « foncé », revient sur ses pas pour s’adresser au portier. Au passage du couple, l’homme a eu un regard lourd de sous-entendus : « Vous vous trompez, mon vieux. Je suis revenu vous le dire, vous serrez la main, et vous dire que vous vous trompez. Qu’il va se produire quelque chose de beau. (…) Je suis revenu vous dire, mon vieux, que les visages de blancs sont des pétales de rose. Que les visages noirs sont des pétales de nuit. Que je vais sortir ramasser des pétales ». Et la promesse qu’il se fait à lui-même de devenir aussitôt blessure : « Quand il arriva à l’endroit où ils s’étaient arrêtés, Bona était partie ». Bouleversant moment car on devine l’intensité de la déception de Paul, le sentiment qu’il doit avoir alors de profonde trahison. Voilà : la tragique beauté de ce livre réside dans un impossible accord au monde, aux autres et à soi.
Influençant toute une génération d’écrivains noirs dès sa publication en 1923, une première fois traduit en 1971 à destination de la seule Afrique francophone, Canne – Cane en v.o. – parle de la puissance dévastatrice des illusions à une époque où règne la ségrégation raciale. Se revendiquant sang-mêlé, Jean Toomer (1894-1967) nous parle des êtres cadenassés par des « concepts mentaux ». À sa manière, chacun des très nombreux personnages de ce livre, souvent des femmes, va rencontrer l’incompréhension, la violence, la folie, ou pire, la mort. Amours impossibles, déchirements identitaires, pulsions contraires, ici les vies sont marquées au sceau de la couleur de peau. L’origine comme horizon indépassable, la carnation comme aliénation, tout le texte en témoigne obsessionnellement : Fern, la « fille au teint de lait », le « visage blafard » d’Esther, Louisa dont la « peau avait la couleur des feuilles de chêne sur les jeunes arbres à l’automne », « le visage jaune citron » de Dorris, « le brun carminé » des joues de Muriel, « le teint rose magnifique » de Art, Bona et Helen, « le teint cuivré » de Lewis…
Le livre est construit en trois parties hétéroclites, reliées par des fils invisibles. Des histoires relativement développées ou à peine esquissées, des dialogues, des soliloques, des méditations oniriques, le tout entrecoupé de poèmes pareils à des prières. Les personnages prennent la parole sous l’œil d’un narrateur polymorphe, tantôt partie prenante du récit en cours, tantôt en retrait ou en surplomb. Donné comme un puzzle aux pièces éparses dont on attend, en vain, de découvrir le dessin d’ensemble, cette construction polyphonique associe systématiquement tel ou telle à un cadre normatif. Dans les première et dernière parties c’est une ville du Sud, en Géorgie, terre de canne à sucre, à la fois matrice et prison, pays aux horizons clos, et, entre les deux, le Nord, Chicago, Washington, dont l’apparente effervescence est trompeuse. Ici comme là, entre les Noirs et les Blancs, domine l’hostilité, ce poison lent. Tous autant qu’ils sont, les personnages de Toomer se voient donc refuser la lumière. Tirant eux-mêmes les ficelles, ils se savent des marionnettes, entraînées vers le fond par le poids de l’atavisme, des interdits et des préjugés. Ombres promises à la violence ou à la détresse, et dont les existences ne sont rien d’autre que des projections de leur imagination, hantises ou aspirations. Tout état de grâce semble hors d’atteinte.
On est tour à tour fasciné ou dérouté par l’écriture de Toomer, qui pratique un art poétique de la prose, dérivant ici vers le mysticisme, sublimant là le réalisme. Vaguement hallucinatoire, son lyrisme d’images étranges, baroques, s’accompagne souvent de mélodies ; chants qui flottent au-dessus des cannaies ou airs de jazz échappés des clubs enfumés. Et Toomer d’attendre désespérément, comme un de ses personnages, la venue d’« un dieu dont le visage d’ébène renverra de la lumière blanche ».