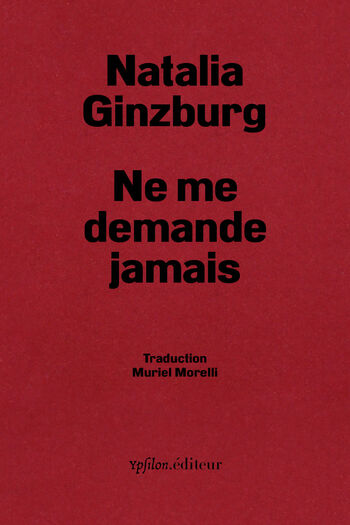11/04/2024
« “Ne me demande jamais” : Natalia Ginzburg parle pour chacun de nous », par Geneviève Brisac
La réédition d’un merveilleux recueil de textes de l’écrivaine italienne, morte en 1991, permet de mesurer la profondeur aiguë et l’urgence de son œuvre.
Son ami Cesare Pavese ne cessait de la réprimander : tu ferais mieux d’écrire au lieu de t’occuper de tes enfants. Avec entêtement, avec détermination, Natalia Ginzburg (1916-1991) fronçait les sourcils, elle crispait sa tête de lionne, et elle faisait tout à fait le contraire. Les enfants d’abord, ses enfants lui ayant sans doute sauvé la vie. Mais elle écrivait quand même, pendant la sieste, ou bien la nuit. Ecrire est un métier assez difficile, disait-elle, rempli de pièges, un métier qui se nourrit même des choses horribles, qui dévore le meilleur et le pire, qui se nourrit de tout et croît en nous.
Elle a été vraiment célèbre et énormément lue. Elle a obtenu les plus beaux prix littéraires d’Italie. Et puis on l’a oubliée. On redécouvre depuis quelques années son style impitoyable, sa manière de mettre l’éthique à l’ordre du jour absolument partout : à propos de sauce tomate, d’engagement ou de livres pour les enfants. En France, nous restions un peu à la traîne. Certains se souvenaient des Mots de la tribu (Grasset, 1966), cette autobiographie subtile et comique qui file à toute vitesse, inventant une langue, et ne parlant que des autres : sa famille juive dans les années 1920, son Turin dans les années 1930, la Résistance au quotidien, les années mussoliniennes. Nous savions qu’elle avait été mariée avec Leone Ginzburg, un intellectuel antifasciste qui créa, avec Giulio Einaudi, la maison d’édition légendaire du même nom. Nous savions le destin tragique de Leone, torturé et assassiné par les nazis, le 5 février 1944.
Nous ignorions la profondeur aiguë de l’œuvre de Natalia Ginzburg, placée sous le signe de ce deuil originel. Elle dit ainsi : « Devant l’horreur de sa mort solitaire, devant les angoisses et les espoirs qui précédèrent sa mort, je me demande si c’est bien à nous que cela est arrivé, à nous qui achetions des oranges chez Giro et allions nous balader dans la neige. » Cette question : « Est-ce bien à nous que cela est arrivé ? » court dans toute son œuvre, lui donne son urgence : une interrogation sans fin.
« Raconter le vrai »
Paru en Italie en 1970, en France en 1985 (Denoël), Ne me demande jamais, le nouveau recueil que réédite la maison Ypsilon, après Les Petites Vertus (Flammarion, 1964 ; rééd. 2021), en est l’illustration : « Raconter le vrai c’est comme circuler au milieu d’une horde de tigres. » Pourtant, on y trouve des récits qui font éclater de rire. Dans « La Maison », Natalia Ginzburg se met en scène avec son second mari, Gabriele, le meilleur spécialiste de Shakespeare de toute l’Italie, et qui est son contraire en tout. « Lui, il a toujours chaud, moi j’ai toujours froid. »
Ils partent à la recherche d’une maison à acheter. Les petites annonces, les visites, les appartements sombres, les maisons trop chères, trop moches, les jardins absurdes, les agents immobiliers, les disputes. Là encore, Natalia Ginzburg parle pour chacun de nous. Suivent des textes sur la vieillesse, qui commence par la fin de l’étonnement et le début de l’ennui. « Le passage de l’animal à la pierre est laborieux et épuisant. » Ses observations sur les enfants devenus adultes sont aussi cruelles que vraies. Le changement de leur regard.
Mais le récit le plus comique est certainement celui qui s’intitule « Les Voyageurs maladroits ». Sujet : le voyage. Un sujet ô combien contemporain. Il y a ceux qui savent voyager, dit Natalia Ginzburg. Pour eux, voyager est aussi simple que se moucher. Et puis il y a les autres. Les voyageurs maladroits n’ont pour les lieux qu’ils visitent aucune réelle curiosité. Ils voudraient juste que ces lieux deviennent aussi familiers que le quartier qu’ils ont à regret quitté. La peur ne les lâche pas. Peur de se tromper de train, de rater l’avion, de perdre leurs bagages, qu’ils savent pourtant avoir remplis n’importe comment de choses inutiles. Arrivés à l’hôtel, ils n’ont qu’une envie : ne jamais sortir de leur chambre. Et s’ils en sortent, c’est uniquement parce que le portier pourrait s’inquiéter. Le plus étrange, note Natalia Ginzburg, c’est que, n’ayant jamais désiré partir, ils ne souhaitent pas non plus rentrer. Ils savent qu’il faut rapporter des cadeaux et achètent trop cher deux coquetiers poussiéreux qu’ils jetteront peut-être avant d’arriver.
Dans toutes les histoires qu’elle raconte, il y a cette façon souple et comme invisible de passer du « je » d’aujourd’hui au « je » d’hier, du « elle » au « je », du « je » au « nous ». Comme si c’était simple, cette danse. C’est le métier, dirait-elle. Celui qu’elle a perfectionné à l’extrême, dans l’ellipse, la pudeur, l’intensité, la précision et la drôlerie, depuis le temps ancien où elle écrivait des poèmes lyriques et frelatés à ses frères.