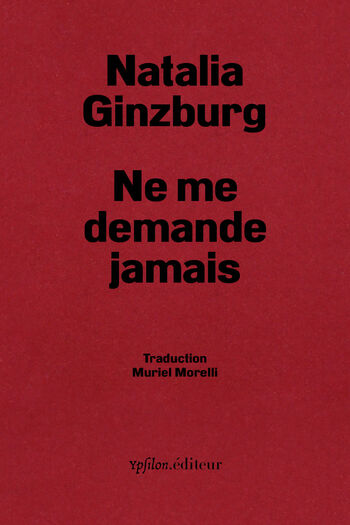4/05/2024
« Écrire comme habiter la terre », par Flora Moricet
Les courts récits-chroniques de Natalia Ginzburg au sommet de son art de portraitiste.
Celle qui écrit ne pas comprendre la musique, ne sachant pas l’écouter, a tout de même installé ce que seuls savent faire entendre les musiciens : le silence. Ne me demande jamais fait taire tous les bruits extérieurs et intérieurs et c’est une sensation très étrange à al lecture, car elle n’est pas si fréquente en littérature. Publiés pour la première fois en Italie en 1989, les textes de Natalia Ginzburg écrits entre 1965 et 1970, issus de journaux ou petites nouvelles inédites, sont pour la première fois — prodigieusement — traduits en France. Prolongement du très remarqué Les petites vertus (Ypsilon, 2021), ce nouveau recueil plus mûr, teinté d’une certaine mélancolie, mais non dénué d’ironie, livre des réflexions sur la vie quotidienne, l’écriture, l’art, la vie sociale, sa psychanalyse, les âges de la vie et ses contemporains qui ne posséderaient en eux « aucun lieu où être fier et joyeux».
Sans doute pour son versant « moraliste », ainsi que l’avait qualifié Italo Calvino, ce presque-journal, écrit au mitan de sa vie, est une vigie d’observation rigoureuse et caustique. Lorsqu’un journal la sollicite pour écrire sur « la crise du roman », terme qu’elle rejette rapidement en raison de sa mauvaise sonorité, elle vient de relire Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Márquez qui lui rappelle ce qu’est un « roman vivant », mais aussi combien on ne sait pas toujours lire : « nous sommes devenus de mauvais lecteurs de romans. […] nous avons parfois l’impression en les lisant de manger des pierres, de la sciure, de la poussière, ou bien nous les lisons tristement et distraitement ». La romancière n’est pas non plus tendre, mais comme elle devient drôle, envers « les voyageurs maladroits » : « ces animaux sédentaires sont dénués de tout sens de l’orientation. […] Et ce qui est étrange, c’est que n’ayant pas désiré partir, ils ne désirent pas non plus rentrer à la maison, car le soupçon les effleure qu’en leur absence quelque chose d’étranger et d’hostile a surgi dans leurs lieux habituels. »
Lucide et moderne, Natalia Ginzburg fait sans cesse la part des choses et navigue entre les sujets et les objets. Elle décrit l’enfance, l’adolescence et la vieillesse, saisissant chaque relief de ces métamorphoses, sans jamais les pétrifier. « Voulant paraître à la fois homme et femme, cet être veut aussi paraître à la fois très riche et très pauvre, mêler en lui et partager de multiples destins ; pour lui, les saisons n’existent pas, hiver et été se mêlent dans ses vêtements », écrit-elle à propos de l’adolescent.
On pourrait tout à fait lui attribuer les mots qu’elle prononce à propos de l’écrivaine anglaise Ivy Compton-Burnett qu’elle adorait : « c’est le rythme régulier, précis et implacable de qui sait où il va. Sa patience est un martèlement infernal. » Tout ce qu’écrit Ginzburg, avec sobriété et constance, ajoute de l’ampleur et de la perspective. Son écriture suit les mouvements du Tibre, fleuve continu chargé d’une eau chaque fois nouvelle.