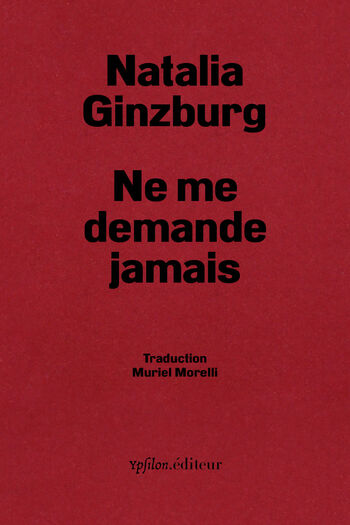1/08/2025
« Italie, géographies humaines », par Jean-Philippe Rossignol
Racalmuto : ce village de Sicile situé dans les collines non loin d’Agrigente est l’épicentre de l’œuvre de Leonardo Sciascia (1921-1989), qui y est né. Dans ses romans et nouvelles, à la façon d’un détective ironique, il convoque les paysans, les ouvriers des soufrières, les prêtres et les notables, à Regalpetra, le nom fictionnel de Racalmuto, devenu le théâtre d’histoires de soldats, de travailleurs et d’enfants : ceux qui peuplent Le Feu dans la mer1 , vingt-cinq textes écrits de 1947 à 1975, composant un livre critique et visionnaire. Il y décrypte la guerre, le fascisme et ses traîtres, le centre gauche au pouvoir dans les années 1960, les traditions et la décadence, l’avènement de la télévision et même, dans la veine fantastique qu’il a souvent pratiquée, l’arrivée des Martiens à Palerme… La prose de Sciascia saisit les ambiguïtés de l’idéalisme et les torsions des trahisons politiques, mais surtout la singularité de la Sicile, ce territoire saturé de conflits au fil des siècles, et qui a toujours su renaître.
D’un paysage l’autre, de sa naissance à Palerme aux années vécues à Turin, Natalia Ginzburg (1916-1991), l’auteure de Valentino et des Mots de la tribu, revisite sa propre vie dans Ne me demande jamais2 . Dans cette réédition des chroniques publiées pour l’essentiel par La Stampa à la fin des années 1960, fragments sobres et inquiets, elle parle du vieillissement, de la paresse, des corps au cinéma (le visage de Buster Keaton « recouvert d’un dense maillage de rides, comme une carte géographique ») ou d’Emily Dickinson… Elle n’est pas dans la frénésie de l’époque (« s’obliger à aimer et à rechercher tout ce qui autour de soi est nouveauté »). Le pire a été enduré, l’assassinat de son mari Leone Ginzburg, éditeur antifasciste et résistant, qui a connu la torture par la Gestapo, dont il meurt, à 34 ans, en février 1944. Natalia Ginzburg ne va alors plus cesser d’écrire, à la recherche d’interlocuteurs, comme elle le dit dans un beau texte qui évoque sa relation avec trois ou quatre lecteurs avant la publication, lecteurs dont l’attention est un « don précieux », car « ce n’est pas vrai qu’on peut la trouver à chaque coin de rue ».
C’est dans le nord de l’Italie que Gian Marco Griffi, né en 1976, situe son premier roman, Chemins de fer du Mexique3 . Un roman picaresque centré sur le personnage de Cesco Magetti, un soldat de la garde nationale républicaine qui se voit confier en 1944 la mission de dresser, depuis Asti dans le Piémont, la carte ferroviaire détaillée du Mexique. Magetti doit réunir un tas d’éléments pour dessiner sa carte, lui qui n’est pas géographe, et bien sûr le seul ouvrage qui le sauverait est introuvable, malgré l’aide de Tilde, une bibliothécaire dont il s’éprend. Projet donquichottesque, ce Mexique de papier est une épopée fantasmagorique, un hommage stylistique à la lingua zerga des bandits vénitiens du XVIe siècle et un clin d’œil aux histoires enchâssées des classiques italiens et espagnols. Un livre comme une réponse ample et indirecte à Natalia Ginzburg quand elle note : « Est-ce que le roman meurt parce que nous avons cessé de l’aimer, ou est-ce que nous avons cessé de l’aimer croyant qu’il va bientôt mourir, je ne sais pas. »
- Leonardo Sciascia, Le Feu dans la mer (récits de Sicile), traduit de l’italien et présenté par Frédéric Lefebvre, Éditions Nous, Caen, 2024, 224 pages, 24 euros. ↩
- Natalia Ginzburg, Ne me demande jamais, traduit de l’italien par Muriel Morelli, Ypsilon éditeur, Paris, 2024, 256 pages, 25 euros. ↩
- Gian Marco Griffi, Chemins de fer du Mexique (un roman d’aventures), traduit de l’italien par Christophe Mileschi, Gallimard, Paris, 2024, 670 pages, 25 euros. ↩