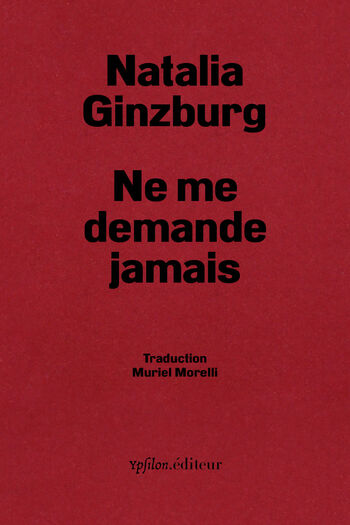25/05/2024
« Cadence Ginzburg », par Frédérique Roussel
Un recueil savoureux d’essais autobiographiques et critiques de l’écrivaine italienne Natalia Ginzburg.
Rien de plus ordinaire que de chercher à acheter sa propre maison. Pas pour Natalia Ginzburg. Elle veut en trouver une qui soit comme l’appartement qu’elle loue avec son mari, où elle a creusé sa tanière. « Une tanière où, quand j’étais triste, je me terrais comme un chien malade, buvant mes larmes, léchant mes plaies. Je m’y sentais comme dans une vieille chaussette. » Trouver une autre vieille chaussette à Rome devient toute une histoire. D’abord son mari la laisse s’en occuper seule, puis il s’en mêle, et ils s’aperçoivent rapidement que leur désir est contraire : elle rêve d’un rez-de-chaussée avec de la végétation, lui d’habiter en hauteur avec la vue sur les toits de Rome.
« La Maison », le premier texte de Ne me demande jamais, se déroule sur dix-sept pages, sans qu’on ne soit jamais saoulé par les revirements successifs de l’acheteuse. Le suspens tient même en haleine. Comme dans Les petites vertus (Ypsilon, 2018), qui rassemble des articles parus dans différents journaux et revues, on devine une forte personnalité dans ce recueil publié en 1989 et traduit pour la première fois. Les réflexions autobiographiques et critiques sur la société italienne de la seconde moitié des années 60 ne semblent pas caduques. Le lecteur saisit dans presque chacune des trente-deux chroniques du livre — sur la vieillesse, la psychanalyse, Emily Dickinson, les voyageurs, la solitude de l’enfance, l’écriture, etc. — des images inattendues et des pensées qui sont comme des ricochets, à prendre pour elles-mêmes sans le détonateur qui les a projetées dans le flux du texte.
« J’ai parfois la sensation que j’aime peut-être la musique ne m’aime pas. Peut-être qu’elle trouvait à quelques pas de moi, et je n’ai pas su, ou elle n’a pas voulu, traverser ce petit bout d’espace. »
Répondeur
Rien de plus fondamental que d’élire un lieu où vivre et écrire. « Je songeai alors que j’aimais de Rome tous les endroits où, à un moment donné de ma vie, j’avais pris racine, souffert, songé au suicide, toutes les rues où j’avais marché sans savoir aller. » L’introspection voisine avec l’humour. Dans des messages tonitruants sur son répondeur, le commandeur Piave ne renonce pas à lui faire visiter son magnifique appartement de la piazza Balduina. « Il y a l’interphone ! Votre mari arrive, il vous avertit de la loge qu’il est rentré, vous lancez les spaghetti, il met la voiture au garage, il monte par l’ascenseur, et le repas est servi ! Dans la salle de bains, il y a une colonne d’albâtre noire, avec des mosaïques qui représentent des poissons, tous les rebords de fenêtre sont en onyx ! » Tout un programme qui ne pouvait qu’écœurer une adepte de tanières à son empreinte.
« Manière fruste »
On trouve aussi dans ces essais une autodérision attachante. Elle a un abonnement à l’année à l’opéra, mais elle s’y sent un témoin inutile, ensommeillé et perdu dans ses propres pensées. « J’ai parfois la sensation que j’aime peut-être la musique et que la musique ne m’aime pas. Peut-être qu’elle se trouvait à quelques pas de moi, et je n’ai pas su, ou elle n’a pas voulu, traverser ce petit bout d’espace. » Ne rien connaître à la peinture, ne l’empêche pas d’écrire une déclaration d’amour à Edvard Munch et au Cri : « Je pense que je ne regarde pas ses toiles de la même manière que ceux qui aiment et connaissent la peinture, je les regarde de manière fruste, et en romancière. » En 1944, elle est veuve avec deux enfants, son mari Leone Ginzburg, journaliste, éditeur, professeur d’italien et militant antifasciste a été assassiné par la Gestapo. Paresseuse, elle doit travailler alors que jusque-là, dit-elle, elle n’avait rien fait de sa vie à part écrire des romans, à « perdre un temps fou à musarder et à rêvasser ». Elle décide de s’adresser à la maison d’édition, Einaudi, où son mari avait longtemps travaillé. Elle a pour projet de faire traduire Jeunesse sans Dieu d’Odön von Horváth « dont je ne savais rien, sinon qu’il était mort jeune, suite à la chute d’un arbre ». Sa seule idée fera long feu. De son propre vécu, Natalia Ginzburg (1916-1991) tire des histoires apparemment désinvoltes, qui disent ce qu’elle prend et pense de la vie. À propos d’un film qu’elle n’a pas aimé : « J’avais aussi la sensation de me heurter sans cesse à son intelligence. Or l’intelligence est inutile quand elle ne s’oublie pas, quand elle se préfère aux images qu’elle représente. Dès lors elle ne peut que se flétrir et attrister tout ce qu’elle effleure. »