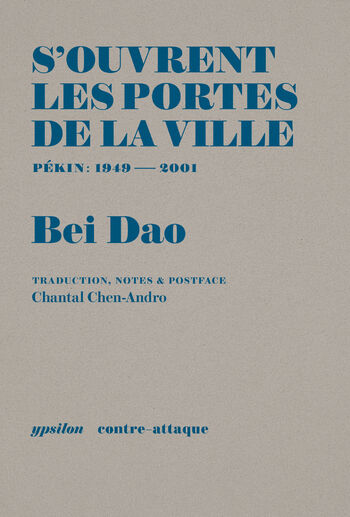1/07/2020
« Enfant de Pékin, Bei Dao “rebâtit” sa ville », par Claire Devarrieux
Un enfant joue à cache-cache dans les rochers, aime passionnément les billes, aide son père dans le potager, fait un long voyage avec sa mère pour aller voir son grand-père. Mais nous ne sommes pas chez Marcel Pagnol. Nous sommes dans un récit de Bei Dao, et l’histoire passe sur le corps de l’écrivain. Bei Dao, poète et romancier dont on a découvert en France Vagues en 1993 (aux éditions Picquier) est né en 1949, comme la république populaire de Chine. Son père se souvenait qu’une nuit où il se trouvait en prison, cette année-là, il espérait «la naissance d’un enfant et celle d’une Chine nouvelle».
S’ouvrent les portes de la ville se présente comme un guide et une restitution. «Je voulais, par l’écriture, reconstruire une ville, rebâtir mon Pékin à moi - et ainsi, nier ce qu’il était devenu aujourd’hui.» Bei Dao n’était pas revenu dans sa ville natale depuis 1989, lorsqu’il put se rendre au chevet de son père malade, fin 2001. La ville était méconnaissable. «Pékin ressemblait à un immense stade illuminé», c’est la première chose qui le frappe lorsque l’avion amorce sa descente. L’enfance de Bei Dao n’était pas aussi violemment éclairée la nuit, il y avait dans les logements des ampoules de trois watts, pas de réverbères dans les rues. On fixait une lampe au guidon de son vélo, ou on l’équipait d’une dynamo qui clignotait «par intermittence».
«Ombres et lumières», «Les odeurs», «Les bruits», «Jouets et jeux», thème par thème, Bei Dao raconte les années 50 et 60, le foyer où subsiste une trace de l’aisance d’antan, les voisins, les ruelles, quand «Pékin était si calme qu’il ressemblait à un grand village». Il est l’aîné, viennent après lui un frère et une petite sœur. Au chapitre «Meubles», l’affreux revêtement plastifié dont le père bricoleur recouvre tables, commode, buffet est un petit sketch ironique et tendre. On commence par sourire aussi avec les ressorts du matelas Simmons qui se font la malle l’un après l’autre. Pas moyen de faire venir un artisan, «nous n’avions même pas de quoi assurer la nourriture au quotidien».
C’est alors que la famille entend parler d’une entreprise qui rachète les ressorts, cinq yuans chaque. «Père était ravi au-delà de toute espérance, profitant d’un week-end, il démonta tous ceux du matelas, les remplaça par une planche en bois. Il y en avait en tout vingt-huit, et chacun pouvait être changé contre un chou au marché noir.» Il s’avère que c’était cinq yuans pour l’ensemble. Après avoir rouillé sur le balcon, les ressorts sont partis chez un ferrailleur qui en donna de quoi acheter «quelques bonbons aux fruits pour nous, les trois enfants».
Hallucinations
Bei Dao a entre 10 et 13 ans lorsque s’abat la Grande Famine, qu’il appelle «les années difficiles». Avant 1978, indique une note de la traductrice, Chantal Chen-Andro, les autorités parlaient des «trois années de catastrophes naturelles». La mère de Bei Dao, qui est médecin, ne s’inquiète pas outre mesure des hallucinations dont son fils est victime. Mais selon ses propos, rapportés au sein du récit ainsi que quelques notes de son mari, voir ses enfants en si mauvais état, si dénutris, est insupportable. On leur demande de ne pas se dépenser trop, de rester couchés le plus possible. Bei Dao y revient à plusieurs reprises. Comment ses lapins ont fini à la casserole : histoire classique. Comment il était hanté par la faim : expérience moins partagée. Il mangeait n’importe quoi, les billes de microalgues de l’aquarium, le glutamate, les poires sauvages.
«Pendant les années difficiles, l’école n’ouvrait qu’à mi-temps.» Que faire l’après-midi, après les devoirs ? Bei Dao et ses copains se rendent à la petite librairie de bandes dessinées où ils peuvent, moyennant un centime, lire sur place. Non loin de là, une boutique de beignets : «Lire à côté du petit snack, c’était faire preuve d’un certain héroïsme, c’était refuser toute intimidation ou tentation, être déterminé à ne jamais devenir un traître.» Au chapitre «Lire» sont évoquées aussi les strates de la bibliothèque familiale. En haut, les œuvres importantes, de Marx à Mao, «c’était l’orthodoxie». En dessous, les dictionnaires. En bas, les revues, notamment les revues de cinéma. C’est l’étagère préférée du futur écrivain. «Lire des scénarios revenait à voir des films sans débourser un sou, et c’était même plus fort - le texte se faisait image, l’espace ouvert à l’imagination était plus vaste encore. Que j’aie, par la suite, écrit de la poésie est plus ou moins lié à cela.» Puis le jeune lecteur découvre la cachette des livres interdits, à quoi on accède par une trappe. Certains ouvrages de médecine, d’anatomie féminine, par exemple, et des romans d’avant la Libération, comblent la libido de Bei Dao entre 10 et 17 ans. Ces livres-là sont brûlés pendant la Révolution culturelle, en 1966. Mais les ouvrages dont on exige la restitution ne sont pas perdus pour tout le monde : «Les livres se mirent à circuler parmi la population et ils devaient constituer les bases nécessaires à la naissance de la littérature non officielle», écrira plus tard Bei Dao dans un article sur «La traduction, une révolution silencieuse».
17 ans en 1966. Du jour au lendemain, c’est l’arrêt complet des cours. «Au début, la Révolution culturelle fut pour moi comme un carnaval», écrit Bei Dao, conscient à l’époque que ses motivations «n’étaient pas sans mélange» et que «la défaite de la ligne bourgeoise en matière d’éducation» avait bon dos : «Je me trouvais précisément dans une situation critique en ce qui concernait les matières scientifiques». Non seulement il avait intégré le prestigieux lycée n° 4, mais il échappait à l’examen de fin de semestre : année faste pour un garçon qui n’avait pas la tête aux mathématiques et avait découvert le plaisir d’écrire à l’école primaire.
Dénonciations
La question de l’appartenance de classe, mauvaise si elle n’est pas prolétaire, obsède la Chine de Mao et le livre de Bei Dao tout entier. Elle corrompt les enfants, sommés de dénoncer leur père, ou de le renier. Elle menace la relation amoureuse dans Vagues, elle entraîne les suicides et les horreurs évoqués dans le recueil de nouvelles 13, rue du Bonheur (Circé, 1999). Dans une de ces histoires, un universitaire devenu pitoyable balayeur a deux sillons rasés dans la chevelure blanche dont il était tellement fier.
On ne peut s’empêcher d’y penser lorsque Bei Dao raconte comment, à la tête d’un groupe de gamins, il entreprend de tondre un contre-révolutionnaire. Il est exclu du contingent de Gardes rouges constitué au lycée – son père n’a pas toujours été un employé –, mais il participe à l’ivresse du «carnaval» jusqu’à ce que celui-ci se transforme en «tragédie sanglante». «Bien des années plus tard, je lus Sa Majesté des mouches de l’écrivain anglais William Golding : ce fruit osé de son imagination avait été pour nous la réalité impitoyable.»
Ouvrier en bâtiment
En 1969, la famille se trouve dispersée pour quelques années. Les parents de Bei Dao sont envoyés en camp de travail, à «l’Ecole des cadres». Lui-même devient ouvrier dans le bâtiment. Mais il revient tous les quinze jours chez lui, et tient «salon» avec quelques amis, ils lisent, écrivent, boivent en écoutant de la musique. Ainsi, au cours des années 70, Bei Dao devient-il poète, un des plus influents de sa génération (deux recueils sont traduits chez Circé, Au bord du ciel et Paysage au-dessus de Zéro). En 1978, il fonde la revue Aujourd’hui. Début 1989, soutenu par une trentaine d’intellectuels, il écrit au gouvernement chinois pour demander la libération des prisonniers politiques. En juin, il n’est pas place Tiananmen, mais à Berlin. C’est alors que les portes de la ville se sont refermées pour lui.