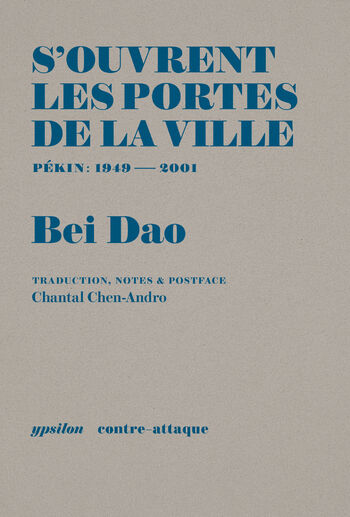18/06/2020
« Douceurs et douleurs : Bei Dao se souvient de son enfance à Pékin », par Lise Wajeman
Les opposants au régime chinois entonnent depuis près de cinquante ans un de ses poèmes en signe de révolte. Avec S’ouvrent les portes de la ville, l’écrivain Bei Dao revient sur son enfance dans le Pékin de la Révolution culturelle.
« Je te le dis, monde,
je – ne – crois – pas !
et si sous tes pieds ils sont mille à te défier
compte-moi comme le mille et unième. »
Réponse (« Huida ») est devenu au fil des décennies un hymne de résistance en Chine. Le poème a d’abord retenti pendant le mouvement du 5 avril 1976, contre la bande des quatre, il est surtout devenu le chant de la revendication démocratique, scandé par les manifestants de la place Tian’anmen, en 1989. En 2020, il est réapparu sur les réseaux sociaux en mémoire de Li Wenliang, le médecin qui avait tenté d’alerter sur les dangers du Covid-19 avant de succomber lui-même au virus.
Aujourd’hui l’auteur de Réponse, le poète Bei Dao, icône de la poésie chinoise contemporaine, régulièrement proposé pour le prix Nobel de littérature, vit en exil à Hong Kong. En 1989, alors que le soulèvement étudiant prenait de l’ampleur, Bei Dao était en voyage à Berlin ; les autorités ne l’ont pas laissé revenir. Il n’a pu retourner pour la première fois en Chine qu’en 2001, « au terme d’une longue absence de treize ans ».
C’est sur le rappel de cet exil forcé que commence S’ouvrent les portes de la ville, dont le sous-titre, Pékin 1949-2001, mène de l’année de naissance du poète à celle de son retour dans la capitale. Il y évoque sa ville (que les Français n’appelaient pas encore Beijing) et sa vie. Le livre paraît ces jours-ci chez l’éditeur Ypsilon, dans une traduction de Chantal Chen-Andro, fidèle du poète, qui avait déjà traduit, entre autres, Paysage au-dessus de zéro (Circé, 2004).
Bei Dao est le nom de plume de Zhao Zhenkai. L’adoption d’un pseudonyme visait à éviter au jeune poète les ennuis avec la censure, mais son choix est éloquent ; il signifie « l’île du Nord », évoquant la provenance de l’écrivain, sa solitude, mais aussi son écriture. Dans les années 1970, Bei Dao est le promoteur d’un courant qu’on a appelé « poésie obscure »: une poésie hermétique, c’est-à-dire une poésie dont le sens ne se donne qu’à celui qui veut en faire l’expérience, autrement dit une poésie critique, qui lutte pour se dégager de la langue officielle du régime.
En 1978, Bei Dao fonde avec le poète Mang Ke la revue Aujourd’hui (Jintian). Dans le premier numéro figure une traduction du manifeste que Heinrich Böll avait publié en 1952, sur la « littérature des ruines »: au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’écrivain allemand revendiquait l’importance de décrire le réel, contre les fictions de reconstruction qui visaient à ensevelir des pans entiers de l’histoire dans l’oubli.
Pour les jeunes écrivains d’Aujourd’hui, qui ont connu le mouvement des gardes rouges – Bei Dao s’est enrôlé avec enthousiasme en 1966 –, mais aussi la rééducation idéologique – le poète déçu sera contraint, de 1969 à 1980, de travailler comme ouvrier du bâtiment –, il s’agit, comme pour Böll, de prendre acte de ce que l’on voit, de se débarrasser de l’idéologie : de s’extraire de la Chine de la Révolution culturelle, de parler à cœur ouvert de ce qu’il a fallu taire et cacher si longtemps.
Déjouer « l’histoire objective » promue par les autorités suppose d’opérer un changement de langue, de revendiquer une écriture singulière, mais aussi de changer de point de vue : le regard sera arrimé à un « je », et non au « nous » de rigueur dans l’épopée officielle. Ce rapport au sujet singulier est fondateur pour la littérature chinoise moderne (on considère que le premier texte chinois dans lequel s’exprime un « je », sous la forme d’un journal intime, date de 1918). Il est repris et porté par les poètes d’Aujourd’hui : revendiquer une individualité devient un choix politique. La revue sera interdite dès 1980.
S’ouvrent les portes de la ville hérite de tout cela : le livre, publié en chinois en 2010, raconte le retour d’un homme sur les lieux de son enfance, alors qu’il approche de la vieillesse et que son propre père est en train de mourir ; sa prose limpide est celle d’un écrivain qui s’est formé dans l’exigence et la rigueur de la composition poétique. Le livre a quelque chose d’une forme de sagesse tranquille ; son auteur a traversé bien des soubresauts de l’histoire, il s’est battu avec l’intensité du verbe, il revient à des formes simples.
On connaît ce trajet d’artistes qui ont porté haut une exigence radicale et qui, passé le mitan de leur vie, renouent avec des formes plus classiques, mais sans tentation réactionnaire. Au contraire, les expériences extrêmes antérieures ont donné une liberté telle à l’écrivain qu’il peut se réapproprier un répertoire commun, pour le rendre vif à nouveau.
À cet égard, la première moitié du livre de Bei Dao est une splendeur. Organisée par chapitres thématiques, elle fait se succéder des considérations sur les lumières de la ville (en commençant par la découverte, en 2001, depuis le hublot de l’avion, d’une ville étincelante, alors que le Pékin de l’enfance du poète était plongé dans une demi-obscurité permanente, propice aux jeux de cache-cache), sur les odeurs, les bruits, avant d’en venir aux objets (« Jouets et jeux », « Disques vinyles ») et aux activités (« La pêche », « La nage », « Lire »). Chaque chapitre rassemble des fragments discontinus, associés sur le mode de la rêverie – mais dans une composition évidemment très soignée, qui produit des rapprochements saisissants.
Petites poires acides et morts tragiques
Il y a, pour un lecteur français, quelque chose de très proustien dans cette collection de sensations ; le goût sucré que l’imagination prête à la neige poudreuse, le plaisir de se barbouiller de tomates dévorées sur le chemin de retour de la piscine, en portant sur la tête son slip de bain mouillé, ou encore l’élan donné par la bicyclette, la découverte qu’une dynamique peut avoir des implications politiques considérables :
« Le plaisir causé par la vitesse, voilà ce que ne pouvait éprouver la masse des élèves qui allaient à pied. Sur mon vélo, j’avais accès au grand courant de la révolution, je ne me considérais plus comme étranger à lui, je me forgeais même l’illusion que j’appartenais à la force principale. Quand plus tard je lus Don Quichotte, je compris brusquement que sa folie lui était certainement venue à force d’aller assis à dos de cheval. »
Mais le livre ne cultive pas seulement une tendresse pleine d’humour pour l’enfance perdue. Dans chaque récit singulier affleure la violence de l’histoire, et c’est le très grand talent de Bei Dao que de savoir reconstituer, par une succession impressionniste de petites touches, de notations concrètes, un paysage plus large, et terrible.
Car les conditions de vie sont dures : le chapitre sur les odeurs raconte essentiellement des souvenirs liés à la grande famine, officiellement « les trois années difficiles », de 1958 à 1961, alors que le jeune homme est en pleine croissance. « Je me suis mis à manger en cachette tout ce qu’il pouvait y avoir de mangeable à la maison, depuis les petites billes de microalgues dans l’aquarium à la lécithine gluante que mes parents recevaient rationnée. »
Mais c’est surtout que tout est toujours duplice. Le moindre objet, le moindre geste, la moindre parole, tout peut toujours s’avérer dangereux : une invitation à un tournoi de ping-pong est un prétexte pour suggérer aux enfants de dénoncer leur père, une plaisanterie lancée à un petit frère suscite une enquête de police, sans compter qu’un vers, un tableau, un disque ou un livre peuvent bien sûr être considérés comme contre-révolutionnaires.
Et gare à celui chez qui les lumières clignotent : « Yifan développait ses photos à la maison, les lueurs de la lampe rouge et celle utilisée pour l’exposition furent prises à tort pour des signaux faits par un espion ; du coup les policiers vinrent faire une perquisition, par malchance, tous les disques furent confisqués, y compris le Capriccio italiano […] de Tchaïkovski, un soixante-dix-huit tours de la maison Columbia en Bakélite noire. »
Les gestes les plus quotidiens, les souvenirs les plus anodins, tout est pris dans ce double mouvement : chaque détail concret se déploie dans la richesse des émotions de l’enfance, mais en même temps se rétracte pour dévoiler une ombre en arrière-fond, celle de la violente histoire chinoise du siècle dernier.
Le plaisir du récit n’est pas complet, hélas : la deuxième moitié du texte est plus linéaire, suivant la scolarité de l’élève qu’a été Bei Dao, et sa lecture plus difficile si l’on n’est pas familier des événements relatés ; le texte est parfois répétitif, parfois délibérément allusif, traversé d’une ironie subreptice qu’on n’est pas toujours sûr de saisir.
Mais reste l’émotion sensible que suscite le livre, celle-là même qu’a apprise Bei Dao dans son versant douloureux, alors qu’il explorait, enfant, la cachette réservée par ses parents aux « livres interdits »: « La trappe était profonde, mes bras petits. Au moindre écart, je tombais à la renverse et m’en tirais avec le visage tuméfié. Lors de cette expérience de la lecture dans mon jeune âge, en plus de la distinction que j’avais découverte entre public et secret, orthodoxie et hétérodoxie, le fait le plus marquant avait été l’expérience de la douleur physique. Je croyais que c’était le prix à payer pour lire les livres interdits. »