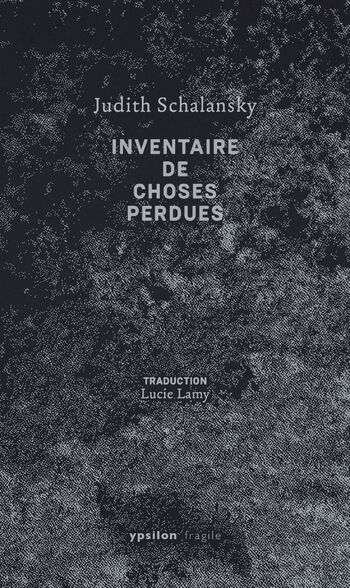4/12/2023
« Les contours de la disparition », par Léa Veinstein
Inventaire de choses perdues de Judith Schalansky est un recueil de douze courts textes qui racontent l’histoire d’une chose perdue à un moment et dans un lieu donné. Entre l’archive, l’histoire, et la poésie conceptuelle, cet inventaire mélancolique nous permet de penser et d’éprouver l’écoulement du temps.
Ce livre, signé Judith Schalansky, autrice allemande née en 1980, est un ovni : un véritable « objet volant non identifié », qui nous arrive d’une autre planète pour nous parler de la nôtre. Qu’est-ce qui, depuis que le monde existe et que nous sommes là pour le voir, a disparu ? Qu’est-ce qui a été enfoui, détruit, pulvérisé ; qu’est-ce que notre mémoire a expulsé ?
Ovni, d’abord, ce livre l’est car il est un livre de classement (un inventaire) pourtant totalement inclassable. Difficilement définissable par le biais d’une catégorie telle que le « genre littéraire », il n’est en effet ni un essai, ni un roman : il n’est ni dans la fiction, ni dans la non-fiction. Et en réalité, il tend même à faire de ces distinctions de lointains dinosaures ou des entités d’un autre temps. Disons, peut-être, que c’est un recueil de douze courts « textes ». Dans chacun d’eux, Judith Schalansky raconte l’histoire d’une chose perdue à un moment et dans un lieu donné, dessinant les contours d’une disparition : espèce animale, île, palais romain, manuscrits Grec, bobine de film allemand, etc. L’ensemble, hybride, mélancolique et d’une grande intensité, compose donc un « inventaire », à la Perec, mais aussi un catalogue de personnages, avec quelques images, à la Sebald. Peut-être est-il toutefois inutile, pour le présenter, de chercher des échos et des familles : il faut accepter de plonger dans un livre absolument nouveau, dans sa forme comme dans l’écriture qu’il invente.
Son entreprise singulière, Judith Schalansky la lance dans une double page préliminaire, conçue en diptyque y compris dans sa mise en page : elle présente sur la première page une liste de tout ce qui a disparu pendant l’écriture du livre — des objets de différentes natures, dans différents espaces, à différents moments, et qui ont subi divers processus de disparition. Un atterrisseur s’est écrasé sur Mars, des temples ont été dynamités à Palmyre, un lac au Guatemala s’est asséché, par exemple. Puis, au verso, elle inventorie au contraire, comme dans la doublure-miroir de la page qui précède, une liste de choses qui sont nées, sont apparues, ou ont été trouvées au cours de cette même écriture : un almanach de 1793, une double page du journal d’Anne Frank, des colombes aux yeux bleus dans la savane brésilienne (repérées alors que l’espèce était dite en extinction depuis 1941).
Dans cette doublure ou ce creux, entre la page des disparus et celle des découvertes, se trouve tout l’esprit de ce livre-objet. Nous sommes entre l’archive, l’histoire, et la poésie conceptuelle. Voici donc la proposition de ce livre : penser l’écoulement du temps à l’heure où tout ce que l’avenir nous offre, c’est une érosion. La littérature peut-elle nous aider à dire la menace d’extinction dans laquelle nous vivons ? Prendre en charge la « question écologique » dans sa dimension philosophique (la fin du monde), et potentiellement poétique, tel est le pari de ce livre, son ambition.
Avant que l’inventaire à proprement parler ne commence (chacun des douze « chapitres » prenant pour centre l’une de ces nombreuses disparitions), Judith Schalansky prend soin d’asseoir son projet sur un socle philosophique. Elle ne cite pas frontalement la question écologique, ni de philosophes précis, mais elle semble s’arrimer plutôt à une culture de pensée, largement « germanique » — elle est née en ex RDA, s’est formée à la Frei Universität de Berlin, ville où elle vit et travaille aujourd’hui. On pense en premier lieu à Walter Benjamin, à son amour pour le romantisme allemand, et à son esthétique du fragment[1]. Schalansky poursuit notamment son éloge de la « ruine », figuration architecturale parfaite de ce qui disparaît et demeure à la fois : « La ruine est un lieu utopique où le passé et l’avenir ne font qu’un », écrit-elle.
Ce livre ne pose pas seulement la question de la disparition : son enracinement philosophique nous confronte aussi, de façon originale et par endroits, vertigineuse, à la question de la mémoire et de l’oubli. Car le projet lui-même, inventorier, revient à « archiver », c’est-à-dire à garder à tout prix. À lutter contre la disparition, ou la destruction qui nous guette. Pourtant, il faut bien reconnaître que la mémoire totale est la mort de l’esprit. Judith Schalansky semble avoir lu aussi le Nietzsche de la Généalogie de la morale [2]: ce texte dans lequel Nietzsche défend, en 1887, les vertus nécessaires de l’oubli : en effet, pensez-y, que vaudrait un esprit qui se souviendrait de tout ? Judith Schalansky le sait. Elle sait que son entreprise d’archivage systématique est une lutte un peu désespérée contre l’inéluctable, qu’elle se débat ainsi avec l’impossible, et avec l’idée de la mort. Elle le formule dans l’Avant-propos, et y revient dans différents chapitres : « qu’est-ce qui est le plus terrible : la perspective que tout aura une fin ou qu’il pourrait ne pas y en avoir ? ».
« Nous sommes peu à peu atteints, précisons-le, par la mélancolie qui sous-tend naturellement tout projet sur ce qui disparaît. »
Après cet Avant-Propos, très dense, démarre l’inventaire : la litanie de ces douze entités disparues. Chaque chapitre commence par une page de garde construite sur le même procédé : après le symbole CROIX, en italiques, la description de l’objet choisi et de sa disparition. Puis, après le symbole ETOILE, la description de ce que l’on a pu en sauver, en retrouver, ou en archiver. En face se trouve chaque fois une image de l’objet ou de sa figuration, imprimée sur papier noir et argenté — nous donnant l’impression de découvrir l’objet disparu à travers un négatif photographique. Judith Schalansky, précisons-le, est aussi graphiste et éditrice, c’est elle qui met en forme ses ouvrages pour son éditeur allemand, Suhrkamp ; démarche fidèlement et magnifiquement reproduite ici par Ypsilon dans la traduction française.
Mais après cette première page identique, chaque chapitre donne lieu à une véritable narration : nous lisons alors des espèces de petites nouvelles, autonomes et extrêmement différentes les unes des autres. Le lien à l’objet perdu est plus ou moins évident, plus ou moins direct. Certains donnent lieu à des récits autobiographiques : la licorne de Guericke, inventée et disparue dans les Alpes valaisiennes, entraîne le récit d’un jour de randonnée de la narratrice, partie seule en montagne écrire un guide des monstres dans les Alpes. Le château des Von Behr, dans une ville du Nord de l’Allemagne, qui brûla le 8 mai 1945, suscite un savoureux chapitre sur les souvenirs de petite enfance de la narratrice, qui réfléchit sur sa naissance et son rapport aux origines.
D’autres chapitres, eux, donnent des récits ou monologues délibérément fictionnels. Parfois, le narrateur est un personnage contemporain de la chose perdue au moment où elle existait, comme une fiction historique ou une utopie inversée. Ainsi, le tigre de la Caspienne, disparu dans les années 1950, génère-t-il un récit aux accents mythologiques de combats d’animaux dans la Rome antique. Chaque fois en tout cas, Judith Schalansky se tient scrupuleusement à une unité de temps et de lieu, faisant en sorte que le récit existe et nous emporte, quand bien même nous sommes par instants un peu chahutés par tous ces changements de registres et de temporalité (certains chapitres nous emportant mieux ou plus loin que d’autres).
L’un des plus émouvants peut-être est celui intitulé « Odes de Sappho ». Il part de l’histoire de ces quelques fragments de poèmes, écrits sur des papyrus en -600 av. J-C par la poétesse Sappho sur l’île grecque de Lesbos. Ils nous sont parvenus « mutilés », avec des trous et des manques, et à hauteur de 7% seulement de ce qu’ils comprenaient probablement à l’origine. Judith Schalansky précise qu’outre la décomposition de leur matériau « organique », nous avons perdu la forme originelle de leur existence et de leur adresse, puisque « la notion de l’accompagnement musical a entièrement disparu ». Se tenant dans ce chapitre très près de l’histoire de l’objet, l’autrice y inscrit en creux, de façon elle aussi fragmentée
mais lumineuse, un questionnement sur notre rapport à l’homosexualité féminine, appelée « lesbianisme » d’après Sappho. Et ce dans de multiples langues, dont l’allemand : « Dans les dictionnaires allemands, lesbien (lesbisch) arrive juste après lisible (lesbar) », écrit-elle en clôture.
Dans cette succession de chapitres, nous sommes peu à peu atteints, précisons-le, par la mélancolie qui sous-tend naturellement tout projet sur ce qui disparait. Je dois le dire : à un moment de ma lecture, cette mélancolie puissante m’a atteinte aussi. J’ai commencé, dans le sillage de son projet, à m’interroger sur tout ce qui avait disparu depuis que j’avais commencé ma lecture, et sur mon impuissance face à la destruction (sentiment particulièrement intense ces semaines-ci). Ma lecture elle-même est devenue un peu fragmentée. Un soir, alors que j’ai voulu poursuivre, je n’ai pas trouvé le livre. Je l’ai cherché partout, J’ai attendu quelques jours, puis j’ai vidé tous les sacs possibles : il fallait m’y résoudre, je l’avais définitivement perdu. Et j’en étais très troublée : car, à l’inventaire des choses perdues venait s’ajouter l’inventaire lui-même, le sujet du livre se confondait avec l’histoire de son objet. J’étais si impactée par ces histoires de perte, que j’avais fait de ma lecture un acte, j’avais ajouté un autre objet perdu. Pour une lecture collaborative, c’était d’une certaine efficacité. Cette expérience de la disparition me permettait-elle de comprendre, pour finir, quelque chose de plus, de ce livre et de sa très grande singularité ?
Sans doute n’est-ce pas un hasard que cette perte : l’une des forces de ce livre est de parvenir en effet à tisser un vrai lien (un lien authentique) entre le livre et ce qu’il nous raconte. Le livre est ici aussi un objet, au sens noble du terme : une entité qui existe dans le monde, et qui en ce sens est amenée à disparaître, certes ; mais aussi à nous donner quelque chose, à nous emmener quelque part dans le laps de temps, même éphémère, où il existe et se trouve entre nos mains. Non seulement Judith Schalansky s’engage, on l’a dit, dans la mise en page et le graphisme, mais elle nous livre aussi, ce faisant, une réponse possible à la mélancolie. Si quelque chose peut exister encore, malgré l’érosion et contre la fin du monde, n’est-ce pas finalement, la littérature ? Ou plus précisément : le livre comme objet ? Au moment où la destruction guette, et où certains prédisent la mort du livre « papier », Judith Schalansky lui donne une forme nouvelle, et peut-être, une autre vie : « le livre continue de m’apparaître comme le plus parfait de tous les supports — en dépit du papier utilisé depuis quelques siècles, qui ne se conserve pas aussi bien que le papyrus, c’est un multiple qui augmente ses chances de transmission pendant quelques générations […], une capsule temporelle ouverte dans laquelle les morts sont bavards, le passé vivant, l’écriture vraie et le temps maintenu ».
Lire ce livre est une expérience, pas toujours simple mais vraiment belle, à faire en prenant garde de ne pas le perdre, un jour, dans un RER.