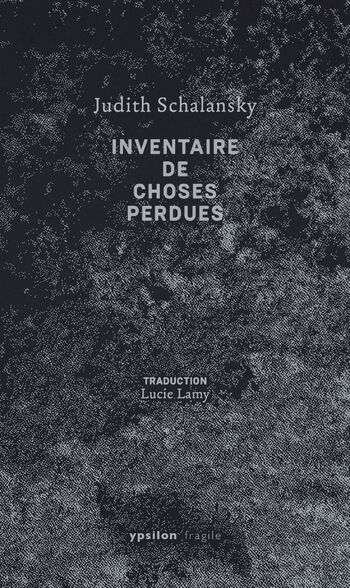14/11/2023
« Rien ne se perd », entretien avec Judith Schalansky, par Feya Dervitsiotis & Flora Moricet
Capable aussi bien d’incarner des personnages passés, de raconter des souvenirs que de décrire des œuvres et des bâtiments de manière anatomique, Judith Schalansky ausculte les choses qui restent.
L’astéroïde 95247 porte son nom. Autrice exigeante et minutieuse, dont l’originalité profonde explique sans doute qu’elle soit traduite dans plus de vingt langues, l’Allemande Judith Schalansky se reconnaît à son érudition teintée de poésie mélancolique. Ses trois livres traduits en français (dont les deux premiers Atlas des îles abandonnées, 2010 ; L’Inconstance de l’espèce, 2013) convoquent chacun une ou des sciences, notamment la géographie, la biologie, l’anthropologie, l’architecture… Mais toujours, en premier lieu, l’histoire.
Née en 1980 en ex-RDA, Judith Schalansky est marquée par « la fracture de l’histoire, le démantèlement des monuments, la destruction des images par les vainqueurs… » Son dernier texte, Inventaire de choses perdues, est une œuvre hantée par la mémoire et la nostalgie. Suivant un impalpable montage, elle se saisit successivement de 12 figures — qu’elles soient humaine, animale ou inanimée — qui ont en commun d’être perdues. À chacune de ces choses, elle consacre un texte structuré de la même façon : dans un premier temps, une brève biographie de la chose disparue et sa place dans l’histoire, suivie des circonstances de sa mort, de sa disparition ; puis à cette introduction succèdent plusieurs pages qui s’éloignent de ce point de départ par la fiction, par la rêverie, allant là où les mots semblent la mener, dans un style et un registre chaque fois différent.
Plus intéressée par l’ambivalence de la perte que par la seule trace laissée, Judith Schalansky explore avec une finesse remarquable la façon dont une chose perdue peut être retrouvée, puis à nouveau détruite. Son Inventaire retrace la trajectoire mystérieuse que suivent une île, un tigre de la Caspienne, une villa, un matériau du Palais de l’ex-RDA exporté à Dubaï… Rien ne se perd, « tout peut encore servir » et se transformer. Même « une pensée, une fois au monde, se poursuit dans une autre. »
Dans une introduction passionnante, vous expliquez votre obsession pour la trace, pour tout ce qui reste, ce qui subsiste de la mort et de la perte. Vous dites qu’écrire sur une disparition inévitable vous a réconfortée. En quoi ?
Les personnes comme moi, sujettes à la peur, et qui imaginent ce qui peut arriver de pire, ont souvent recours à cette pratique curieuse mais répandue qui consiste à souffrir avant l’heure. Peut-être est-ce l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu consacrer un livre entier aux choses perdues, afin d’avoir une longueur d’avance, et d’être en quelque sorte préparée. Il n’empêche que la mort, en ce qu’elle représente la perte ultime, est la clause en petits caractères dans le contrat que nous signons tous à la naissance. Une vieille question, peut-être même la plus vieille, consiste à se demander qui est le plus proche de la vie : celui qui se voit constamment rappeler à sa propre mortalité ou celui qui parvient à éradiquer cette pensée ? Mais perdre quelque chose, c'est aussi apprécier ce qu’elle représentait vraiment pour nous. D'un point de vue anthropologique, on peut dire que la première activité culturelle est née lorsque nos ancêtres, qui n'étaient pas encore humains, ont commencé à s'occuper des cadavres de leurs semblables. Ce n’est pas fondamentalement nécessaire, mais cela a un sens. Toute perte — tout ce qui est perçu comme tel — nous oblige à produire du sens. Nous sommes des animaux avides de signification et de réconfort. Et c'est là qu'intervient la mémoire, accompagnée de ses complices que sont le récit, l'écriture, la littérature.
Vous créez des archipels à partir d’objets sans rapport. Votre intention était-elle d’écrire un cabinet de curiosités ? Comment avez-vous choisi ces 12 choses perdues ?
Tout à fait. Je souhaitais créer un livre qui fonctionne comme une exposition, qui ne fasse pas de distinction entre les choses naturelles et artificielles, tant qu'elles suscitent l'étonnement. Un cabinet de curiosités donc, et plus précisément de ma curiosité personnelle, riche d'une douzaine de choses qui me manquaient. Ainsi, l'histoire du combat dans une arène romaine entre un lion et le tigre de la Caspienne, aujourd'hui disparu, reflète la pratique ancienne et toujours courante d’après laquelle une civilisation apprivoise, réprime et annihile la nature sauvage des autres, à savoir les barbares et les monstres, en devenant eux-mêmes des barbares et des monstres. Quant au récit des deux peintres de ruines dans la Rome du XVIIIe siècle, il raconte un tournant ironique de l'histoire, lorsque les ruines étaient des objets de désir. Les nobles qui avaient alors fait installer de fausses ruines dans leurs parcs et terrains de jeu, ont ensuite été confrontés aux ruines réelles de leurs domaines à la suite de la Révolution. Et l'essai sur Sappho ne porte pas seulement sur sa poésie perdue, mais aussi sur ces fantasmes qui ont rempli maintes fois les blancs, et notamment ce manque ou cet espace vide que serait la sexualité féminine, et à plus forte raison la sexualité féminine homosexuelle, qui a longtemps été considérée comme inexistante. Ou pensez à Mani, cet homme du IVe siècle à l’origine d’une religion mondiale qui s'est répandue de la Chine à l'Espagne. Désireux d’être plus intelligent que Jésus, il avait décidé d'écrire lui-même ses Écritures Saintes mais aussi de les illustrer et de les concevoir lui-même, y compris les caractères pour la typographie. Comme moi, c'était un amoureux des livres, un être compulsif qui avait besoin de tout contrôler.
Vous croisez tous les champs de la connaissance dans vos livres, et particulièrement dans celui-ci, ce qui en fait un ouvrage monumental qui touche à une forme d’absolu. Souscrivant à la théorie de Freud selon laquelle rien ne s’oublie, votre livre va jusqu’à former une psychanalyse de l’histoire. Pensez-vous que la littérature soit le lieu où rien ne s’oublie ?
Oui, même si c’est une utopie, mais c’est une utopie en laquelle il faut croire, et qu’il faut défendre. Parce que la littérature s’avère être un espace résistant et robuste pour porter toutes ces voix et récits qui ont été exclus et ignorés de l’historiographie traditionnelle : celles que l’on n’entend pas et celles réduites au silence, les voix bâillonnées et marginalisées.
Dans « Encyclopédie en forêt », vous faites dire au narrateur : « on doit lire pour mettre de l’ordre ». Écrivez-vous pour mettre de l’ordre dans le chaos de la pensée et du monde ou au contraire pour maintenir l’histoire en vie ?
Bien sûr. Notre système d'écriture est linéaire et il en découle que même les états émotionnels les plus confus n’ont d’autre choix que de se plier à un ordre rassurant, comme le savent tous ceux qui écrivent des journaux intimes. Je me dis souvent que l’ordonnancement des sciences est un acte magique. La folle démesure de la création s’y trouve enfermée et codifiée en un acte touchant mais profondément violent. Pensez au cabinet de classification de Linné, dans lequel chaque sous-espèce est rangée dans un compartiment différent. Cette classification établit un ordre mondial taxinomique qui met l'accent sur les relations de parenté, mais passe sous silence les interactions vitales qui rendent la vie des organismes possible. Je me demande souvent à quoi ressemblerait une langue symbiotique, organique. Peut-être comme le thaï, qui ne se conjugue pas mais possède plus de 20 formes en « i » qui indiquent si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes une personne plus jeune ou plus âgée que votre interlocutrice, si vous avez vécu dans un monastère, si vous avez un surnom, si vous parlez en étant à l’aise ou de façon officielle et retenue. Cet ego-là est fluide, il se constitue au fil des relations et des contextes et met ainsi à mal l'idée que nous nous faisons de la subjectivité en tant qu'individu cohérent et permanent. Mais la volonté d'ordre du créateur de l'encyclopédie en forêt s’explique par son besoin d'apprivoiser son propre désir, si dérangeant : il conservait chez lui une encyclopédie d'environ soixante-dix volumes sur les variantes et les déviations de la sexualité.
Inventaire des choses perdues n’obéit à aucune règle narrative, événements passés comme nouveaux y figurent sur un même pied d’égalité. Pourquoi refuser une représentation linéaire du temps ainsi que d’instaurer un « centre de gravité » dans votre livre ?
Mon Inventaire repose sur une sélection impitoyable car l’objectivité n’est-elle pas la plus grande fiction ? J’ai une conception très compliquée et généreuse de la littérature. Pour moi, tout ce qui est écrit est de la littérature : les manuels, les to-do-lists, les textes de lois, les articles encyclopédiques, les lois physiques… parce que tous sont une forme de représentation de ce que nous prenons pour la réalité. Je lis beaucoup de livres dont le rapport à l’objectivité produit une forme poétique vaste et polyphonique. Les bestiaires, les encyclopédies, les atlas, les manuels offrent plein d’entrées. Je veux faire des livres qui sont comparables à de l’architecture. Et avec cet Inventaire, j’ai voulu créer une maison avec différentes pièces qui changent de couleurs, de lumières et de meubles mais qui sont exactement de la même taille. L’Oulipo nous a appris que des règles strictes permettent une immense liberté. Ces douze choses de mon livre peuvent apparaître disparates, mais par leur agencement même elles finissent par se relier entre elles en nouant des relations secrètes.
Pensez-vous que les constructions humaines et la surface de la terre, les fleuves et la mer soient capables de rêver ?
Peut-être qu’ils ne rêveraient pas, parce que le mot est trop restrictif, propre aux humains. Mais ces lieux, ces architectures et ces paysages ont une forme de conscience qui leur est propre. Qu’ils soient capables d’enregistrer et de produire de l’expérience, ça me paraît évident. Les lieux peuvent raconter des histoires. Il suffit d'écouter attentivement.