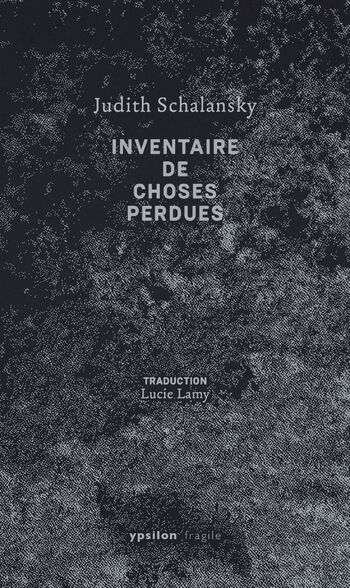15/11/2023
« Atlas des choses fragiles », par Cécile Dutheil de la Rochère
Dresser un Inventaire de choses perdues ? Comment faire ? Où commencer ? Où s’arrêter ? La tâche semble impossible à remplir, comme le tonneau des Danaïdes. Elle est pourtant séduisante, comme la personnalité de celle qui se l’est assignée, Judith Schalansky, écrivaine allemande, mais aussi éditrice et graphiste. Son livre en tant qu’objet n’est pas seulement un élément qui revient dans les chroniques qui composent son inventaire. Il est sensible dans la qualité du papier, la composition du texte, la beauté de la couverture bleu-argent moirée et celle des pages qui ouvrent chaque chapitre du livre, tel un rideau de prestidigitateur. L’habillage est important puisqu’il s’agit de choses, n’est-ce pas ?
Saluons donc le travail d’Ypsilon, l’éditeur français, qui a respecté les choix de Judith Schalansky. Et rappelons qu’Ypsilon n’est pas une maison comme les autres : elle est indépendante, elle privilégie la poésie et elle a inauguré son catalogue par une édition en langue arabe du Coup de Dés de Mallarmé. L’actualité qui déchire le monde arabe au moment où nous écrivons est-elle un hasard ? Plutôt que de répondre, notons : la couverture du livre indique non pas Ypsilon éditeur, mais « ypsilon fragile ».
Fragiles, les choses, les monuments, les tableaux… Parmi les douze chapitres de cet Inventaire de choses perdues, sont en effet évoquées la disparition d’une villa italienne du XVIIe siècle, dite villa Sachetti ; la destruction en 1945 d’un château qui appartenait à une famille aristocratique de Poméranie ; la démolition par le feu, en 1931, des 3 000 tableaux du Palais des glaces de Munich, dont une exposition comprenant une peinture de Caspar David Friedrich qui représentait sa ville natale, le port de Greifswald.
Fragiles, les supports, les tablettes, les rouleaux… D’autres chapitres évoquent la poésie de Sappho dont seuls des fragments ont été retrouvés au fil du temps et des lieux. Ou la découverte en 1929, par trois adolescents, d’une liasse de papyrus gâtée comprenant des écrits et des enluminures de Mani, prophète à l’origine du manichéisme. Ou encore un film de Murnau appelé Le garçon bleu, qui « passe pour perdu », précise Judith Schalansky (qui sait, un jour peut-être le retrouvera-t-on), dont ne subsistent que quelques bouts friables et inflammables conservés à la cinémathèque de Berlin.
Cette succession d’exemples, comme le mot « inventaire », est en fait un trompe-l’œil. Le lecteur pourrait en conclure que le livre se présente sous forme de liste, de miscellanées ou de collage. Il n’en est rien et c’est une de ses qualités : il est non genré mais il est structuré et il prend le temps du récit. Après un double avant-propos qui se lit comme un lamento, chaque chronique est construite en deux parties inégales. Une première partie, très brève, en italique, résume l’histoire et la disparition de la chose dont il va être question ; le ton est parfaitement neutre, gris comme l’ethos de la RDA où est née Judith Schalansky.
La seconde partie est un récit, une histoire qui se déploie sur plusieurs pages avec une inflexion différente à chaque fois. Dans plusieurs de ces histoires, l’autrice apparaît cherchant, lisant, méditant, se perdant, marchant. Certains récits sont mélancoliques ; l’un s’essaye au monologue intérieur ; beaucoup se rapprochent du récit documentaire. Il arrive que ce qui est raconté semble avoir peu de rapport avec l’introduction : les repères sont tapis ailleurs, plus loin dans le texte, ou dans l’imaginaire de Judith Schalansky, ou dans le réservoir d’images et de noms de l’humanité.
L’ensemble forme donc un tout cohérent mais plein d’inattendu. Le choix des choses inventoriées semble arbitraire, mais on y décèle des constantes, des souvenirs d’enfance, des paysages de la Baltique au bord de laquelle l’autrice a grandi, un désir de savoir nourri par une jeunesse passée dans un pays où voyager était proscrit – son superbe Atlas des îles abandonnées commençait en rappelant tout ce que cette impossibilité a alimenté chez elle, esprit ô combien rêveur et curieux.
On y décèle surtout, évidemment, une fascination pour tout ce qui sombre, s’évanouit, renaît, replonge, se manifeste soudain par des empreintes d’une permanence qui vacille au point de faire trembler la frontière entre ce qui est et ce qui n’est plus. Du monde, nous ne connaissons que des traces, des impressions au sens propre, semble dire Judith Schalansky. L’écrivaine s’intéresse à tout ce qui est gravé, bâti, copié, écrit, transcrit, apposé, marqué. Comme si rien ne disparaissait jamais entièrement. Parce que tout finit par disparaître.
Mais Judith Schalansky n’est ni philosophe ni métaphysicienne ; elle n’est pas non plus romancière. Elle est conteuse, et conteuse merveilleuse. Elle est aussi « descriveuse », et aussi merveilleuse. La singularité de son Inventaire de choses perdues tient à ce double talent, cet art de conjuguer le pouvoir de satisfaire l’envie d’intrigue d’un lecteur inconnu et l’aptitude à dépeindre minutieusement, à la loupe, non pas le réel, mais la nature : les nervures des feuilles, les nuances chromatiques changeantes du ciel, les flux de la météorologie, le cours d’un ruisseau qui s’élargit, se rétrécit, se perd et réapparaît sous une motte…
Judith Schalansky a fait sienne la curiosité des grands géographes et des savants qui ont arpenté, observé et organisé le monde. Leur legs est très sensible dans son inventaire, qu’elle soit dans une bibliothèque, plongée dans un traité, ou dans un paysage de pâturages à la recherche de l’embouchure du Ryck, noyau de la ville de Greifswald, « tombé en ruines depuis la guerre de Trente Ans ». « La difficulté n’est pas de trouver l’origine, mais de la reconnaître », écrit-elle avant de partir à la recherche de cette embouchure.
Certaines de ses descriptions sont des gravures naturalistes dont la précision est stupéfiante, sans âge, n’était, par exemple, la mention d’un téléphone mobile. Il arrive qu’elle frôle la maniaquerie, mais les réflexions, les pensées qu’elle glisse lui interdisent de s’y enfermer. Elle écrit après d’illustres prédécesseurs (Humboldt, par exemple, ou, plus près de nous et différemment, Sebald) mais elle ne les singe pas. À moins de penser, comme jadis, que l’imitatio n’est pas un vilain défaut.
Judith Schalansky donne l’impression d’avoir aboli l’histoire et le progrès de sa carte mentale. De brouiller les coordonnées qui permettent de distinguer oubli et mémoire. Elle parle avec le même sérieux du tigre de la Caspienne, espèce disparue, et de la licorne, espèce fabuleuse. Sourit-elle en douce ? Il semble que non. Amours saphiques, combat manichéen entre ténèbres et lumières, îles peut-être englouties, mariage entre Murnau, le cinéaste, et Gainsborough, le peintre… des mondes étranges s’entrouvrent, des contours floutés apparaissent, des idées folles, des mâts de voiliers dans le brouillard, des taches sombres, le visage d’un garçon bleu… l’inventaire serait infini.